Les utopies de la gratuité à l’épreuve du statu quo
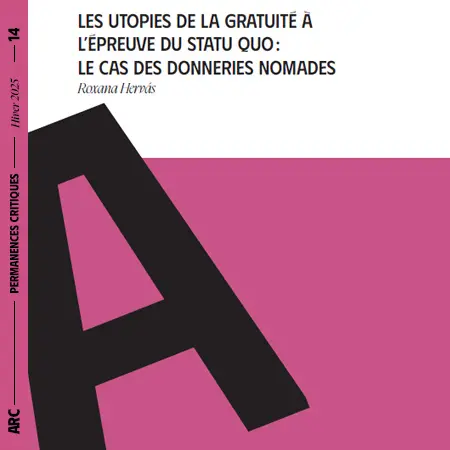
L’utopie de la gratuité à l’origine des Donneries est rapidement devenue un miroir des inégalités qu’elle cherchait à combattre : loin de subvertir le marché, cette utopie finit par en reproduire les lignes de fracture de classe et de
Philanthropie et richesse collective, perspectives croisées
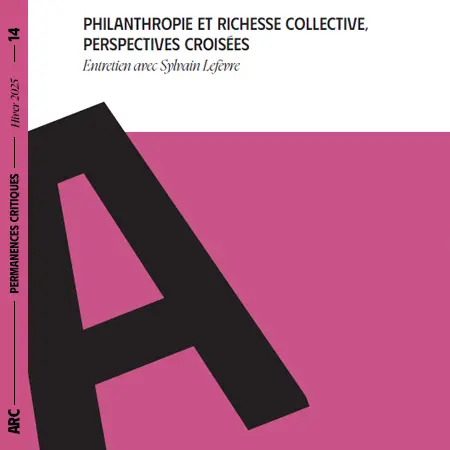
Du point de vue de l’organisation du non marchand, le Québec partage avec la Belgique un certain nombre de traits communs, qui sont autant de différences vis-à-vis du modèle états-unien : l’importance de l’État social, les liens forts entre État et secteur associatif, le niveau d’imposition
De la difficulté à institutionnaliser la relation d’assistance
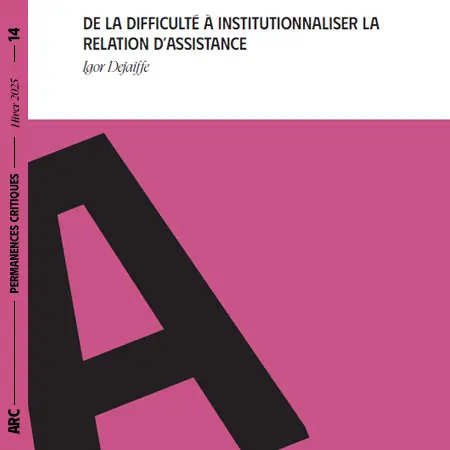
À partir d’une lecture simmelienne de la société comme réseau d’interdépendances, la présente analyse se propose de réenvisager la centralité de la relation d’assistance et de la réexaminer à l’aune de la distance que les dispositifs institutionnels et idéologiques installent entre aidant et aidé. Cette variable d’ajustement, bien davantage que
Pour un antiracisme politique radical et décolonial à Bruxelles
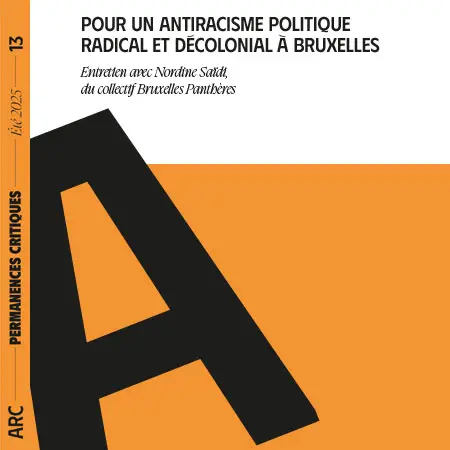
Dans cet entretien, Nordine Saïdi, membre fondateur de Bruxelles Panthères, revient sur le positionnement de ce collectif militant antiraciste et décolonial dans un paysage où la question de la récupération institutionnelle prend tout à la fois la forme d’une captation « polie » des revendications radicales et d’un tissage de réseaux de militances
Travailler ou militer : résister
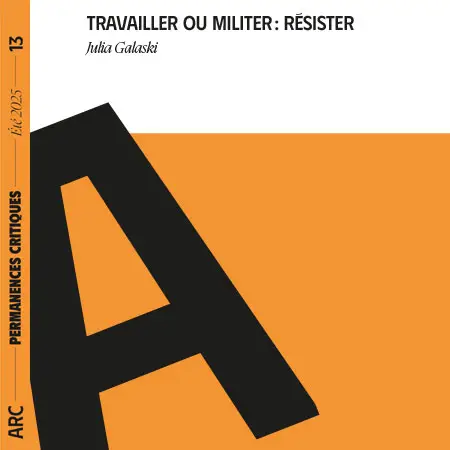
Retour sur dix ans d’engagement citoyen et de travail dans le milieu associatif bruxellois, dans un contexte de démantèlement progressif des services publics et de l’État de droit. Dans une écriture fragmentaire visant à restituer des moments clefs de ces expériences, il s’agit, en articulation avec la lutte militante, d’explorer et d’habiter les
Militance et associatif : penser et agir ensemble contre les rapports existants
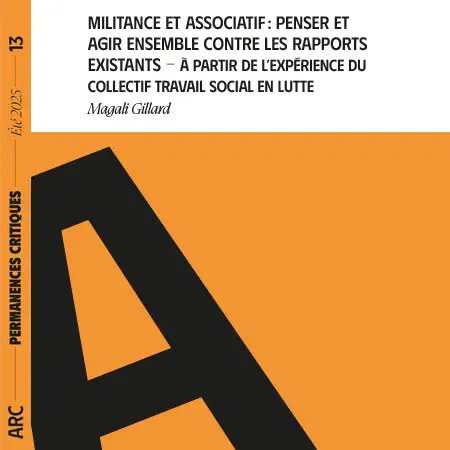
Englué dans des structures organisationnelles contraintes de se conformer aux critères d’évaluation dont dépendent l’obtention de subsides, pris dans des segmentations contre-productives, le travail social tend à perdre son sens, réduit à un rôle de soins palliatifs dans un système sociétal d’une brutalité croissante. L’auteure interroge ici
Penser l’associatif au prisme du travail de reproduction

Nées au lendemain de la loi de 1921 leur accordant la personnalité civile, le nombre d’associations sans but lucratif (ASBL) a été multiplié par sept depuis les années 1960. Cette progression coïncide avec l’augmentation de leur présence dans diverses activités économiques. Par ailleurs, de plus en plus d’ASBL exercent des activités à caractère commercial
Révo cul dans l’éduc pop !

Fait nouveau majeur : avec 40% de la population désormais diplômée du supérieur, le gros des associations d’éducation permanente/populaire – la petite bourgeoisie culturelle – a lentement déserté la question sociale du travail, cœur de la lutte des classes, pour se tourner vers des formes de militantisme « sociétales » qui tendent à moraliser ou
Sans-chez-soi et sans voix, pour une autre histoire de la Porte de Namur
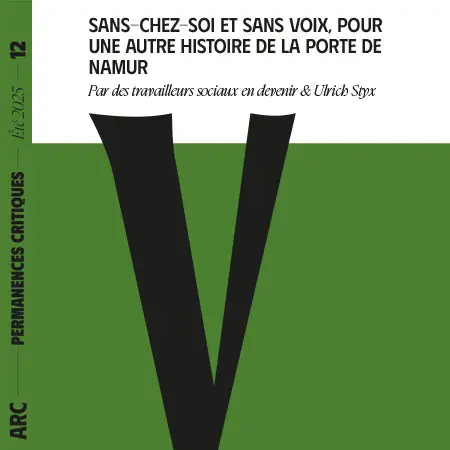
En réponse à l’éditorial paru dans L’Écho intitulé « À la Porte de Namur, entre coups et crachats, la dure réalité des commerçants bruxellois », ce texte se veut un contrepoint radical aux récits dominants qui instrumentalisent la précarité pour masquer les causes systémiques des inégalités. À partir de notre travail de terrain et de nos modestes
L’autophagie numérique : faire de soi-même une marchandise
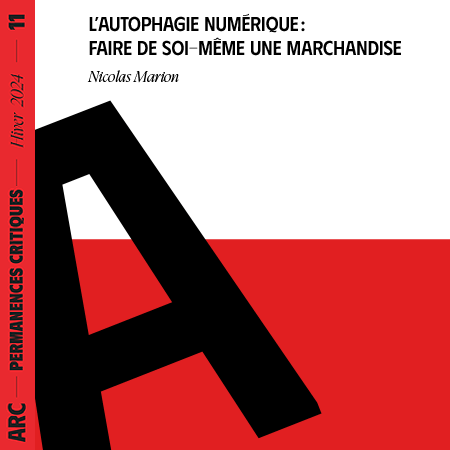
S’appuyant sur une analyse des logiques de personnalisation propres à certaines interfaces numériques dominantes (TikTok, Spotify) et à leurs algorithmes, cette analyse veut proposer une hypothèse critique des transformations de la logique de consommation qui s’y dessinent. Ces algorithmes, qui visent à maximiser le temps de
Liminal spaces et déterritorialisation
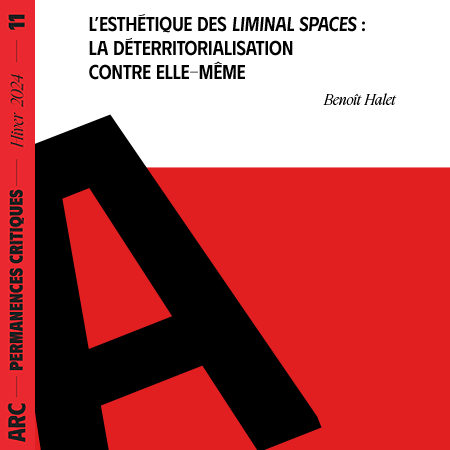
À l’heure où le réseau planétaire des technologies numériques s’est pleinement intégré dans nos vies, au point de nous faire accepter l’idée d’une réalité « augmentée », l’infrastructure dans laquelle le monde du capitalisme numérique nous pousse à vivre génère des sentiments ambivalents. La présente analyse, en croisant
Contre la résilience et son monde
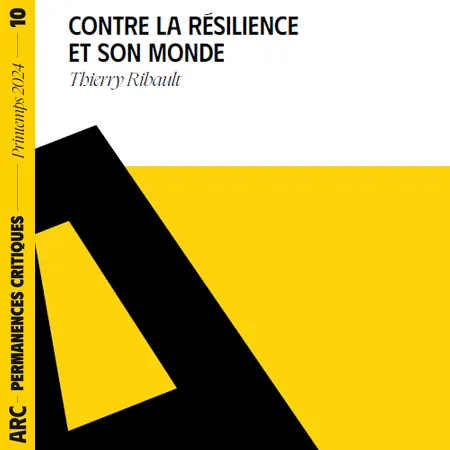
En biologie, l’adaptation est une caractéristique essentielle du vivant. Mais lorsque les capacités adaptatives d’un individu ou d’une société sont labellisées sous le terme de « résilience » et font l’objet d’un vaste discours de
Au nom de quoi la lutte se forme ?

Dans une ambiance de frustration générale face à l’inaction climatique, cette analyse cherche à observer ce que l’on peut apprendre du fonctionnement de notre société et de la prise que nos opinions ont réellement sur la conduite de
ZAD partout, une stratégie révolutionnaire
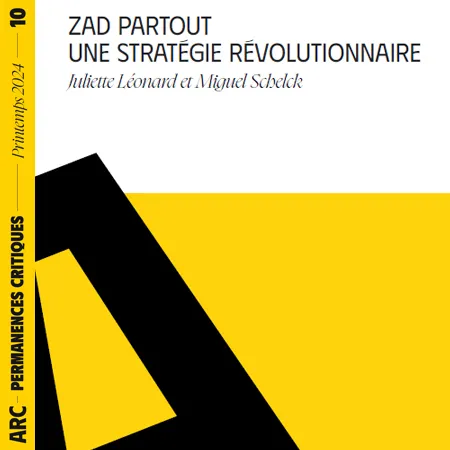
Un temps populaire auprès des militants écologistes et révolutionnaires, les Zones À Défendre (ZAD) soulèvent pourtant différentes questions sur leur capacité à profondément changer les rapports sociaux. Le caractère par définition local de ce type de lutte, ses rudes contraintes
Déchets textiles et économie circulaire

La question de l’avenir des vêtements dont on se sépare nous amène à considérer le rôle des grandes marques à l’initiative de ce qui finit par devenir un déchet textile. C’est à l’industrie de la seconde main, prise dans l’économie circulaire, qu’incombe dans un premier temps la gestion et le traitement des vêtements dont les gens se
Coliving, financiarisation du logement et failles juridiques
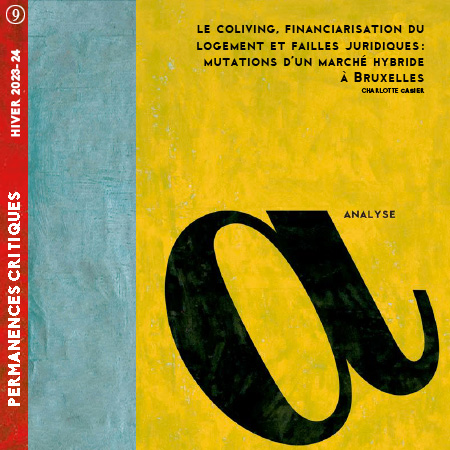
Dans cet entretien, Charlotte Casier, géographe à l’ULB, nous donne un aperçu d’une des formes récentes que peut prendre la marchandisation du logement : le coliving. Casier nous présente les résultats de son enquête sur un objet jusque-là peu étudié et qui permet de mieux comprendre les dynamiques actuellement à l’œuvre sur le marché du logement.
CAF : le numérique au service de l’exclusion et du harcèlement des plus précaires
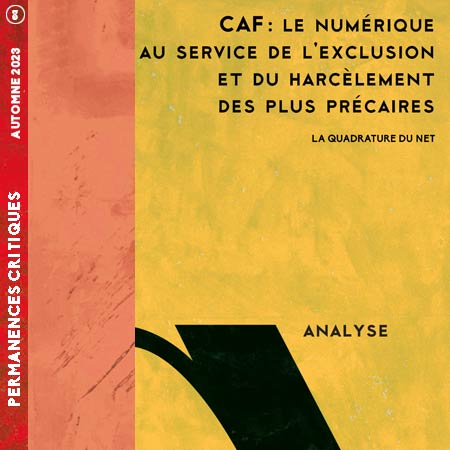
Depuis une dizaine d’année, la Caisse d’Allocations Familiales (établissement public français qui gère et finance les prestations familiales) a mis en place un algorithme pour automatiser le déclenchement des contrôles d’allocataires. La Quadrature du Net, aux côtés d’autres organisations, souhaite lutter contre cet outil…
Le numérique comme marché associatif
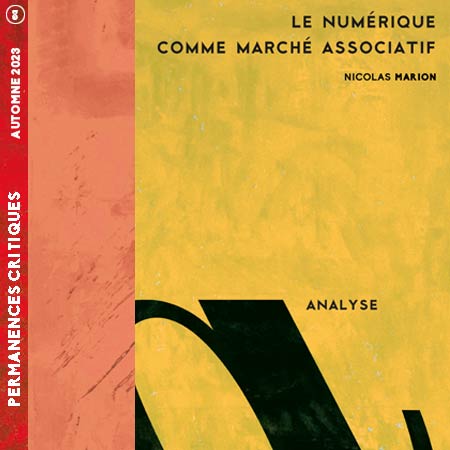
À partir d’une analyse critique des tenants et aboutissants d’une tendancielle et récente « politisation » des débats autour des problématiques relatives aux inégalités numériques au sein de la société belge, cet article propose de s’intéresser aux motifs de la montée en puissance, au sein de la société civile…
Numérisation de l’administration publique : allier technologie et droits humains
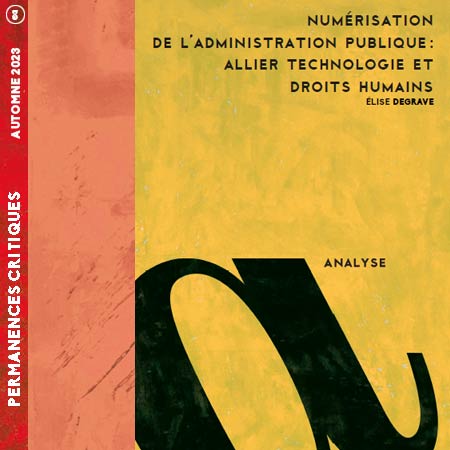
Des droits octroyés automatiquement, des croisements de données à caractère personnel et des algorithmes « anti-fraude » pour cibler les fraudeurs potentiels, la suppression de guichets humains pour des services publics « 100% en ligne » d’ici 2030, sont autant de signes d’une accélération vers le « tout numérique » dans la relation entre le citoyen et l’État
Pour une explicitation généralisée du développement algorithmique : conception-problématisation et diffusion-performance
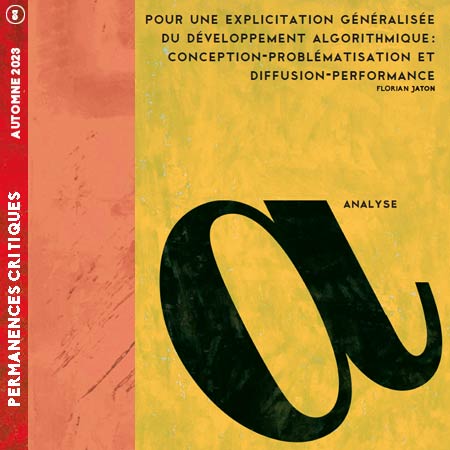
Comment reprendre collectivement la main sur les algorithmes qui peuplent nos quotidiens ? Dans cette note, Florian Jaton rend compte d’une série d’outils théoriques – issus pour la plupart des Science and Technology Studies (STS) – soutenant l’inspection plus avant des algorithmes au moment de leur conception ainsi qu’au moment de leur diffusion.
Pour une politique de confluences et de dissensus
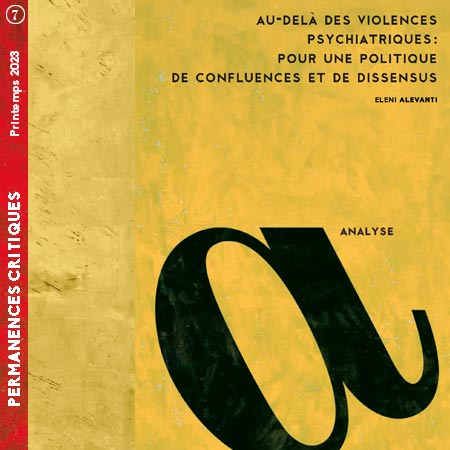
Les exemples de violences psychiatriques sont nombreux mais rarement reconnus en tant que tels. Plus encore, les personnes psychiatrisées, survivantes d’abus répétés, doivent à présent faire face à des nouvelles formes de négligence de la part des services de soins en
Une nouvelle forme de violence coloniale belgo-congolaise
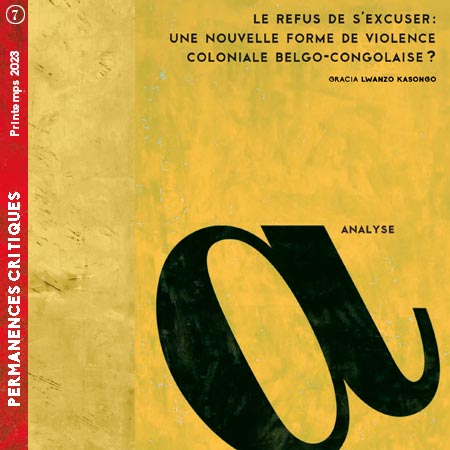
Cet article propose une analyse du refus de la Belgique de présenter des excuses officielles pour les crimes coloniaux perpétrés au Congo en tant que nouvelle forme de violence coloniale. En effet, l’auteure soutient que ce refus d’admettre la responsabilité historique de la Belgique pour les atrocités commises au Congo témoigne d’une
Une approche féministe du salaire comme puissance subversive
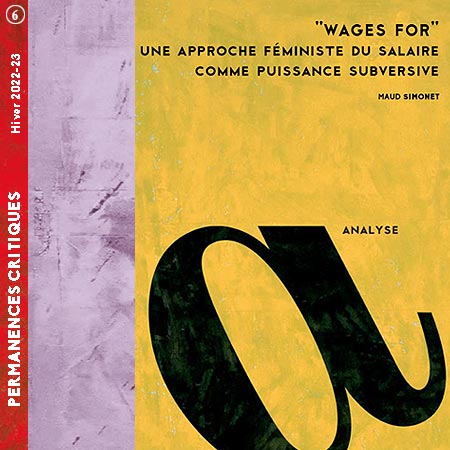
En revendiquant un salaire pour les stagiaires, les étudiant·es québécois·es en grève en 2018 réactualisaient, comme d’autres mouvements sociaux contemporains, une histoire revendicative plus large
Faire revenir le temps payé
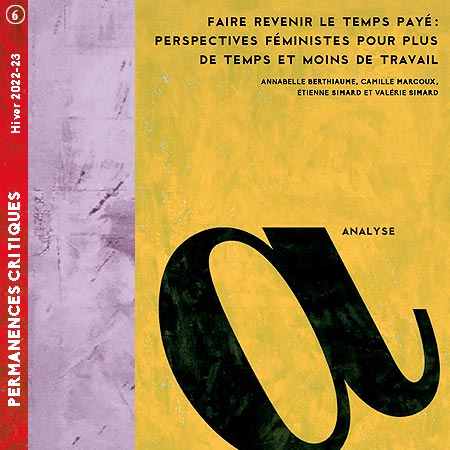
Cette analyse propose de reprendre le vieux mot d’ordre ouvrier « Moins de travail, plus d’argent », comme base d’une vision stratégique pour guider les revendications sociales dans les services publics. Elle s’interroge, à cette fin, sur la convergence entre les luttes pour un salaire
Travail domestique, combat syndical
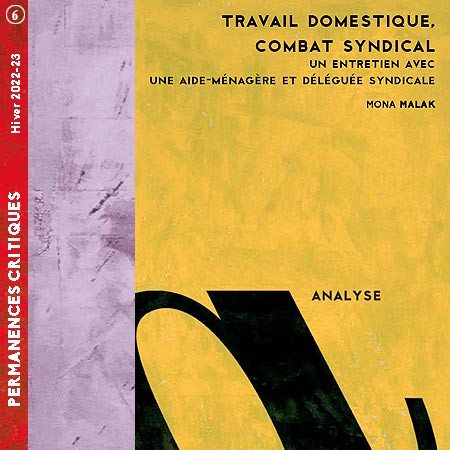
Cet entretien donne un aperçu d’un travail au cœur de la crise de la reproduction sociale : le travail domestique rémunéré. Nous analysons ce dernier à partir du secteur subventionné des titres-services, dans lequel travaillent des aide-ménagères exerçant un emploi subalterne.
Histoire et enjeux du travail des détenus en Belgique
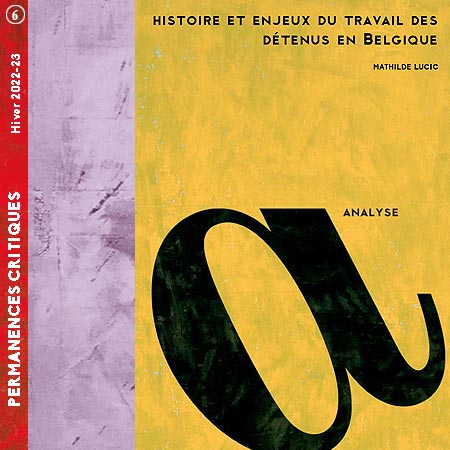
Chaque année, des milliers de détenus travaillent dans les prisons belges pour des salaires largement inférieurs à ceux pratiqués à l’extérieur. La mise au travail des détenus n’est pas récente : elle est historiquement liée à
Ne jetons pas le travail avec l’eau de la critique
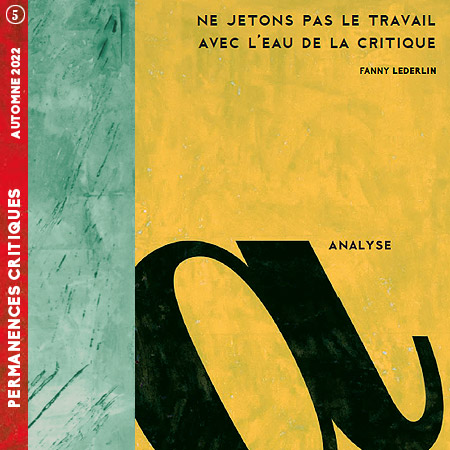
Quarante ans de néolibéralisme ont transformé le travail, qui se caractérise aujourd’hui par l’atomisation, la tâcheronisation et la nomadisation des travailleurs. Mais la crise du covid-19 a réveillé la critique du travail, y compris de la part d’une partie des travailleurs. Une critique qui semble rejeter les contraintes collectives du travail,
De l’administration électronique à la privatisation numérique
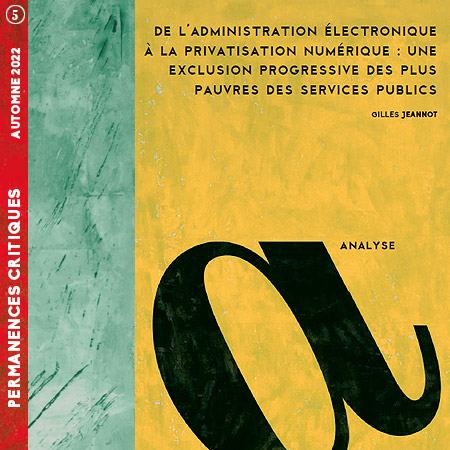
Le passage d’un accueil au guichet et de démarches administratives sur papier à des services en ligne est un processus qui s’est déployé sur plusieurs années. Nous vivons aujourd’hui la dernière phase de généralisation de ces démarches. Il devient nécessaire alors de prendre en compte ceux qui sont les plus éloignés des pratiques
Quand le digital s’attaque au travail social

Lorsque ce sont les travailleurs des services et des administrations publiques qui passent au télétravail, on assiste à une digitalisation du guichet social aux effets délétères. Alors que les travailleuses et travailleurs sociaux sont forcés de devenir officieusement des sous-traitants des services qui refusent dorénavant de prendre en charge l’accueil et l’accompagnement des usagers
Résistances tactiques en contexte de travail numérique
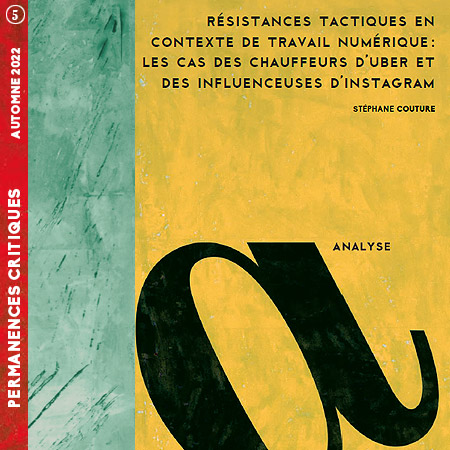
Cet article vise à souligner l’importance d’analyser des formes tactiques de résistance au travail, plus spécifiquement dans le cas de chauffeurs d’Uber et des influenceuses d’Instagram en tant que cas représentatifs de l’économie des plateformes numériques. Je m’attarderai plus précisément ici à une tactique de résistance collective
Les limites de l’individualisation des dominations
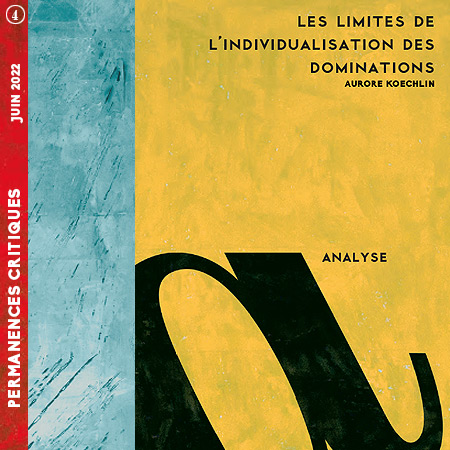
Cette analyse propose une définition et une critique de l’individualisation des dominations qui a cours dans certains usages militants des notions d’intersectionnalité et de privilèges. Que désigne-t-on par une telle « individualisation des dominations » ? Quelles en sont les limites, tant sur un plan théorique que stratégique ?
Par-delà le couple discrimination-privilège
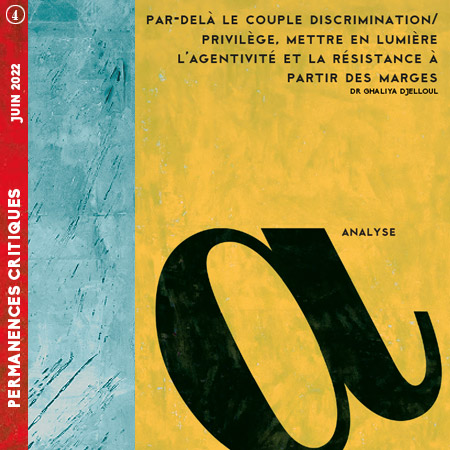
On reproche souvent aux concepts de discrimination et de privilège de ne se concentrer que sur la dimension « micro » ou individuelle des inégalités, alors qu’ils permettent en réalité de nommer l’existence de rapports sociaux et de rendre visible l’effet des structures dans la vie quotidienne. Pour autant, ils ne suffisent pas pour comprendre la manière dont le pouvoir fabrique des subjectivités, ni comment les individus y résistent.
Née de la lutte
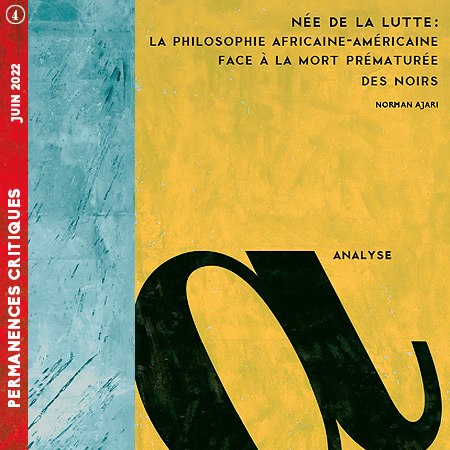
Contrairement à la critique d’autres formes de pouvoir comme le capitalisme ou le patriarcat, la critique du racisme est souvent dépourvue d’une description claire et univoque de l’opération qui définit le racisme en propre. S’opposant à une telle indétermination conceptuelle, cet article s’inspire des philosophes africains-américains contemporains Leonard Harris et Tommy Curry qui définissent le racisme comme fondé sur des opérations d’abrègement de la vie ciblant des populations perçues comme abjectes ou indignes.
Les associations : produit ou ennemi de l’État intégral ?
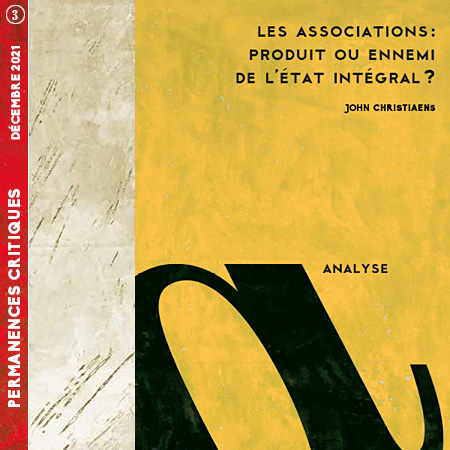
Une compréhension critique de ce qu’est l’État fait défaut à une large échelle, tant dans le débat public que dans les mouvements sociaux en Belgique. Cela fait partie de « l’éclipse du débat stratégique » qu’avait pointée Daniel Bensaïd dès les années 1980. Pourtant, si l’on admet la nécessité impérative pour tout projet conséquent de transformation sociale de poser la question du pouvoir politique des classes dominantes dans la société, on ne peut faire l’impasse sur la problématique de l’État et de notre rapport à lui.
Retour sur un vieux débat entre marxistes qui pourrait nourrir la réflexion sur le rapport entre État et associations
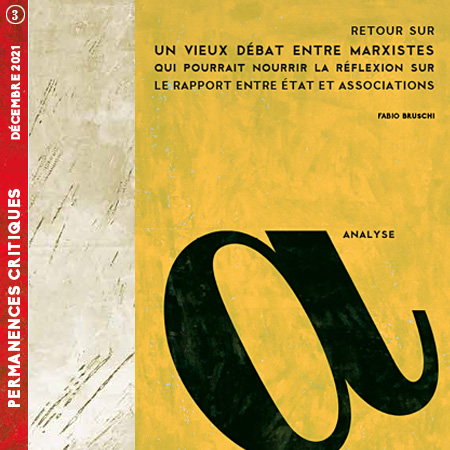
Cette analyse propose une mise en perspective des ambivalences actuelles des rapports du secteur associatif avec l’État à travers la reconstruction du débat, chronologiquement proche mais idéologiquement lointain, entre Louis Althusser et Nicos Poulantzas autour de la question du rapport entre la lutte politique révolutionnaire et l’État.
