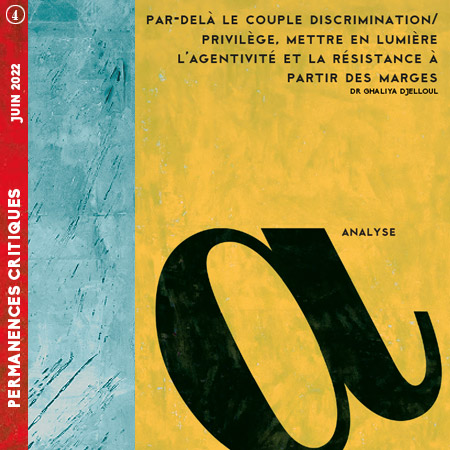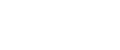Par où commencer pour mener une réflexion critique sur les concepts de « discrimination » et de « privilège » ? En sciences sociales, les concepts fonctionnent comme des lanternes qui éclairent une ou plusieurs facettes des phénomènes observés. Leur pertinence dépend donc du niveau, de l’échelon ou de l’angle que l’on privilégie pour mettre en perspective la réalité sociale. S’il n’y a donc pas de choix de concept qui aille de soi, car « par définition, un concept est toujours un résumé de notions plus larges que l’on essaie de concentrer » en un seul mot[1], en situer les apports et limites permet d’envisager les potentielles articulations à d’autres concepts utiles pour penser différentes formes de domination (de classe, de race, de genre, de sexualité, etc.).
- Énoncer ses privilèges pour les rendre visibles et légitimer la parole des subalternes
« Discrimination » et « privilège » sont des catégories qui indiquent d’emblée l’existence d’une ligne de fracture qui départage des groupes sociaux et fonde un rapport inégal et asymétrique entre eux. Ce rapport de pouvoir, qui s’expérimente à l’échelle la plus micro, est structuré par une domination économique et symbolique au niveau macro. Dénoncer une discrimination, ou rendre visible un privilège, consiste donc à faire état de situations concrètes (se voir ou non couper la parole, contrôler son identité par un agent de police, refuser la location d’un appartement, proposer un entretien d’embauche, etc.) à travers lesquelles se matérialise un rapport de domination qui préexiste et dépasse les acteur·rice·s sociales. Nommer et qualifier ces situations permet de déconstruire le mythe d’une « égalité-déjà-là »[2], d’évoquer en creux les conditions sociales et historiques qui les rendent possibles, et de les problématiser politiquement (non-accès à des droits fondamentaux) en montrant les effets tangibles de systèmes sociaux sur le parcours de vie des individus.
Un des usages fréquemment rencontrés de la notion de privilège dans les milieux militants consiste en une énonciation des propriétés sociales du·e la locuteur·trice, et d’une reconnaissance implicite qu’elles façonnent le contenu et les effets de son discours. « Checker ses privilèges », « se situer » ou « situer son point de vue » fonctionne alors comme un procédé révélateur d’une position sociale plus ou moins visible et lisible (visibilité variable en raison des cas de déplacement entre catégories raciales par exemple, comme dans les cas de racial passing ou de white pass[3]), qui poursuit un double objectif. D’une part, faire apparaître le milieu social d’où provient le discours, rappelant que tout point de vue est situé, c’est-à-dire modelé à partir d’une position sociale particulière. D’autre part, limiter la portée politique du discours en rappelant qu’il émane de l’expérience sociale d’un corps qui appartient à un groupe social spécifique, et qui ne peut prétendre à la généralisation car tous les corps ne font pas l’expérience d’une même vulnérabilité sociale. En principe, ce type d’énoncé mine donc toute possibilité d’universaliser son point de vue : assumer son privilège permettrait, en quelque sorte, de le saboter. Ce faisant, le·la locuteur·trice minimise l’effet symbolique de son discours, et légitime l’expression d’autres points de vue, émanant de groupes subalternes.
En visibilisant un rapport social dont on bénéficie, alors que les lois de reproduction en garantissent l’invisibilité par sa naturalisation[4], l’énonciation de ses privilèges serait donc un premier acte de complicité politique avec les dominé·e·s, le signal d’une prise de conscience et d’une disposition à se remettre en question, bref la trace d’un effort de décentrement. Pour autant, il est important de considérer si cette pratique (voire performance) de l’affranchissement ou de la distanciation des intérêts de son groupe social ne reproduit pas, malgré les apparences, une forme de statu quo[5]. Pour cela, élargissons notre focale à la conception du pouvoir qui sous-tend les catégories de « discrimination » et « privilège », pour déterminer leur portée heuristique (c’est-à-dire jusqu’où nous permettent-elles de penser et comprendre les rapports de domination).
- Se départir d’une conception spatiale du pouvoir pour faire apparaître le rôle des normes dans la constitution des sujets
« Se situer », c’est-à-dire énoncer son positionnement social pour dénoncer des discriminations ou avouer/assumer des privilèges, est une pratique sous-tendue par une représentation substantialiste du pouvoir : forme de « capital » que l’on détient, il définit la position sociale et permet d’accéder à des biens ou services. Cette approche que l’on peut rattacher à une certaine sociologie bourdieusienne donne un rôle surplombant à l’État puisque le fonctionnement des différents champs dépend en dernière instance d’un champ « méta », le « champ du pouvoir », espace de positions à partir duquel s’exerce un pouvoir sur le capital sous ses différentes espèces[6]. Si cette lecture spatiale éclaire particulièrement bien les logiques de reproduction sociale (via les mécanismes d’acquisition, d’accumulation et de transmission des capitaux), elle donne à voir une image quelque peu figée des rapports de domination car elle laisse en contre-champ les marges de manœuvre et dynamiques de résistances quotidiennes déployées par les individus[7].
À l’inverse, on voudrait ici proposer une lecture basée sur les travaux de Michel Foucault, qui renverse la perspective stato-centrée du pouvoir en envisageant la société comme « un archipel de pouvoirs différents »[8]. En effet, le pouvoir (défini comme) capillaire agit à travers une série de réseaux qui traversent la société et sur lesquels celle-ci se forme et se développe, sans pour autant que ce pouvoir ne soit réduit à un champ que monopolise l’État ou à des mécanismes de domination. Aussi, le « champ du pouvoir »[9] est conçu comme un domaine d’actions, qui génère des effets, et dont il faut analyser les modalités d’exercice. Le pouvoir, ainsi « exercé » ou « effectué », est ancré dans sa matérialité, et localisable à travers des réseaux et des nœuds dont il s’agit de comprendre l’effectivité.
Cette dernière n’est plus comprise comme découlant uniquement du poids des structures, mais est également évaluée à partir de la pratique des individus, à travers la manière dont le pouvoir gouverne leur conduite. Le concept de « gouvernementalité », résumé par Judith Butler comme « l’art de gérer les choses et les personnes »[10], est central dans l’approche de Foucault pour comprendre les institutions, les procédures et les tactiques qui structurent de manière spécifique le champ d’action des individus[11]. Par-delà cette forme de gouvernement, il nous invite également à prendre en compte l’« équilibre entre les techniques qui assurent la coercition et des procédures par lesquelles le soi se construit et se modifie lui-même », sans les dissocier enfin du savoir qui a un pouvoir incitatif pour orienter les conduites collectives.
Il ne s’agit donc pas de déterminer qui détient le pouvoir mais comment il s’exerce : « à travers quel système d’exclusion, en éliminant qui, en créant quelle division, à travers quel jeu de négation et de rejet, la société peut-elle fonctionner ? »[12]. Le pouvoir est ici conçu de manière relationnelle, comme quelque chose qui circule et peut se retourner. Aussi, comprendre les mécanismes complexes de domination et d’assujettissement des sujets ne peut se faire qu’à partir du bas, en observant son fonctionnement in situ[13].
En considérant par quelles pratiques la gouvernementalité constitue ses sujets et quelles relations stratégiques partagent l’espace social, le (champ du) pouvoir se décline, quant à lui, au pluriel et place le sujet qui se produit à travers lui au centre. Cette attention au « comment » permet de montrer les dispositifs qui agissent, par-delà les individus et en leur for intérieur, dans le processus de constitution des sujets par les normes. En ne s’arrêtant pas au niveau macrosociologique, et en prenant en compte les effets des dispositifs sur les unités sociales les plus microsociologiques, on redonne aussi aux corps et aux subjectivités une possibilité d’agentivité et de résistance aux normes.
- S’ancrer dans les vécus corporels pour comprendre les formes d’agentivité et de résistance
En analysant le pouvoir sous l’angle de son effectivité, on ouvre donc la perception à un champ de possibles, celui des « contre-conduites » spécifiques[14], à savoir moins l’insoumission à une norme que l’affirmation d’une modalité autre d’être gouverné. C’est pourquoi étudier la gouvernementalité, c’est montrer la part active, performative[15] des sujets dans leur travail de subjectivation. Dans ce cadre, les normes ne sont pas seulement prescriptives et restrictives, elles sont aussi constitutives, productives et constructives du sujet. À travers leur prisme, il s’agit de comprendre comment s’opère la subjectivation à travers ce champ de pouvoir, autrement dit : d’une part, comment donne-t-on corps aux normes et les rend-on lisibles en les performant, et d’autre part, comment ces normes modulent-elles les sujets et leur potentielle résistance ou désobéissance à travers leur corporéité ?
Emprunter à Foucault le questionnement de ce que le pouvoir rejette ou relègue à ses marges, afin de mieux analyser les systèmes d’opposition qui structurent la société[16], mais sans reproduire l’exclusion dont font l’objet les exclu·e·s, permet de reconnaître le savoir et la capacité d’action et de résistance des groupes subalternes. Définie par Scott comme les tactiques que mobilisent les individus aussi bien pour survivre que saboter les effets du pouvoir, « surtout dans des contextes où la rébellion est trop risquée »[17], la « résistance quotidienne » s’avère particulièrement complexe à saisir en raison de son caractère dissimulé, tacite et pluriel. Elle n’est pas l’équivalent mais bien une des composantes possibles du concept plus large d’« agentivité », qui réfère à la capacité d’agir des sujets à travers un champ des possibles, mais n’implique pas nécessairement de résistances[18]. Cette dernière pourrait donc être simplement définie comme « une réponse subalterne au pouvoir ; une pratique qui remet en question et qui pourrait miner le pouvoir »[19].
La reconnaissance de la résistance n’est donc pas conditionnée à une forme d’action collective (organisationnelle ou visible) et ne répond pas aux codes de l’engagement militant[20]. Ce concept permet de déporter l’attention des discours (sur le politique) vers les pratiques quotidiennes, comme des formes politiques souterraines, en coulisse, vouées à rester invisibles mais qui n’en produisent pas moins des effets dans le champ du pouvoir en livrant une forme de « participation » à la politique, bien que maintenue à la marge.
Or, la résistance n’est pas uniquement synonyme de transgression d’une norme, mais peut également consister en une manière d’habiter la norme qui en sabote les effets, en la détournant ou en la contournant, pour la rendre moins effective, et décroître son emprise sur le champ des conduites possibles. Cette forme d’agentivité ne peut être perçue lorsqu’on réfléchit à partir du concept de discrimination, car ce dernier mesure l’écart par rapport à une norme, autrement dit il traduit l’expérience d’une personne appartenant à un groupe subalterne comme un manque par rapport à l’expérience de celle appartenant à un groupe privilégié. Ce faisant, on reproduit la centralité de la norme (la masculinité, la blanchité, l’hétéronormativité, etc.), au lieu de partir du vécu des subalternes pour le ramener des marges au centre de la réflexion[21].
Aussi, si le concept de discrimination permet de décrire les conditions sociales qui encadrent les trajectoires et les expériences individuelles, il présente à mes yeux deux limites : d’une part, il ne permet pas de saisir l’expérience incorporée qui en est faite, c’est-à-dire comment la subjectivité est produite à travers la norme et comment cette dernière module l’intelligibilité des vécus corporels des personnes discriminées ; d’autre part, il ne nous apprend rien sur les modalités de résistance à cette norme, c’est-à-dire la manière dont les sujets se constituent à travers, en dépit, voire même contre la violence, par la resignification de leurs expériences vécues. Si le concept de discrimination n’est pas antinomique avec celui d’« agentivité », il est important d’indiquer ses limites pour comprendre comment les deux peuvent s’articuler : quelle norme fonde cette discrimination ? Quel dispositif est mis en place pour la rendre effective ? Quelle forme de rationalité et quel champ des possibles offre-t-elle aux acteur·rices sociales ? Comment cette norme forme-t-elle leur subjectivité ? Quelle grille d’interprétation des vécus corporels offre-t-elle ? Quelles sont les manières d’habiter cette norme, et quelles sont les tactiques qu’iels mettent en place pour la contourner, détourner, transgresser ou la subvertir ?
Conclusion : Tactiques de desserrement et réhumanisation par la non-violence
On ne peut comprendre les concepts sans les replacer dans un cadre théorique plus large, c’est-à-dire en relation à d’autres concepts avec lesquels ils s’articulent. Cela nous permet de contextualiser la spécificité de chaque mise en perspective, et les passages possibles entre elles. La réflexion proposée ici s’est appuyée sur certains usages ou effets de la mobilisation des concepts de discrimination/privilège pour souligner leurs apports, mais aussi éclairer des dimensions de la réalité sociale qu’ils laissent en contre-champ. S’ils constituent des outils puissants pour visibiliser et politiser les effets des structures, ils tendent à évacuer la question de l’effectivité du pouvoir et de la capacité et des modalités de résistance des sujets.
En guise d’illustration d’une approche qui n’évacue pas cette question, les recherches que j’ai menées ces dernières années ont toujours constitué une manière de faire de la place aux expériences des groupes subalternes, m’intéressant à la manière dont les structures fonctionnent in situ et modèlent leurs subjectivités – notamment par la manière dont les violences déréalisent les vécus et déshumanisent les personnes. Mais également les manières dont elles reprennent le pouvoir, résistent, se défendent, défont les liens de peur et de culpabilité, agissent de manière collective pour faire reconnaître leur dignité humaine, notamment par des pratiques non-violentes[22].
Dans ma recherche doctorale[23] par exemple, j’ai souhaité mettre en lumière les tactiques de « desserrement » (relâchement vis-à-vis d’une norme) mises en place par vingt-cinq femmes résidant à Alger, et répondant à une diversité de profils sociaux, pour se dégager de l’emprise de la norme genrée et spatiale de la setra (qui désigne à la fois le mariage et le port d’un voile comme forme de protection et de couverture) qui les assigne/relègue à l’espace domestique. J’ai analysé leurs pratiques de négociation du mouvement avec divers acteurs collectifs (communauté familiale, communauté de voisinage, communauté religieuse) qui veillent à la mise en œuvre de la setra, et qui forment un dispositif d’« enserrement » autour de leurs corps. J’ai également étudié leurs stratégies de résistance à court terme à travers des tactiques de « desserrement », ou à plus ou moins long terme à travers leurs stratégies résidentielles et matrimoniales.
Ma problématique a donc porté sur la « motilité »[24] de mes enquêtées, c’est-à-dire le potentiel et la réalité de leur mobilité spatiale et sociale, en cherchant d’une part à comprendre les contraintes qui s’exercent sur leurs mouvements à travers les espaces, et d’autre part les stratégies qu’elles développent pour disposer de leur corps en tant que femmes à partir d’une variété de positions sociales (âge, statut marital, classe, race). Je m’intéresse donc au caractère construit de la réalité matérielle[25], en accordant une attention particulière à la matière que constituent les corps[26] (quelles places attribue-t-on aux corps subalternes, et quelles techniques sont déployées pour les inciter à y rester ?), et à toutes les formes de résistance non-violente qui leur permettent de se dégager, de se déployer, de faire reconnaître leurs vécus et d’affirmer la dignité de leur existence.
L’intérêt ainsi porté à la formation du pouvoir et ses structures internes, « y compris voire surtout dans le rapport à soi »[27], me conduit à chercher des traces de changement social non seulement dans la base matérielle des rapports sociaux, mais également dans les transformations résultant des contradictions internes aux systèmes de domination, par des formes de transitions locales qui modifient l’effectivité des rapports de pouvoir. C’est précisément ce que le couple conceptuel discrimination/privilège ne permet pas suffisamment de faire : saisir le caractère dynamique et relationnel du pouvoir, porter attention à sa capillarité fine jusqu’au point le plus local de la formation des subjectivités, et prendre en compte de façon centrale la capacité des subalternes de retourner le pouvoir en affirmant d’autres modalités d’être gouvernés.
- [1] Parini Lorena, Le système de genre. Introduction aux concepts et théories, Zürich, Seismo, 2006, p. 23.
- [2] Delphy Christine, « Le mythe de l’égalité-déjà-là : un poison ! », conférence prononcée à l’Institut de recherches et d’études féministes (iref), 11 octobre 2007, visionnable sur la chaîne YouTube RéQEF, URL : https://youtu.be/oymTQ5mrr9M, consulté le 03 mai 2022.
- [3] Le racial passing fait référence à des individus dont l’apparence sociale est ambiguë sur le plan racial, leur permettant d’accéder à certains privilèges dans des contextes donnés. Le white pass indique la capacité à brouiller ou traverser des frontières raciales.
- [4] Guillaumin Colette, Sexe, Race et Pratiques du pouvoir. L’idée de nature, Paris, Éditions iXe, 2016.
- [5] C’est l’objet d’une contribution de la philosophe Sara Ahmed qui analyse six types de « déclarations de blanchité » fréquemment rencontrées dans la lutte anti-raciste, et les différentes manières dont elles participent à produire un sujet prétendument éduqué, déconstruit et conscient, sans modifier les conditions réelles de (re)production du racisme : Sara Ahmed, « Déclarations de blanchité : la non-performativité de l’antiracisme », Mouvements, 14 décembre 2020, URL : https://mouvements.info/declarations-de-blanchite-la-non-performativite-de-lantiracisme/, consulté le 03 mai 2022.
- [6] Bourdieu Pierre, Sur l’État. Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil, 2012 ; Lenoir Rémi, « L’État selon Pierre Bourdieu », Sociétés Contemporaines n° 87, 2012, pp. 123-154.
- [7] Pour une critique similaire de l’approche substantialiste du pouvoir comme « capital » véhiculée par un certain usage de la notion de privilèges, on peut également voir l’étude de Jean Matthys dans le dossier du présent numéro.
- [8] Foucault Michel, « Les Mailles Du Pouvoir » (1981), Dits et Écrits II, Paris, Gallimard, 1994, p. 187.
- [9] Ibid
- [10] Butler Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, Paris, La Découverte, 2005.
- [11] Foucault Michel, « La Gouvernementalité » (1978), Dits et Écrits III, Paris, Gallimard, 1994, pp. 635-667.
- [12] Eribon Didier, Michel Foucault, Paris, Flammarion, 1991, p. 331.
- [13] Foucault Michel, “Il faut défendre la société”. Cours au Collège de France (1976), Paris, Seuil, 1997.
- [14] Foucault Michel, « La Gouvernementalité », op. cit.
- [15] Butler Judith, Défaire le genre, Paris, Éd. Amsterdam, 2006 ; Butler Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 2006.
- [16] Foucault Michel, Naissance de la clinique. Une archéologie du regard médical, Paris, PUF, 1963.
- [17] Scott James C., Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts, New Haven, Yale University Press, 1990.
- [18] Johansson Anna et Vinthagen Stellan, « Dimensions of Everyday Resistance: An Analytical Framework », Current Sociology, n° 42, 2014, pp. 414-435.
- [19] Vinthagen Stellan et Liljan Mona, « Resistance », in Anderson Gary L. et Herr Kathryn G., Encyclopedia of Activism and Social Justice, Thousand Oaks, Sage, 2007, p. 1.
- [20] Ion Jacques, La fin des militants ?, Paris, L’Atelier, 1997.
- [21] Véronique Clette-Gakuba écrit en ce sens : « Il n’est pas difficile de sentir que le concept de “privilège blanc” provient d’un milieu social éloigné de la réalité des mondes noirs. Depuis son prisme, l’existence noire est comprise par la négative, par le manque, par l’absence de ce qui, à l’inverse, comble les vies blanches. Il faut à cette théorie une comparaison presque comptable, qui ramène tout à soi, pour arriver à cerner les affres des vies noires. Premier problème donc : la normativité au centre de la théorie des privilèges est blanche et, de ce fait, sa perspective critique tend vers un modèle intégrationniste (promotion d’un alignement sur les privilèges blancs positifs). Cette épistémologie comptable de la blancheur/noirceur n’appréhende rien sur le mode actif, situé, de ce qui fait la race, de ce que la race fait faire » (Clette-Gakuba Véronique, « Réflexions et problèmes sur la question des allié.es blanch.es », billet de blog hébergé sur Le Club de Mediapart, 1er décembre 2021, URL : https://blogs.mediapart.fr/plis/blog/011221/reflexions-et-problemes-sur-la-question-des-alliees-blanches, consulté le 19 avril 2022).
- [22] Butler Judith, « Interprétation de la non-violence », in Botbol-Baum Mylène (dir.), Judith Butler, du genre à la non-violence, Nantes, Éd. Cécile Defaut, 2017, pp. 84-98.
- [23] Défendue en octobre 2020 à l’UCLouvain, ma thèse s’intitule « Setra, entre dispositif d’enserrement et tactiques de desserrement : lecture genrée et spatiale du “champ du pouvoir” en Algérie par l’analyse de la “motilité” de femmes résidant à Alger ».
- [24] Kaufmann Vincent et Jemelin Christophe, « La motilité, une forme de capital permettant d’éviter les irréversibilités socio-spatiales ? », in Séchet Raymonde, Garat Isabelle et Zeneidi Djemila (dir.), Espaces en transactions, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 83-91.
- [25] Cervulle Maxime et Clair Isabelle, « Lire entre les lignes : Le féminisme matérialiste face au féminisme poststructuraliste », Comment S’en Sortir ?, n° 4, 2017, pp. 1-22.
- [26] Butler Judith, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du « sexe », Paris, Éd. Amsterdam, 2009, pp. 39-68.
- [27] Cervulle et Clair, op.cit., p. 13.