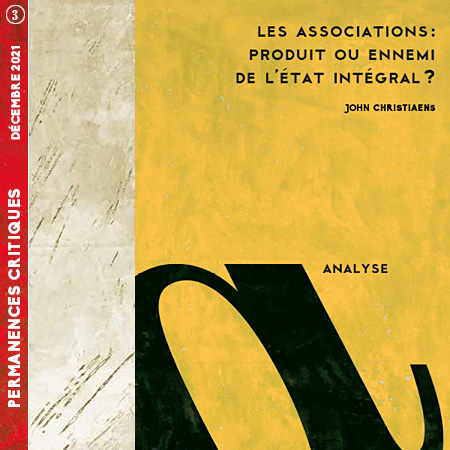L’État, centaure au service des classes dominantes
D’abord, rappelons que l’État est un produit de la division sociale du travail[1], de la division en classes sociales et des contradictions qui en résultent. Dès le moment où des surplus peuvent être captés par une partie de la population et où une différenciation des tâches s’opère, certaines fonctions de pouvoir, tant sur le plan idéologique (ex : les prêtres) que répressif (ex : armée, justice), vont être retirées à la collectivité et se retrouver entre les mains d’une petite partie de la population, la classe possédante. L’État a pour fonction de pacifier la société divisée en classes aux intérêts opposés. L’Etat moderne est ainsi « placé en apparence au-dessus » de la société et « de plus en plus étranger »[2] à elle.
Au XIXème siècle, le mouvement ouvrier est confronté de plusieurs manières au débat sur l’État. Ainsi, Marx et Engels tirent ce bilan de la Commune de Paris : « La Commune, notamment, a démontré que la « classe ouvrière ne peut pas se contenter de prendre la machine de l’État toute prête et de la faire fonctionner pour son propre compte » »[3]. Quelques années plus tard, en Allemagne, Rosa Luxembourg met en garde ses camarades contre les dérives réformistes dans la social-démocratie par rapport à l’État bourgeois : « Avec l’entrée d’un socialiste dans le gouvernement, la domination de classe continuant à exister, le gouvernement bourgeois ne se transforme pas en un gouvernement socialiste, mais un socialiste se transforme en un ministre bourgeois…»[4]. Dans le feu de la révolution russe, Lénine poursuit[5] : « toutes les révolutions antérieures ont perfectionné la machine de l’État ; or il faut la briser, la démolir ». La contre-révolution bureaucratique en Union soviétique transformera ce programme en son contraire.
Cette question sera travaillée dans le contexte d’un État bourgeois occidental par le dirigeant communiste italien Antonio Gramsci, dans ses Cahiers de prison. Pour Gramsci, l’État au sens large, c’est, d’une part, ce qu’il appelle la « société politique », qui comprend l’appareil répressif et administratif de l’État au sens strict du terme, et d’autre part, la « société civile », composée à la fois des institutions culturelles, associations, médias, du système scolaire et universitaire, mais aussi des syndicats et des partis. L’État peut donc être défini en fin de compte, à l’image du centaure[6], comme « l’hégémonie cuirassée de coercition »[7], c’est-à-dire comme un système complexe alliant des formes de persuasion et d’organisation du consentement à des formes ouvertement répressives, le tout servant à maintenir l’ordre social au service d’une classe, capable de diriger les autres classes sociales et de leur faire adopter comme évidente sa vision du monde, guidée par ses intérêts.
Gramsci nous aide à réaliser qu’aucune société ne peut reposer de façon stable uniquement sur la coercition. La production du consentement, les manières d’associer les dominé.e.s à leur domination, et face à cela les manières de rompre activement avec celle-ci, de démolir le sens commun bourgeois, doivent donc être comprises par les forces qui visent une transformation révolutionnaire. Comment la classe dominante, qui n’est d’ailleurs pas un bloc parfaitement et toujours homogène, peut-elle aussi être classe dirigeante ? Comment produit-elle suffisamment de confiance et de passivité de la part des classes subalternes ? C’est à cet endroit qu’intervient le rôle de la société civile, dont le secteur associatif et les syndicats vont nous intéresser tout particulièrement pour la suite de notre raisonnement. En nous concentrant principalement sur la Belgique, nous y aborderons le rôle de la pilarisation, de la concertation sociale mais aussi les origines, l’histoire et les transformations du secteur associatif, le problème d’une posture apolitique de contre-pouvoir afin de proposer, pour terminer, l’actualisation des concepts de « guerre de position » et de « front unique ».
L’héritage d’une société pilarisée et le crépuscule de la concertation
Le sociologue Sébastien Antoine a utilisé l’expression gramscienne d’« État intégral modèle » en parlant de la Belgique[8]. La notion d’État intégral signifie que l’État et la société civile en sont arrivés à un point d’intrication tel qu’ils ont en quelque sorte fusionné en une seule entité. Effectivement, on peut considérer que la Belgique, bien plus que la France ou la Grande-Bretagne par exemple, a réalisé cette « osmose » par la façon dont la société politique et la société civile ont répondu aux différentes tensions et clivages structurant le pays. Une illustration frappante de ce processus historique est l’émergence et la place accordée traditionnellement aux « piliers » dans notre système politique et social. En Belgique, les rapports de forces sur les axes des clivages historiques autour de la place de l’Eglise catholique, de l’affrontement capital-travail, puis du problème communautaire ont mené à l’avènement de plusieurs piliers, social-démocrate, chrétien et libéral, ensuite divisés en partie sur une base linguistique.
Ces piliers regroupent des ensembles d’organisations qui visent à exercer une influence sur la société et l’État : partis, syndicats, mutualités, associations de femmes, de jeunes, centres de vacances, pôles financiers, ONG de solidarité internationale, organisations d’éducation permanente, écoles, universités, associations culturelles et sociales, etc. Ils ont monopolisé la vie politique pendant la majorité du XXème siècle. Renforcés par le Pacte social et la pérennisation de la gestion des allocations de chômage et de maladie par les syndicats et mutuelles, leurs principales organisations de masse, ils sont les acteurs principaux du grand jeu de la concertation sociale, démarrée avant-guerre avec les premières grandes conquêtes sociales, puis institutionnalisée et alimentée après-guerre par la forte croissance économique des « Trente glorieuses ».
L’influence de ces piliers commence à décliner à partir des années 1970-80, en raison du détachement d’une partie de la nouvelle génération de ces « vieux piliers » et du développement de mouvements pluralistes et décloisonnés. La machine de la « concertation » commence à se gripper : il n’y a pas d’accord interprofessionnel (AIP) jusqu’au milieu des années 1980 et les gouvernements Martens-Gol avancent à coups de pouvoirs spéciaux. Divisés sous l’effet de la poussée vers le fédéralisme, les trois partis historiques sont concurrencés à la fois par l’émergence de formations communautaires, comme le FDF et la Volksunie puis le Vlaams Blok, et par celle des partis verts. Avec la percée en 2014 des listes unitaires PTB-Gauche d’ouverture, c’est le PTB, leur principale composante, qui s’installe dans le paysage et vient renforcer la fragmentation partisane dans les Parlements, ainsi que la polarisation politique. Mais cette fois la polarisation se produit à gauche (et au détriment) de la social-démocratie et des verts : ceux-ci appliquent en effet depuis les années 1980, la plupart du temps avec entrain ou sans broncher, les fondamentaux du capitalisme néolibéral.
Si les piliers historiques reculent après la déclinaison belge du « grand bond en arrière »[9] néolibéral, la « concertation » va reprendre entre organisations représentant des classes sociales aux intérêts opposés. Mais les règles du jeu ont changé : l’institutionnalisation d’une forme de cooptation et de concertation permanente avec une série d’acteurs syndicaux et sociaux dans l’élaboration et la mise en place de réformes se fait dans un contexte de plus en plus limitant. La contrainte est liée, d’un côté, à l’austérité permanente, préalable à l’entrée puis au maintien de la Belgique dans la zone euro et, d’un autre côté, à l’offensive patronale elle-même : les patrons viennent avec leur propre cahier de revendications afin de restaurer leurs taux de profit et peuvent également compter sur le soutien en dernière instance des gouvernements pour faire passer leur programme libéral.
Sous le gouvernement Di Rupo entre 2011 et 2014, les salaires sont à nouveau bloqués, une nouvelle contre-réforme des prépensions a lieu et les allocations d’insertion pour les jeunes sans-emploi sont attaquées. Tout cela provoque des remous au sein de la FGTB, dont la branche carolorégienne va tenter, dans les années qui suivent, de regrouper les forces à gauche du PS et d’Ecolo, telles que le PTB et la LCR (ancien nom de la Gauche anticapitaliste) pour faire percer une alternative politique de gauche, qui deviendra PTB-GO. En 2014, le gouvernement Michel-Jambon lance ses attaques antisociales avec notamment le report de l’âge de la pension à 67 ans. De larges coupes budgétaires ont lieu en Flandre dans le secteur associatif et culturel, provoquant l’émergence d’un nouveau mouvement social, « Hart boven Hard ». Un pendant francophone, « Tout autre chose », va également voir le jour, moins bien implanté, en l’absence d’une attaque frontale et massive de la part du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. La vague de manifestations et de grèves qui suit est impressionnante. Le 15 décembre 2014, le pays est à l’arrêt… et les directions de la FGTB et de la CSC déclarent l’armistice pour « donner une chance à la concertation ». Elles participent début 2015 à un simulacre de discussion sur des aspects secondaires et sabordent elles-mêmes le rapport de forces qu’elles avaient contribué à favoriser, résultant d’un plan d’actions allant s’amplifiant et de revendications concrètes. Cette grande bataille perdue par capitulation en rase campagne va laisser des traces durables sur la conscience de milliers de militant.e.s des syndicats.
Il s’agit probablement d’un exemple paroxystique de la façon dont les piliers et la concertation sont capables d’absorber les chocs et la résistance sociale et de la faire échouer sur leurs bancs de sable, tant qu’elle ne parvient pas à s’auto-organiser indépendamment de directions syndicales coincées dans leur impasse stratégique. Mais si les organisations traditionnelles du mouvement ouvrier institutionnalisé sont encore capables de canaliser la colère sociale à différents niveaux, elles y perdent elles-mêmes en légitimité et en implantation sociale : le taux de syndicalisation, après avoir longtemps été l’un des plus solides du monde, a commencé à baisser en Belgique. En outre, les grèves lycéennes pour le climat, les mobilisations féministes ou encore celles contre les violences policières de ces dernières années ont émergé en-dehors des associations historiques liées à ces enjeux.
L’ambivalence du secteur associatif
On l’a dit, les piliers ont produit ou intégré une partie non négligeable des différentes branches de l’associatif social et culturel : cela va de la petite ASBL d’insertion socio-professionnelle, jusqu’à telle grande association d’éducation permanente, en passant par le secteur de l’alphabétisation ou, suivant une conception large du non-marchand, une bonne partie du secteur des soins. Les ASBL sont le fruit contradictoire de grandes batailles menées par le mouvement des travailleur.se.s. C’est dans la foulée de la victoire concernant la liberté d’association syndicale et la journée de travail des 8 heures, en mai et juin 1921, que des lois sont votées pour encadrer les associations, les établissements d’utilité publique et les « œuvres complémentaires à l’école », dans l’optique d’accompagner le temps libéré pour les loisirs ouvriers, avec une approche qui combine émancipation et paternalisme. Dans les années 1970, les concepts de « loisirs culturels » puis d’« éducation permanente » sont mis en avant par les pouvoirs publics, avec pour objectif de ne plus « se limiter » à la classe ouvrière. Le secteur associatif et ce qui deviendra plus tard l’éducation permanente représentent donc une conquête des luttes sociales qui permet de mener une série d’activités avec une reconnaissance et des moyens supplémentaires, et en même temps une concession des autorités, dans le but d’institutionnaliser, de pacifier les conflits sociaux et d’avoir un droit de regard sur les associations.
Une raison supplémentaire permet d’expliquer cet essor du secteur associatif. Comme le souligne Louise Fonceny : « à partir des années 1970, les ASBL connaissent un véritable essor, car pour limiter les dépenses publiques, l’État va transférer les missions qui incombent au service public, et donc aux fonctionnaires, vers le secteur associatif. (…) En Belgique, ce démantèlement néo-libéral s’est fait en parallèle avec la communautarisation et la fédéralisation de l’État, et donc le morcèlement des services et des budgets »[10]. Ce phénomène est renforcé par les nouveaux mouvements sociaux, féministes, LGBT, antiracistes, écologistes qui émergent en dehors du mouvement ouvrier « et connaissent les mêmes processus d’institutionnalisation (planning familiaux, MRAX, maisons des femmes, Inter-environnement, Maison Arc-en-Ciel) »[11]. Ce secteur associatif foisonnant va donc servir de sous-traitant à bon marché pour un État néolibéral qui réduit son intervention directe, organise l’austérité permanente des « enveloppes budgétaires fermées », comme celles des matières gérées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont l’enseignement, la culture et l’éducation permanente, et enfin définance et réduit les prestations de la Sécurité sociale, par une baisse massive des cotisations patronales. La Belgique devient un « État social actif », qui renverse la logique assurantielle universelle du compromis de 1944 pour aller vers « l’activation », c’est-à-dire la conditionnalité des droits sociaux, assortie de contrôles et de sanctions. Les piliers et l’associatif deviennent alors des amortisseurs des reculs sociaux, dont ils doivent ralentir le rythme.
Les budgets structurels alloués aux ASBL sont ensuite petit à petit remplacés par des budgets « par projet », pour faire de nouvelles économies. Elles sont contraintes de chercher leurs financements en étant de plus en plus contrôlées et obligées de se justifier, dans un contexte d’hyper-compétition entre associations pour obtenir des moyens raréfiés et liés à des commandes précises, qui favorise les organisations « installées » et soutenues par des partis institutionnels, indépendamment de leur enracinement dans les nouvelles luttes. « Elles perdent ainsi encore plus d’autonomie dans la capacité à maîtriser leur propre agenda et à effectuer un travail de fond sur le temps long, tout en étant confrontées à un public de plus en plus broyé par les difficultés »[12]. Les emplois dans le secteur sont précaires, mal payés au vu du niveau de qualification exigé et composés de contrats « d’activation » des allocataires sociaux, de type ACS, article 60, ou de stagiaires, dans un secteur composé à 70% de travailleuses : le non-marchand « exige des qualités qui incombent socialement aux femmes : le dévouement, l’accompagnement, l’écoute, l’empathie, le soutien ou le soin à la personne, la pédagogie »[13]. Qu’à cela ne tienne, le nouveau code des sociétés belges entré en vigueur en 2020 permet aux ASBL d’exercer des « activités commerciales illimitées », à condition de « ne pas distribuer leurs bénéfices ». Nous sommes bien loin de 1921 et l’associatif est encouragé à se transformer en « entrepreneuriat social ».
Beaucoup d’ASBL fonctionnent donc comme des petites entreprises de services, bien que leur objet soit social, culturel ou d’éducation permanente. Elles n’échappent pas au lien de subordination salarial existant entre les travailleur.se.s et la direction, incarnée soit par des coordinateur.rice.s également sous la contrainte du contexte évoqué ci-dessus, soit par un conseil d’administration qui comprend souvent des représentant.e.s d’un ou plusieurs piliers, y compris dans la nébuleuse autour d’Ecolo. En même temps, il n’y a pas de vrai « patron » (le directeur ? le C.A. ? le(s) pouvoir(s) subsidiant(s)?), donc pas de vrai responsable. La lutte des classes est « brouillée ». Plus encore que dans une PME classique, travailleur.se.s, coordinateur.rice.s et C.A. doivent travailler « de concert » pour un « but commun ». On est loin d’une relation entre un mouvement social d’en bas ou une base militante active et une direction dûment mandatée et contrôlée par cette base, plus loin que dans le mouvement syndical lui-même, pourtant caractérisé par une bureaucratisation avancée. On retrouve souvent dans l’associatif une mini-bureaucratie, un mini-appareil, sans base sociale : une annexe de l’État déconnectée de tout mouvement réel. Le secteur associatif peut alors impliquer une forme de professionnalisation, voire d’étatisation du militantisme, qui aboutit à des déformations telles que les discours en faveur de la rémunération pour toute forme d’intervention militante ou politique[14], discours qui soulignent aussi une forme d’impasse stratégique : faute de capacité à mobiliser massivement, on prend son travail pour du militantisme et on se profile individuellement sur tel ou tel enjeu pour chercher une source de revenu ou de carrière… une marchandisation de l’engagement qui cadre avec l’idéologie néolibérale et avec l’esprit entrepreneurial favorisés par les pouvoirs publics. Il n’y a donc pas de paradis démocratique associatif. Les travailleur.se.s du secteur sont pris en tenaille entre le manque de moyens et donc de temps, et la culpabilité liée à leur objet social, culturel, éducatif, c’est-à-dire à un travail censé être désintéressé, dévoué. Ajoutez à ça la mise en œuvre des nouvelles techniques de gestion des « ressources humaines » et vous obtenez la recette pour l’explosion des burn-outs.
Enfin, nous constatons encore un autre problème, aggravé par les défaites du mouvement des travailleur.se.s ainsi que le recul de la conscience de classe, qui a été décrit en son temps par Ralph Miliband :
Tant que les fondements économiques de l’ordre social ne sont pas contestés, la critique, si dure soit-elle, peut se révéler très utile pour cet ordre social, dans la mesure où elle permet des débats et des controverses acharnés, mais en fait sans danger[15].
Une apparence d’autonomie peut dissimuler d’autant mieux l’appartenance des organisations au système de pouvoir, si bien qu’il reste extrêmement difficile pour une association dépendante des financements publics ou privés de défendre ouvertement une approche conséquente de lutte frontale contre le capitalisme, son État et les oppressions sur lesquelles ils s’appuient (hétéro-sexisme, racisme, validisme, etc.), non seulement en discours, mais aussi en actes. Cette forme de critique, qui glorifie la position de « contre-pouvoir » associatif et refuse de s’intéresser à la question des conditions de possibilité d’une alternative politique d’ensemble, aboutit bien souvent, et ce n’est pas le moindre des paradoxes, à préserver le statu quo politique et la place des appareils sociaux-libéraux dominants dans l’associatif francophone, c’est-à-dire le PS, Ecolo et le Cdh. Bon nombre des directions de l’associatif sont liées à ces mêmes partis, voire font des aller-retours entre associatif et cabinets ministériels. Les associations reçoivent des injonctions « amicales » pour les inciter à la patience et la compréhension envers les « relais politiques », des injonctions parfois intériorisées par les directions concernées. Avec le « modèle de concertation », le PS et Ecolo constituent, par leur capacité de cooptation et de démoralisation, la « tombe des mouvements sociaux »[16]. C’est ainsi qu’en séparant le social du politique (connoté comme impur), on se retrouve à favoriser les mêmes forces politiques dont on passe tant de temps à critiquer les insuffisances, voire les trahisons.
Cela démontre que le secteur associatif, enfant de luttes et de victoires passées, n’échappe pas à la règle selon laquelle nos conquêtes sociales restent des cristallisations fragiles et périssables d’un rapport de forces. Avec la dégradation du rapport de forces, nos outils peuvent être neutralisés par une série de contre-réformes, jusqu’à servir nettement le maintien de l’ordre existant. Une réponse des anticapitalistes à ces problèmes serait de défendre un secteur associatif qui soit à la fois « fort, public, massivement refinancé et organisé en autogestion démocratique des travailleur.se.s et des publics concernés »[17].
Guerre de position et front unique
Est-ce pour autant que le secteur associatif ou les syndicats n’auraient aucun rôle à jouer dans la composition d’une stratégie révolutionnaire pour la Belgique du XXIème siècle ? Rien n’est moins sûr. Mais alors, avec quelle approche travailler dans et avec le secteur associatif, quand on est militant.e anticapitaliste et révolutionnaire ? Pour répondre à cette question, nous devons revenir à la « guerre de position »[18] évoquée par Gramsci, mais aussi à la notion, fondamentale chez les marxistes révolutionnaires, de « front unique ».
L’État intégral à la belge reste un État au service de la classe capitaliste. Sa structure faite de multiples acteurs, des deux côtés de la frontière linguistique, habitués à se concerter et se consulter régulièrement, à travers les liens des restes des grands piliers avec l’appareil gouvernemental, combinée à la force de la Sécurité sociale, forment un amortisseur de crise assez impressionnant. Nous l’avons constaté en 2008 lors de la crise économique et financière globale, puis à nouveau lors de la crise du Covid19. Leurs effets ont été différés et dilués. Mais les dernières décennies ont affaibli ce modèle, qui ne produit plus globalement que des régressions sociales : les forces systémiques traditionnelles (« socialistes », chrétiens et libéraux) ont perdu leur emprise sur le parlement et le système politique grippé a des difficultés à fonctionner. Il en a été ainsi, par exemple, lors des deux dernières longues crises politiques, de 2010-2011 et 2019-2020, qui ont eu pour effet de retarder certaines contre-réformes néolibérales pourtant ardemment voulues par le patronat. Il n’y a pas eu non plus d’accord interprofessionnel substantiel depuis 2008. Un autre symptôme de ce recul du consentement de la population s’observe dans le renforcement, depuis une vingtaine d’années, des moyens légaux de surveillance et d’intervention de la « main droite de l’État » : la police et les forces de répression. Pour maintenir son hégémonie, la classe dominante doit aussi lâcher du lest et améliorer les conditions de vie matérielles des subalternes. Quarante ans de régressions néolibérales ont fortement érodé cette possibilité.
Malgré leur affaiblissement, les deux principaux syndicats et mutuelles, ainsi que le secteur associatif constituent des points d’appui dans la guerre de position. Le mouvement ouvrier et le secteur associatif sont traversés de tensions internes, sur lesquelles nous devons nous appuyer pour favoriser des blocs basés sur l’indépendance de classe[19], qui soient combatifs tant sur le plan programmatique qu’au niveau des modalités d’actions. Cela nécessite de lutter contre les illusions de la concertation et ses avatars. Pour combattre l’idéologie dominante qui s’incarne aussi dans des organisations institutionnalisées, nous ne pouvons négliger les différences d’orientation, les rapports de forces à l’intérieur de celles-ci, ainsi que les marges de manœuvre et les fenêtres d’opportunité qui peuvent s’ouvrir lorsque ces rapports se modifient. Il est nécessaire de combiner la guerre de mouvement et la guerre de position, dans le but d’éroder les digues qui protègent l’État et le système économique. C’est même indispensable pour éviter l’embourbement dans le marais de la marginalité et de l’entre-soi gauchistes. Les syndicats, en particulier, restent de loin les principales organisations de travailleur.se.s avec une implantation de masse qui leur donne une capacité de blocage de l’appareil productif capitaliste incomparable avec n’importe quel autre acteur social en Belgique. Aucune force politique anticapitaliste sérieuse ne peut se permettre de snober le débat sur l’état du mouvement syndical et sur la politique à mener vis-à-vis de ses différentes composantes.
Une organisation d’éducation permanente ne peut faire la révolution, cela va sans dire. Mais pour autant que son approche soit celle de l’éducation populaire, elle peut se mettre au service de la guerre de position et de l’indépendance de classe, et ainsi faire émerger des intellectuel.le.s organiques et des cadres pour ces luttes. Elle doit pour cela impérativement oser travailler avec et sous la direction de mouvements sociaux auto-organisés, par en bas. Dans ces luttes, il est nécessaire de sortir des revendications vagues qui démobilisent et permettent la récupération facile. Une association peut également jouer un rôle dans le travail de lutte idéologique contre la classe dominante, pour faire émerger un autre sens commun. Enfin, à ces conditions, elle peut constituer, avec son expertise, l’une des infrastructures de la contestation, comme point d’appui à côté des partis et syndicats combatifs, des médias critiques, etc.
Plus largement, l’associatif peut jouer un rôle intéressant dans des formes contemporaines de « front unique » élargi. Le front unique est une notion mise en avant par les communistes révolutionnaires, en particulier dans les années 1920 et 1930, lorsqu’il s’agissait de peser sur une situation sociale et politique de reflux après la vague révolutionnaire post-1917 et lorsque la lutte antifasciste était à l’ordre du jour pour la survie même du mouvement ouvrier. L’idée est de regrouper les travailleur.se.s et les organisations réformistes et révolutionnaires du mouvement ouvrier pour frapper ensemble l’ennemi (que ce soit la bourgeoisie ou le fascisme), tout en maintenant l’autonomie revendicative, politique et organisationnelle des composantes du front et le libre débat public entre elles, selon l’adage « marcher séparément, frapper ensemble ». Un des points clés de ce front est l’indépendance de classe par rapport à la bourgeoisie, à la différence des « Fronts populaires ». À terme, cette démarche, opposée au sectarisme autant qu’à la collaboration de classe, doit convaincre de la supériorité de la stratégie et des organisations révolutionnaires.
Les luttes en Belgique, les composantes des mouvements sociaux et des gauches combatives de 2021 justifient la nécessité d’un aggiornamento du front unique[20]. Rappelons quelques exemples récents que nous avons soutenus et qui illustrent ces possibilités : le rôle déjà évoqué de Hart boven Hard/TAC en soutien, avec la gauche radicale, au mouvement syndical de 2014. En 2018-2019, d’autres alliances regroupant des secteurs syndicaux, des associations et des mouvements par en bas plus ou moins massifs et/ou auto-organisés ont vu le jour : les grèves pour le climat appuyées ponctuellement par des associations environnementales, par des branches des syndicats, et à nouveau la gauche radicale[21], mais aussi le mouvement pour la grève des femmes autour du 8 mars 2019, moins massif mais plus auto-organisé et mieux branché sur certains secteurs syndicaux dans le commerce et le non-marchand ou certaines universités. Et enfin des initiatives contre l’extrême-droite telles que le Front Antifasciste 2.0 à Liège et la coalition Stand Up qui a regroupé des dizaines d’associations, organisations politiques et branches syndicales pour organiser un contre-meeting en dernière minute avec plus de 1500 personnes fin 2018 en réaction à la marche d’extrême droite contre le pacte de Marrakech, puis avec 7000 personnes en mai 2019 suite à la percée du Vlaams Belang, sans oublier le mouvement des sans-papiers ou les coalitions pour le droit au logement.
La question de l’État concerne, au-delà de l’associatif, tout le mouvement ouvrier, partis de gauche inclus. Les directions du mouvement ouvrier et de l’associatif ont propagé l’illusion d’un État neutre, arbitre, qui donne un coup à gauche, un coup à droite, sur lequel compter pour améliorer les conditions de vie des classes populaires. Cette vision réformiste était erronée dès le début mais le tournant néolibéral-autoritaire des années 80, approfondi et aggravé depuis la crise de 2008 et la pandémie, a fait la démonstration de son ineptie. La crise de légitimité de la classe dominante a fini par toucher aussi, indirectement, les organisations de la société civile, comme les syndicats, les mutuelles et les grandes associations établies. Cette situation ouvre des chantiers pour le futur. Il y a bien sûr le chantier du retour du débat stratégique dans les organisations qui contestent le capitalisme, l’écocide et les oppressions. À cet égard, l’indépendance de classe restera déterminante : on ne peut pas gagner contre le capitalisme sans rompre avec ses représentant.e.s économiques et politiques. Également déterminant pour toute stratégie qui souhaite être conséquente : acter définitivement le décès de la concertation en tant que voie possible vers un progrès social ou écologique. Faute de quoi, la seule place qui restera aux organisations et associations sera celle d’accompagnateurs du train néolibéral et autoritaire qui nous mène de la crise sociale et démocratique vers le désastre écologique. La crise du Covid19 a durement frappé le secteur associatif, les syndicats et les mutuelles, court-circuités dans la gestion de la crise sanitaire et noyés dans un rôle, de plus en plus contesté par les droites, de fournisseurs de services pour le compte de l’État. La mise à l’écart conjointe du parlement a été accompagnée d’un renforcement des aspects autoritaires et sécuritaires de la politique gouvernementale. Syndicats et mutuelles ont gardé leurs centres de services fermés bien longtemps après la réouverture de l’Horeca. Si ces secteurs de la société civile veulent pouvoir jouer un rôle crédible dans la contestation du système capitaliste et de ses effets, renouer le lien avec les travailleur.se.s et les classes populaires doit être une priorité absolue.
L’enjeu, pour les révolutionnaires, est d’ouvrir des brèches par la gauche dans le consentement populaire à l’ordre établi et de détacher de l’emprise de l’État néolibéral – et de ses gestionnaires sociaux-libéraux – plusieurs secteurs grandissants des mouvements sociaux. Comment constituer des coalitions de forces entre des positions conquises par et dans le mouvement syndical et le secteur associatif dégagé de la routine bureaucratique, avec des courants politiques non-sectaires de la gauche combative, qui puissent réellement initier, favoriser et se mettre au service de formes d’auto-organisation à la base ? Telle sera certainement l’une des questions majeures à travailler ensemble dans la période qui vient.
- [1] Mandel Ernest, La société primitive et les origines de l’État, 1965 : http://www.ernestmandel.org/new/ecrits/article/la-conception-marxiste-de-l-état.
- [2] Engels Friedrich, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, 1884 : https://www.marxists.org/francais/engels/works/1884/00/fe18840000.htm.
- [3] Marx Karl, Engels Friedrich, « Préface à l’édition allemande de 1872 du Manifeste du Parti communiste » https://www.marxists.org/francais/marx/works/1872/06/kmfe18720624.htm.
- [4] Luxembourg Rosa, « Affaire Dreyfus et cas Millerand. Réponse à une consultation internationale », 1899 :
https://www.marxists.org/francais/luxembur/works/1899/rl189900a.htm.
- [5] Lénine Vladimir Ilich, « L’État et la Révolution : la doctrine marxiste de l’État et les tâches du prolétariat dans la révolution », 1917 : https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er.pdf.
- [6] Créature mythique, mi-humain, mi-cheval. « La bête sauvage et l’homme, la force et le consentement », selon Gramsci.
- [7] Gramsci Antonio, « Notes sur Machiavel, sur la politique et sur le Prince moderne », 1930-1932, https://www.marxists.org/francais/gramsci/works/1933/machiavel6.htm.
- [8] https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:202699.
- [9] Expression tirée de Halimi Serge, Le grand bond en arrière, Paris, Fayard, 2004.
- [10] Fonceny Louise, « L’aliénation dans le secteur associatif », 19 février 2021, https://www.gaucheanticapitaliste.org/lalienation-dans-le-secteur-associatif/
- [11] Ibid.
- [12] Ibid.
- [13] Ibid.
- [14] Camfield David, « Against a culture of paid activism », 4 novembre 2021, Briarpatch magazine, https://briarpatchmagazine.com/articles/view/against-a-culture-of-paid-activism.
- [15] Miliband Ralph, L’État dans la société capitaliste. Analyse du système de pouvoir occidental, Bruxelles, Éditions de l’ULB, 2012, p. 306. Notons que cet ouvrage a été préfacé par… Paul Magnette, devenu entre-temps le président du PS.
- [16] Expression utilisée par la gauche radicale états-unienne contre le Parti démocrate.
- [17] Fonceny Louise, « L’aliénation dans le secteur associatif », art. cit.
- [18] Le concept de guerre de position est le fruit d’une analogie militaire utilisée par Gramsci, qui l’oppose à la guerre de mouvement. Là où la guerre de mouvement peut être associée au moment insurrectionnel de l’assaut au pouvoir d’Etat, la guerre de positions renvoie à la nécessité, dans les sociétés capitalistes avancées où l’Etat et la société civile sont fortement développés et le rapport de forces a priori défavorable aux classes subalternes, de mener une lutte de longue durée pour gagner des positions au sein de cette société civile et conquérir l’hégémonie avant de passer à la guerre de mouvement et à la conquête du pouvoir. Gramsci rapproche cette notion de celle du « front unique ».
- [19] L’indépendance de classe est ici entendue au sens de la capacité pour un mouvement social de définir et diriger lui-même son orientation politique, ses objectifs, ses modalités d’action, sa stratégie et sa tactique en fonction d’une vision du monde conforme aux intérêts historiques de la classe travailleuse, de façon indépendante et autonome des intérêts et de la vision du monde de la classe capitaliste, de ses relais et structures étatiques et politiques. Elle implique une compréhension des intérêts de la classe travailleuse dans son ensemble, au-delà des frontières, face au capitalisme.
- [20] Une approche similaire, mutatis mutandis, à celle que nous avons suivie avec la Gauche anticapitaliste est défendue dans le contexte français par Bonzom Mathieu, « Faire naître le nouveau. Luttes sociales et horizon politique aujourd’hui en France, Contretemps, 8 juin 2020 : https://www.contretemps.eu/luttes-sociales-horizon-politique-france/.
- [21] Loin toutefois de l’indépendance de classe. Cf. Farkas Axel, Gasparini Mauro, « Les avancées du mouvement social pour la justice climatique et les obstacles à surmonter », Contretemps, 20 avril 2019 : https://www.contretemps.eu/mouvement-justice-climatique-obstacles/. Les difficultés proviennent notamment de l’alliance interclassiste des directions syndicales belges avec une partie du patronat en soutien au capitalisme vert et de l’absence en leur sein d’une réponse de classe au problème de la nécessaire réduction globale de la production et du commerce mondial.