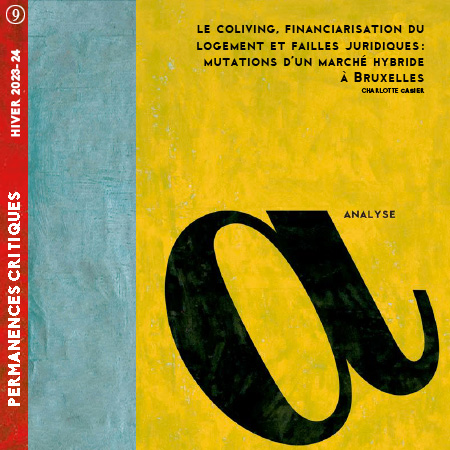Coliving, financiarisation du logement et failles juridiques : mutations d’un marché hybride à Bruxelles
Charlotte Casier
Chapô :
Dans cet entretien, Charlotte Casier, géographe à l’ULB, nous donne un aperçu d’une des formes récentes que peut prendre la marchandisation du logement : le coliving. Casier nous présente les résultats de son enquête sur un objet jusque-là peu étudié et qui permet de mieux comprendre les dynamiques actuellement à l’œuvre sur le marché du logement. Elle interroge enfin l’intérêt de développer le marché du logement transitoire dans une ville où les personnes sont de plus en plus mobiles. D’une prise de conscience de la diversité des manières d’habiter en ville à l’élaboration d’une notion plus inclusive de ce qu’est un « habitant », la plongée dans l’univers très particulier du coliving révèle des enjeux qui dépassent de loin ce marché de niche.
Mona Malak : On entend de plus en plus parler de phénomène de marchandisation du logement. Quels sont les mécanismes de la marchandisation, et quel rôle les promoteurs immobiliers y jouent-ils ?
Charlotte Casier : Cela implique que le logement devient une marchandise, et qu’il prend, du moins pour certains acteurs, une valeur vénale ou une valeur d’échange au lieu d’une valeur d’usage. Concrètement, cela signifie qu’un logement est un bien qui sert à faire de l’argent plutôt qu’à loger des gens. Ça n’a rien de nouveau : dans l’économie capitaliste, le logement a toujours été marchandisé. Ceci étant dit, ce processus n’est pas statique.
Il y a de nouvelles couches de complexité ou de nouvelles mécaniques qui s’ajoutent. Actuellement, on parle de financiarisation du logement. C’est un concept relativement flou qui désigne plein de processus qui font que le marché du logement est de plus en plus pénétré par des logiques financières et que le logement est de façon croissante perçu et traité comme un actif financier.
Pour prendre un exemple très concret, la stratégie des ménages pour l’acquisition d’un bien immobilier devient de plus en plus financiarisée. C’est-à-dire qu’il y a 50 ans, au risque de caricaturer, quand on achetait un bien immobilier, on se demandait avant tout s’il correspondait aux besoins du ménage (nombre de chambres suffisant, proximité par rapport au lieu de travail et à l’école…).
Aujourd’hui, le logement est de plus en plus envisagé comme un placement : on se pose aussi la question de la valeur du bien dans 20 ans. Du coup, il devient naturel d’envisager de gravir une sorte d’échelle immobilière, d’un petit logement qui servira à en acquérir un autre, puis un autre, et ainsi de suite. Beaucoup d’auteurs ont théorisé cette logique de placement comme une conséquence de l’affaiblissement des systèmes de sécurité sociale et des discours de responsabilisation individuelle qui l’accompagnent : il s’agit aujourd’hui d’assurer son avenir par ses propres moyens (entendre : de judicieux investissements). Lors d’un départ en retraite ou d’un revers de fortune, il s’agit de pouvoir compter sur son propre capital. Et puis, ça incite aussi de plus en plus de gens à investir dans des logements pour les mettre en location, afin de s’assurer une rente, par exemple à la retraite. Tout cela montre la perception de plus en plus forte du logement comme un investissement financier.
Cette tendance à investir dans le logement est en outre soutenue par des dispositifs étatiques. En Belgique, par exemple, existe le dispositif des agences immobilières sociales (AIS), qui représente une forme de soutien aux propriétaires bailleurs : ils peuvent confier la location de leur bien à une AIS qui, en échange, leur garantit un revenu sur un bail de neuf ans et prend en charge toute la maintenance. Évidemment, les loyers qui sont versés aux propriétaires sont un peu en dessous du marché, mais ça reste quand même une situation avantageuse pour un propriétaire parce qu’il ne doit plus s’occuper des tâches liées à la mise en location d’un bien.
M.M : Le coliving s’inscrit dans ce type de logique ?
C.C : Le coliving est en effet une matérialisation de la financiarisation du logement dans le parc locatif. C’est l’une des manières dont elle prend forme. Il est difficile de définir le coliving parce que ce terme n’a pas de réalité juridique ou urbanistique : il est utilisé par des acteurs immobiliers pour définir ce qu’ils veulent. Depuis 2016 à Bruxelles, on a vu apparaître une offre qui était désignée comme du « coliving » par ses organisateurs. En général, les sociétés qui se revendiquaient de ce terme avaient des logements qui partageaient un ensemble de caractéristiques relativement inédites sur le marché. Quelles sont ces caractéristiques ?
Il s’agit d’un type de logement qui associe des espaces privés (des chambres ou parfois, des studios, selon les endroits) avec des espaces partagés. Ces derniers comprennent, au minimum, une cuisine, un salon, mais s’agrémentent parfois d’espaces plus prestigieux, comme une salle de cinéma, une salle de sport, un espace de jeux…
Dans ces logements, tous les espaces sont meublés et la location est accompagnée de services (nettoyage des espaces communs ou des chambres, fourniture des produits d’épicerie de base…), dans une formule « all inclusive » où le loyer inclut également les charges, la connexion à Internet, un abonnement aux plates-formes de streaming, etc.
D’un point de vue promotionnel, c’est donc une offre vendue comme flexible et adaptée pour une occupation de moyen terme (six mois par exemple). C’est tout à fait adapté pour quelqu’un qui arrive à Bruxelles et qui ne sait pas exactement combien de temps il va rester. Souvent, c’est tout à fait possible de réserver sa chambre en ligne, de signer son contrat à distance, etc. Tout est conçu pour fluidifier les démarches pour le locataire : pas besoin d’attendre, d’acheter des meubles, etc. Tout cela dans un emballage valorisant l’idée d’une expérience communautaire[1].
M.M : Quelle est l’ampleur du coliving à Bruxelles ?
C.C : Il n’existe pas de données publiques, j’ai donc effectué un travail de recensement, mais la définition floue du coliving ne facilite pas ce travail.
Sur base des critères énoncés plus haut, j’ai répertorié à Bruxelles environ 3 000 chambres réparties dans 300 résidences de coliving. En 2016, il n’y en avait pas. Et l’année qui a vu le plus de nouvelles ouvertures, c’était 2021. C’est clair qu’à l’échelle du marché du logement bruxellois total, il s’agit vraiment d’un épiphénomène. Mais ça permet de mettre la lumière sur certaines dynamiques. C’est un marché symptomatique, en quelque sorte.
À travers l’étude du coliving, j’ai ainsi pu examiner le secteur de l’offre en profondeur, en cherchant à déterminer qui organise ce marché, qui le gère, qui le finance et qui en tire profit. À partir de là, j’ai pu analyser la question de la financiarisation du marché du logement, des transformations récentes du marché locatif. Cela m’a conduit à questionner la manière dont les pouvoirs publics interagissent avec ces transformations, notamment par le biais des régulations urbaines. Enfin, j’ai enquêté sur les locataires pour tenter de déterminer les interactions entre ce nouveau type d’offre en matière de logement et des mutations sociodémographiques que je résumerai rapidement sous la catégorie de flexibilisation du marché du travail, avec l’instabilité – voire la précarité – qui en découle, surtout pour les jeunes adultes.
M.M : Pouvez-vous élaborer ce que vous entendez par flexibilisation du marché du travail et expliciter ses liens avec le logement ?
C.C : C’est un terme que j’utilise pour qualifier l’évolution des parcours professionnels et étudiants des jeunes adultes issus des classes supérieures. En général, on parle de précarisation de ces parcours, mais c’est un terme que je n’aime pas trop utiliser pour parler des classes supérieures, qui ne sont pas dans une situation de précarité durable, mais en général très ponctuelle, et parfois même accompagnée de hauts revenus. Je préfère donc parler d’« instabilité » et de « flexibilisation » du marché du travail.
Concrètement, pour ces jeunes gens-là, au terme d’un parcours d’études de plus en plus long, il est plus difficile de trouver un travail, les contrats sont plus courts, instables et/ou s’assortissent de formes semi-reconnues de travail (les stages, typiquement).
Pour les jeunes adultes de classe supérieure, cette flexibilisation prend aussi la forme d’une pression à la mobilité internationale, avec l’idée de faire des Erasmus durant les études, d’ensuite aller faire des stages à l’étranger, des mobilités à l’intérieur de l’entreprise, ce genre de choses[2]. Tous ces programmes de mobilité ont naturellement une incidence sur la nature des demandes sur le marché du logement : pour quelqu’un qui va rester 6 mois dans une ville ou qui ne sait pas combien de temps il va y rester, la recherche et l’accès au logement est très différent de celui de quelqu’un qui projette de rester encore 20 ans à Bruxelles ou en Belgique, avec un revenu stable. Cette mutation sur le marché du travail a donc des conséquences sur la demande sur le marché du logement et ça explique l’émergence de produits du genre coliving.
M.M : Peut-on dire que le coliving est une forme de maximisation de la rente ?
C.C : Le coliving, c’est une façon, selon moi, de maximiser le loyer qu’un propriétaire peut tirer d’une maison unifamiliale bruxelloise de deux manières. D’abord, il la divise en plein de petites unités locatives, ce qui permet d’obtenir un loyer total plus élevé que s’il avait décidé de louer le bien « d’un seul bloc », soit à une famille, soit à une colocation plus traditionnelle. Ensuite, les chambres elles-mêmes sont louées à des prix élevés en soi grâce à tout le travail de promoteur autour du coliving, qui consiste à en faire un produit unique, incroyable et donc rare et cher. Ça témoigne donc de stratégies pour augmenter la rentabilité financière des logements.
En termes de financement, il y a deux grands modèles dans le coliving bruxellois. D’un côté, il y a des maisons de coliving détenues par des propriétaires particuliers qui partagent souvent les mêmes caractéristiques: des hommes, dans la cinquantaine, issus des classes supérieures, cadres ou exerçant des professions libérales, qui achètent les maisons et les confient aux opérateurs de coliving qui en assurent la gestion en échange d’un pourcentage du loyer.
Et de l’autre côté, il existe des sociétés comme Cohabs, par exemple, qui, elle, est propriétaire des logements et se finance via des investisseurs. Au départ, il s’agissait d’acteurs de « petite » envergure : des particuliers issus des classes supérieures. Ensuite, Cohabs a noué des accords avec des acteurs belges de plus grande envergure, telles que AG Real Estate. Finalement, en novembre 2022, l’entreprise a annoncé son partenariat avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un des plus grands fonds de pension à l’échelle internationale, pesant plus de 400 milliards de dollars.
Dans un cas comme dans l’autre, la formule du coliving facilite l’investissement financier dans l’immobilier parce qu’elle permet aux investisseurs de ne pas s’encombrer des tâches rébarbatives qui incombent habituellement aux propriétaires : la recherche de locataires, les états des lieux d’entrée et de sortie, les réparations, etc.
Pour ses détenteurs, le coliving, tout à la fois, augmente les prix des loyers et permet d’envisager le logement comme un simple actif financier, qui ne demande pas beaucoup plus de travail concret qu’un portefeuille d’actions boursières[3].
M.M : Quel est le risque du développement de cette forme d’habitation ? Que peut présager le développement du coliving ?
C.C : Je dirais que le risque c’est de normaliser le fait de vivre dans des toutes petites surfaces à des prix très élevés, ce qui représente selon moi une dégradation des conditions de vie.
Dans le même ordre d’idée, on commence à voir surgir l’idée d’étendre le concept de coliving pour d’autres groupes démographiques. À Paris, par exemple, un groupe d’acteurs privés va ouvrir un coliving pour familles monoparentales, avec une bonne dose de social-washing sous couvert d’un projet qui serait au service des besoins de ce groupe, alors qu’il s’agit d’une entreprise lucrative. Comme quand Côte d’Or te dit qu’il fait du chocolat responsable.
Les sociétés de coliving font un grand travail pour se présenter comme des actrices de la rénovation urbaine, de la transition écologique et des solutions à la crise du logement. Il s’agit d’une dimension importante de leurs activités de lobby afin d’obtenir des réglementations favorables à leurs intérêts. A Bruxelles et ailleurs, le contexte urbanistique est très flou sur le coliving et donc ils essaient de s’assurer que celui-ci évolue dans leur sens. Il est par exemple dans leurs intérêts d’obtenir une baisse des surfaces minimales des logements, de maintenir le non-encadrement des loyers etc. Ces enjeux sont cruciaux pour leur développement et peuvent impacter tout le marché du logement, lorsqu’on pense par exemple aux surfaces et aux prix.
M.M : Quel est le rapport des politiques publiques à ce phénomène ? Essayent-elles de le réguler ?
C.C : Un aspect qui a facilité le développement du coliving, c’est le fait qu’il soit peu régulé. Ce n’est pas une notion juridique : dans un règlement urbanistique, il n’y a rien qui différencie un habitat de coliving d’une maison unifamiliale.
Pour parler d’implications concrètes, la loi encadre les aménagements pour lesquels un propriétaire doit demander un permis d’urbanisme à Bruxelles. En général, les demandes tombent sous le coup de deux catégories principales : le changement d’« utilisation » ou de la « destination » d’un bien, ou la modification du nombre de logements que le bien comporte en son sein.
Or, une maison unifamiliale transformée en habitat de coliving ne change pas de destination: c’est un logement qui reste un logement. Il n’existe pas de changement d’utilisation résidentielle soumis à permis.
Concernant le nombre de logements, à la différence du cas « traditionnel » d’une maison unifamiliale subdivisée en trois appartements, où le nombre de logements est modifié de un à trois, le coliving reste considéré comme un seul et unique logement ! Parce qu’il n’est question que de multiplier le nombre de chambres, tout en conservant une seule cuisine, une seule entrée, une seule sonnette, etc. le nombre de logements reste administrativement identique. Et donc, il n’est pas non plus nécessaire de demander un permis en vertu de ce critère-là.
Il y a donc beaucoup d’établissements de coliving qui ont été ouverts à Bruxelles sans qu’il ait été nécessaire d’introduire une demande de permis. Or, en l’absence d’une demande de permis, la commune ne peut pas se prononcer par rapport aux règlements urbanistiques sur les surfaces, les équipements, etc.
Il existe donc une sorte de faille dans la législation actuelle. En fait, un habitat de coliving est un produit un peu hybride. D’un côté, c’est difficile d’argumenter que ce n’est pas du logement parce que les baux sont à plus de trois mois, que la majorité des gens restent quand même plus que six mois, etc. Ce n’est donc clairement pas de l’hébergement touristique, par exemple. D’un autre côté, il n’est pas difficile de voir qu’il y a quand même une petite différence entre loger une famille dans une maison unifamiliale et empiler dans une maison une douzaine de jeunes gens qui ont chacun leur chambre, leur clé, leur bail individuel.
Mais ça, la législation ne le prévoit pas. C’est cette opportunité qui a permis au coliving de se développer très rapidement, notamment grâce aux deux avantages. D’abord, ça permet au propriétaire de raccourcir le délai entre le moment de l’achat du bien et le moment de sa mise en location. C’est plus intéressant financièrement. Ensuite, ça réduit le risque de voir le rendement attendu réduit par un permis restrictif par rapport aux prévisions (lorsque, par exemple, un propriétaire projette un profit sur un habitat à douze chambres mais qu’il n’est autorisé par la commune à n’en ouvrir que dix). La finance déteste l’incertitude.
Les communes ont essayé de faire opposition, mais en disposant de peu d’outils formels. Par contre, les réflexions sur le coliving à échelle de la Région bruxelloise, elles, ont pris place dans un contexte plus large : celui de la réforme du Règlement régional d’urbanisme, qui s’applique à toute construction neuve ou bâtiment qui fait l’objet d’une demande de permis.
Pour le secteur du coliving, l’un des enjeux de cette réforme – qui, à ce jour, n’a toujours pas abouti –, c’était de fixer un nombre maximal de chambres que peut comprendre un logement. Actuellement, il n’y a pas de limite. Et puis, il y a la question des surfaces. Actuellement, le règlement régional prévoit que la chambre « principale » d’un logement soit de 14 mètres carrés, et les autres de 9. De ce fait, certaines communes ont argumenté que dans un habitat de coliving, toute chambre étant une chambre « principale », dans la mesure où elle est le seul espace privé de l’occupant, et que donc toute chambre devait faire 14 mètres carrés. Mais ça, vraiment, c’est quelque chose que ne veulent pas les opérateurs du coliving, parce que ça s’attaquerait fort à la rentabilité du modèle.
M.M : D’où vient cet engouement médiatique et politique pour le coliving ?
C.C : Je ne sais pas très bien. Si je devais formuler des hypothèses, je dirais que, d’abord, l’ambition des pouvoirs publics quant à la régulation du marché des logements est assez réduite, et donc ils se concentrent sur des épiphénomènes pour donner l’impression qu’ils sont actifs sur ces questions. Ensuite, je pense que les pouvoirs publics, surtout aux échelons locaux, sont plus attentifs aux demandes de certains de leurs habitants. Dans un premier temps, le coliving a beaucoup gagné en visibilité médiatique pour des questions…de nuisances sonores. Il y avait des plaintes de voisinage à l’occasion de grandes fêtes organisées dans ces établissements qui faisaient beaucoup de bruit dans des îlots qui étaient plutôt calmes d’habitude. Ce qui est intéressant, c’est d’examiner le profil des gens qui ont porté cette revendication auprès des médias et du pouvoir public : des groupes d’habitants qui étaient plutôt des gens entre 30 et 60 ans, propriétaires, issus des classes supérieures, qui avaient des relais auprès des médias et des pouvoirs publics. Je pense que ça a clairement poussé les pouvoirs locaux, ou en tout cas certaines franges de ceux-ci, à se mobiliser sur la question.
En fait, quand les pouvoirs politiques parlent de coliving, ils révèlent la façon dont ils perçoivent les différents groupes de population dans Bruxelles et lesquels sont légitimes. Ainsi, les locataires des habitats de coliving ne sont jamais repris sous le vocable « habitants » ou « bruxellois », comme s’ils étaient des habitants qui venaient usurper la position des « vrais » habitants. Je dirais que ça trahit une certaine forme d’attention sélective.
Au fond, c’est une position en décalage complet avec la population bruxelloise. Nous accueillons sur notre territoire de nombreux flux migratoires, notamment liés à la présence des institutions européennes. Les autorités bruxelloises se réjouissent d’être la « capitale de l’Europe », d’accueillir plein d’étudiants, d’être une ville cosmopolite, et cherchent à maintenir cette « attractivité internationale » mais ensuite, ne souhaitent pas que ces personnes s’installent dans leurs quartiers.
M.M : Quel est, selon vous, l’intérêt d’étudier le logement transitoire ?
C.C : A mon sens, il existe un énorme point aveugle dans la vision des politiques publiques vis-à-vis de la population bruxelloise, et ce point aveugle concerne les gens en transition, et leurs besoins spécifiques en termes de logement. Que la transition en question soit d’ordre migratoire, démographique, personnel ou professionnel, elle implique de rechercher d’autres types de logement, rapidement accessibles, meublés et aux baux plus courts ou flexibles. Ce type de demande n’est absolument pas pris en charge par les pouvoirs publics, alors qu’en fait, une ville, ça a aussi une fonction d’accueillir ces gens-là. C’est donc au final une proportion significative de la population qui ne peut se tourner que vers le marché du logement privé.
En gros, les politiques régionales actuelles concernant le logement se résument majoritairement à un soutien à l’accès à la propriété (via les programmes CityDev) et au logement social – un parc notoirement sous-financé, où la demande excède très largement l’offre, les délais d’attente avant d’accéder à un logement pouvant atteindre facilement…10 ans. Pour quelqu’un qui traverse une phase de transition, c’est évidemment un peu long. C’est d’ailleurs un peu long dans tous les autres cas. Il faut continuer à financer et développer du logement social, mais cela ne change rien à ce constat très simple : il n’existe aucune offre publique de logement qui réponde aux besoins spécifiques des populations que je viens d’évoquer.
Dans le cadre de ma recherche, je me suis retrouvée face à un public constitué majoritairement de jeunes expatriés issus de milieux relativement aisés. Je ne revendique pas une plus grande prise en charge par les pouvoirs publics de ces individus, dont le parcours génère peu d’inquiétude à terme. Mais ces « jeunes pleins d’avenir » sont en quelque sorte l’arbre qui cache la forêt : il y a plein d’autres profils qui sont dans une situation similairement compliquée en termes de logement et n’ont pas les mêmes ressources pour affronter ce type de difficultés : couples en instance de séparation, étudiants, personnes victimes de violences intrafamiliales ou conjugales, la liste est longue.
Et rien ou presque n’est proposé à ces gens par la collectivité. Ce que je vais dire relève d’une position personnelle plutôt que d’un avis de chercheuse, mais moi, au fond, je n’ai pas tellement de problème avec la forme du coliving, c’est-à-dire avec l’idée que des personnes puissent vivre ensemble dans une même maison transformée en habitat partagé, pour des durées flexibles. Présenté comme ça, l’idée ne me semble ni absurde, ni problématique.
Le problème, c’est plutôt, à mon avis, de savoir qui organise cette offre et au profit de qui. C’est le message que j’essaie de faire passer auprès des pouvoirs publics. La question, en tout cas, mérite d’être posée : est-ce que la forme du coliving est problématique en soi, ou est-ce le modèle économique derrière ?
M.M : Comment peut-on s’inspirer de cela pour répondre aux besoins de plusieurs types de population en transit et ne correspondant pas aux modèles de logement unifamilial ?
C.C : Il me semble que le coliving permet de s’interroger sur la place que doit occuper le logement partagé dans nos villes. Selon moi, cela reste une solution qui peut convenir à un nombre important de ménages et à laquelle il faudrait faciliter l’accès, tout en laissant une marge de manœuvre aux gens qui n’ont pas envie d’y être. Il ne s’agirait évidemment pas de forcer les gens à vivre dans ce genre de logement, mais simplement de s’assurer qu’il en existe une offre suffisante et de qualité. Ça pose plein de questions, en termes de mode de vie, de règles ou de capacité de cohabitation, mais c’est une piste intéressante.
M.M : Est- ce qu’il faut tenir compte politiquement du phénomène du coliving ? Si oui, pourquoi ?
C.C : Je dirais qu’il faut en tenir compte pour tout ce que ça nous apprend, à la fois sur les acteurs privés qui organisent le marché du logement, sur les politiques de réglementation et sur les besoins des habitants des villes en termes de logement. Après, je ne dirais pas que c’est là-dessus qu’il faut concentrer toute son énergie pour transformer le marché du logement. Pour ça, il me semble plus urgent de se battre sur la question des prix – ou, plus radicalement pour une remise en question des droits absolus accordés à la propriété privée. Dans ce cadre, le coliving est intéressant parce qu’il offre des clés de compréhension nouvelles, mais intervenir dans ce secteur ne permettra clairement pas de bouleverser le marché du logement.
M.M : Un mot de la fin ?
C.C : Je dirais qu’il faut développer une offre publique de logements partagés, de colocations meublées, accessibles à tous et toutes, à prix abordable. Et qu’il faut mieux encadrer le marché du logement en général, que ce soit du point de vue des prix que de la propriété.
- [1] À ce titre, on retrouve souvent les mots « co » ou « share » dans le nom des sociétés de coliving.
- [2] Bruxelles accueille énormément de stagiaires à la Commission européenne, par exemple.
- [3] On parle ici d’un dispositif pierre-papier : l’investisseur a acheté de la pierre, mais il l’envisage comme une action en Bourse, un placement, bref, un bout de papier qui n’a pas d’autre valeur qu’une valeur d’échange.