Les utopies de la gratuité à l’épreuve du statu quo
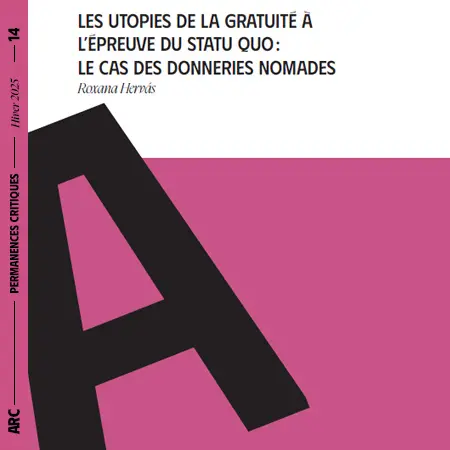
L’utopie de la gratuité à l’origine des Donneries est rapidement devenue un miroir des inégalités qu’elle cherchait à combattre : loin de subvertir le marché, cette utopie finit par en reproduire les lignes de fracture de classe et de
Faut-il sauver le travailleur social ? Pourvu qu’il soit sociétal*
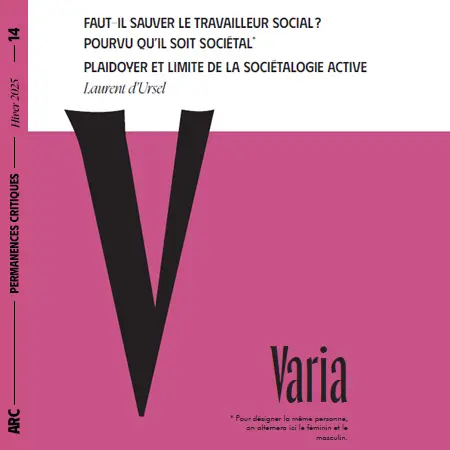
Dans la perspective de repenser à nouveaux frais l’épineuse question de l’engagement militant des travailleur·euses sociaux et de mesurer ce qui le rend possible autant que ce qui contribue à le contrecarrer, la présente analyse propose de dialectiser travail social et travail sociétal. Sociétaliser une question revient à
Choisir ses armes. Contre l’idéologème du don
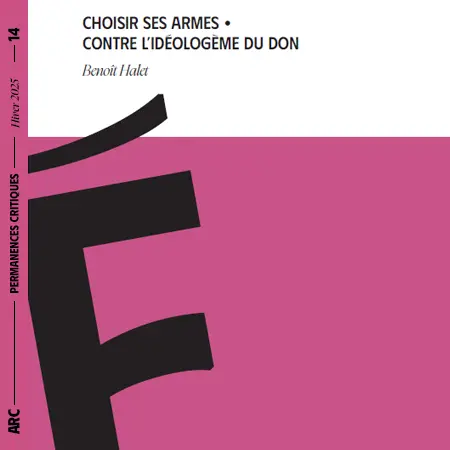
Dans le contexte de casse sociale instauré par le gouvernement Arizona, la présente étude a pour vocation de mettre en garde les acteurs du non marchand. La crise que traverse le secteur, orchestrée par les coupes agressives dans les fonds publics, ouvre une voie royale à l’implémentation de modalités libérales de financement
S’associer pour mieux régner ? Critique de la faculté de militer

Le dossier de ce numéro 13 de Permanences Critiques constitue le deuxième volet d’un double dossier consacré au secteur associatif. Comme nous l’expliquions dans l’Éditorial du numéro précédent, ces dossiers peuvent se lire comme une intervention dans le contexte actuel de crise des politiques étatiques d’organisation de l’hégémonie, en lien avec
De l’expression au mot d’ordre. Pour une critique de la raison militante
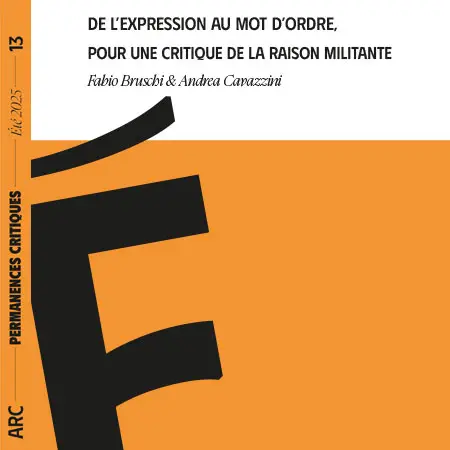
Cet article a pour objectif de critiquer le paradigme de l’expression qui constitue l’un des piliers de la militance associative dans le contexte institutionnel belge. Selon ce paradigme, l’action associative doit favoriser l’expression de ses publics pour ensuite relayer leurs besoins, souffrances et doléances vers les pouvoirs publics, afin
Pour un antiracisme politique radical et décolonial à Bruxelles
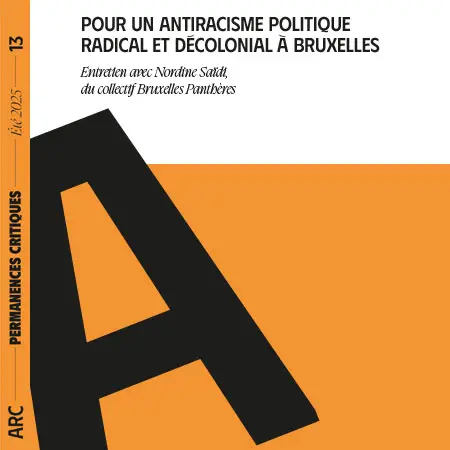
Dans cet entretien, Nordine Saïdi, membre fondateur de Bruxelles Panthères, revient sur le positionnement de ce collectif militant antiraciste et décolonial dans un paysage où la question de la récupération institutionnelle prend tout à la fois la forme d’une captation « polie » des revendications radicales et d’un tissage de réseaux de militances
Travailler ou militer : résister
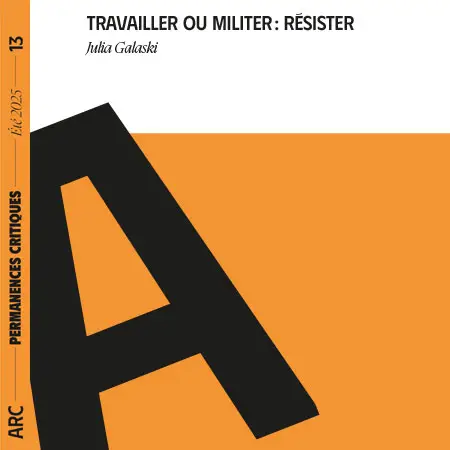
Retour sur dix ans d’engagement citoyen et de travail dans le milieu associatif bruxellois, dans un contexte de démantèlement progressif des services publics et de l’État de droit. Dans une écriture fragmentaire visant à restituer des moments clefs de ces expériences, il s’agit, en articulation avec la lutte militante, d’explorer et d’habiter les
Militance et associatif : penser et agir ensemble contre les rapports existants
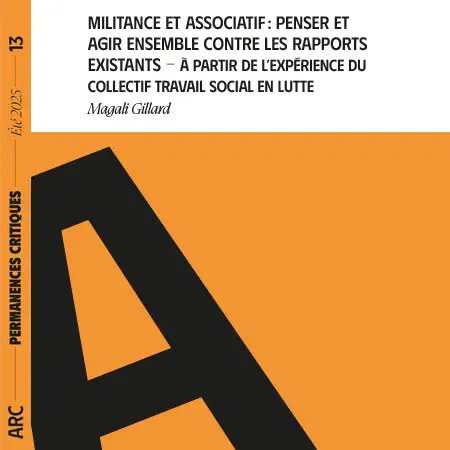
Englué dans des structures organisationnelles contraintes de se conformer aux critères d’évaluation dont dépendent l’obtention de subsides, pris dans des segmentations contre-productives, le travail social tend à perdre son sens, réduit à un rôle de soins palliatifs dans un système sociétal d’une brutalité croissante. L’auteure interroge ici
Familles monoparentales : limites associatives, lacunes politiques

Cette analyse propose de resituer les enjeux socio-politiques de la monoparentalité, considérée comme objet d’une mobilisation croissante, tant de la part des acteurs politiques que de ladite société civile. À partir d’une analyse de la situation contemporaine autant qu’à partir d’une expérience d’intervention associative spécifique
S’associer pour mieux régner ? Critique de la raison associative

Comme en témoignent les nombreuses publications associatives portant sur le secteur associatif subsidié parues en Belgique francophone ces dernières années, les acteurs de ce champ vaste et varié – plus de cent mille associations, employant plus d’un demi-million de personnes, et produisant autour de 5% du PIB belge – partagent un constat commun de la situation critique
Pour une analyse de classes du secteur associatif

Nées au lendemain de la loi de 1921 leur accordant la personnalité civile, le nombre d’associations sans but lucratif (ASBL) a été multiplié par sept depuis les années 1960. Cette progression coïncide avec l’augmentation de leur présence dans diverses activités économiques. Par ailleurs, de plus en plus d’ASBL exercent des activités à caractère commercial…
Penser l’associatif au prisme du travail de reproduction

Nées au lendemain de la loi de 1921 leur accordant la personnalité civile, le nombre d’associations sans but lucratif (ASBL) a été multiplié par sept depuis les années 1960. Cette progression coïncide avec l’augmentation de leur présence dans diverses activités économiques. Par ailleurs, de plus en plus d’ASBL exercent des activités à caractère commercial
Révo cul dans l’éduc pop !

Fait nouveau majeur : avec 40% de la population désormais diplômée du supérieur, le gros des associations d’éducation permanente/populaire – la petite bourgeoisie culturelle – a lentement déserté la question sociale du travail, cœur de la lutte des classes, pour se tourner vers des formes de militantisme « sociétales » qui tendent à moraliser ou
Penser contre la tendance totalitaire des associations
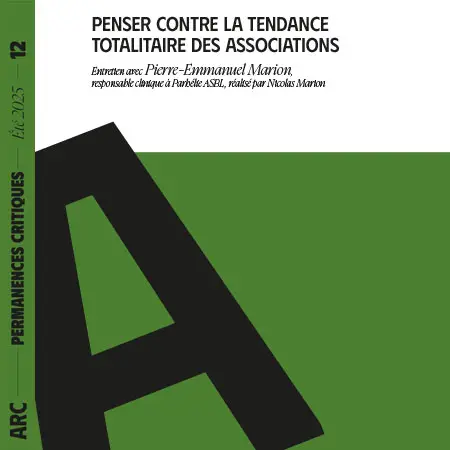
Les structures hospitalières, et en particulier celles qui s’inscrivent dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale en général, affrontent aujourd’hui des tendances sociétales et économiques qui – de proche en proche – conduisent à la destruction partielle de ce qui assure à ce travail son sens et sa fonction. Responsable clinique à
Sans-chez-soi et sans voix, pour une autre histoire de la Porte de Namur
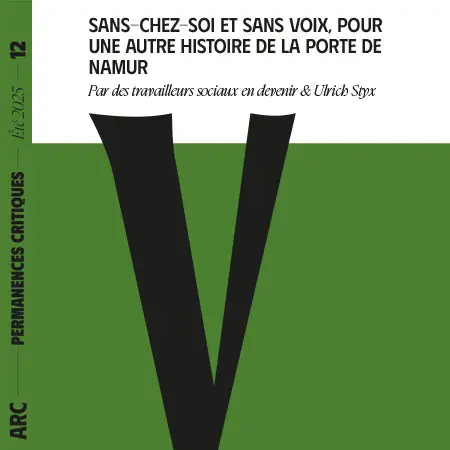
En réponse à l’éditorial paru dans L’Écho intitulé « À la Porte de Namur, entre coups et crachats, la dure réalité des commerçants bruxellois », ce texte se veut un contrepoint radical aux récits dominants qui instrumentalisent la précarité pour masquer les causes systémiques des inégalités. À partir de notre travail de terrain et de nos modestes
L’éducation permanente face à la numérisation de la société
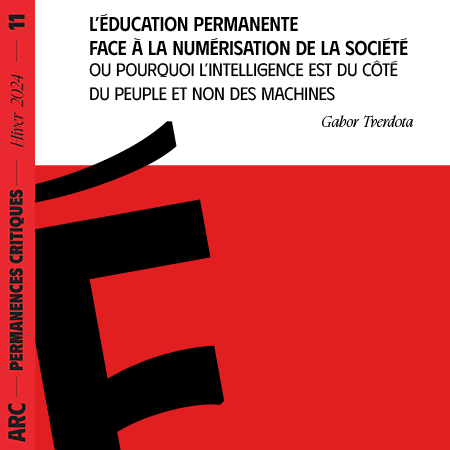
Existe-t-il une raison commune à tous les acteurs en éducation permanente, abstraction faite de la diversité de leurs objets sociaux, de s’opposer à la numérisation de la société ? Cette étude donne une réponse affirmative à cette question et tente d’expliciter pourquoi il en est ainsi.
Gouvernementalité et déni de matérialité
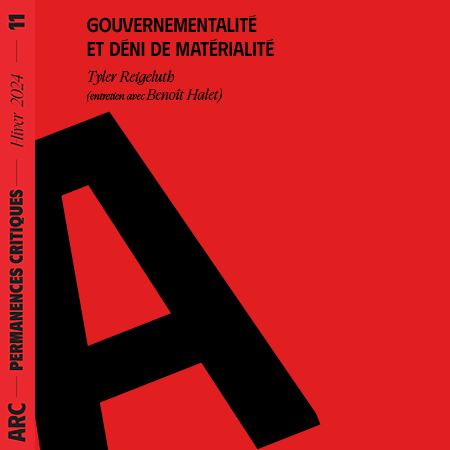
Dans L’intelligence des villes, Tyler Reigeluth se propose, selon ses propres termes, de « défétichiser le désir d’automaticité et de dématérialisation qui envoûtent les conceptions de l’intelligence urbaine. ».
En effet, le déploiement de la ville intelligente reposerait, dans cette perspective, sur un triple refoulement : de la matérialité
Le coût de la mise en scène

Les plateformes de streaming se sont largement imposées comme circuits de distribution de la culture audiovisuelle, mais la logique économique qui les sous-tend en font également des acteurs décisifs dans la production de cette même culture. Les principes fondamentaux du dispositif numérique s’appliquent ici comme ailleurs
L’autophagie numérique : faire de soi-même une marchandise
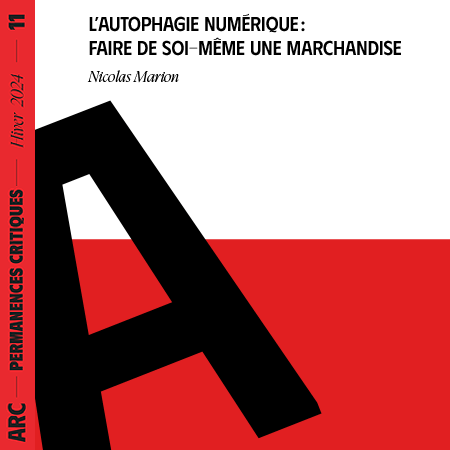
S’appuyant sur une analyse des logiques de personnalisation propres à certaines interfaces numériques dominantes (TikTok, Spotify) et à leurs algorithmes, cette analyse veut proposer une hypothèse critique des transformations de la logique de consommation qui s’y dessinent. Ces algorithmes, qui visent à maximiser le temps de
Liminal spaces et déterritorialisation
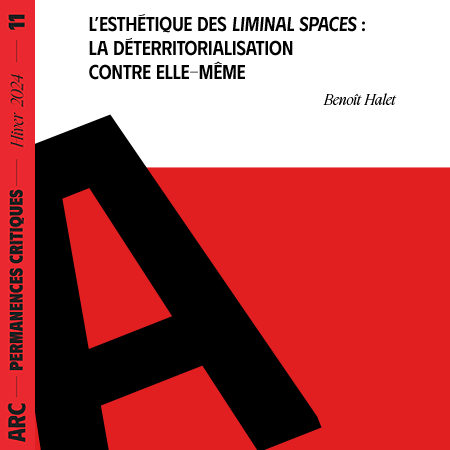
À l’heure où le réseau planétaire des technologies numériques s’est pleinement intégré dans nos vies, au point de nous faire accepter l’idée d’une réalité « augmentée », l’infrastructure dans laquelle le monde du capitalisme numérique nous pousse à vivre génère des sentiments ambivalents. La présente analyse, en croisant
Allomorphisme : droit de réponse du Syndicat des immenses
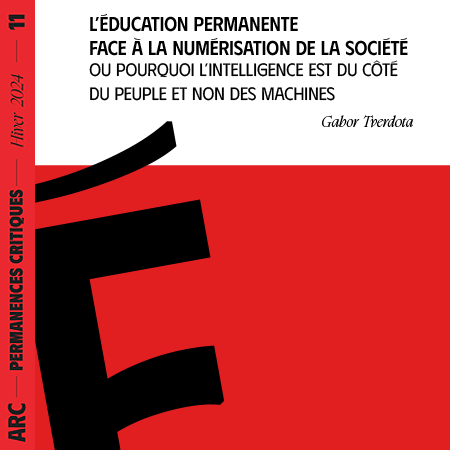
Invitant à l’autocritique de la subjectivité militante, le récent article « Construire la “classe qui souffre le plus” » de Nicolas Marion est excellent, percutant même, si l’on en extirpe le chapeau. Celui-ci présente en effet, comme prétexte à l’argumentaire développé, l’allomorphisme tel que redéfini par le Syndicat des immenses
Réalisme capitaliste et alternatives
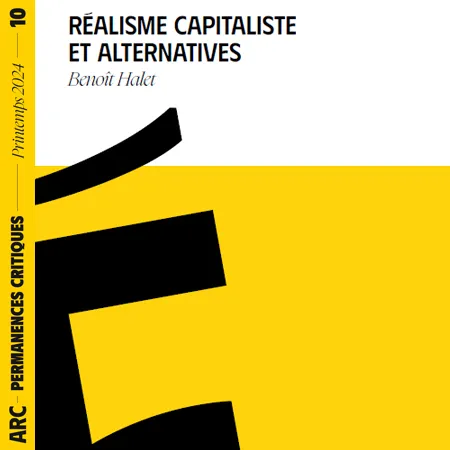
Cette étude a pour objectif de proposer une réinscription des luttes écologiques et de la recherche d’alternatives au système capitaliste dans l’expression des tensions au cœur de la mise en récit des désirs capitalistes et
Projet de cohésion sociale : forcer la paix ou construire la lutte ?
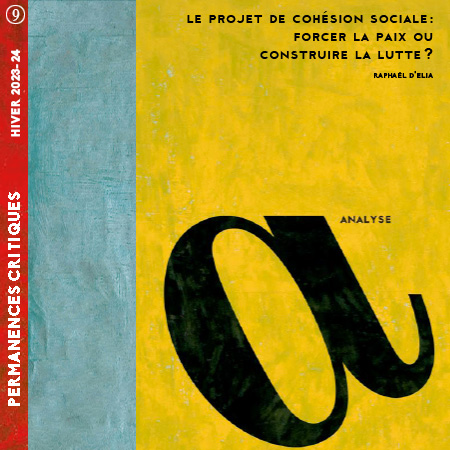
Cet entretien nous donne un éclairage sur la situation dans les logements sociaux bruxellois, à travers un regard situé : celui d’un ancien assistant social qui travaillait dans un projet de cohésion sociale (PCS). Les PCS sont des dispositifs d’accompagnement social qui visent à rendre plus harmonieuse la cohabitation, …
17 mots pour en finir avec le sans-chez-soirisme
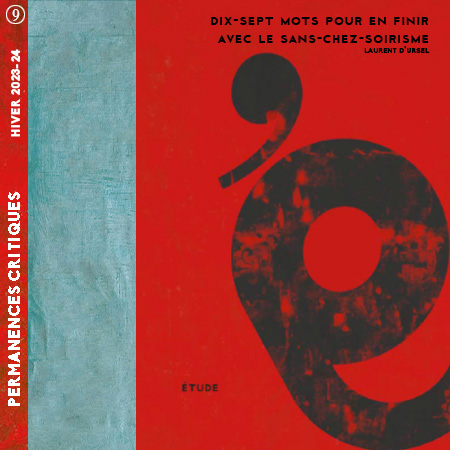
À la fois analyse et manifeste, le texte ambitionne d’élucider une énigme : pourquoi le sans-chez-soirisme explose en Belgique et implose en Finlande ? Pour que les Belges deviennent des Finlandais comme les autres, il suffit de les convaincre que le sans-chez-soirisme n’est pas une fatalité, ni même un « problème social », mais un « choix de société »…
Le numérique comme marché associatif
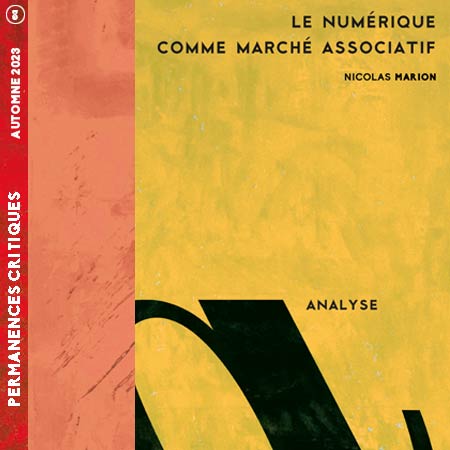
À partir d’une analyse critique des tenants et aboutissants d’une tendancielle et récente « politisation » des débats autour des problématiques relatives aux inégalités numériques au sein de la société belge, cet article propose de s’intéresser aux motifs de la montée en puissance, au sein de la société civile…
Affilier avant tout. Les conditions d’un travail inconditionnel auprès des « grands vulnérables »
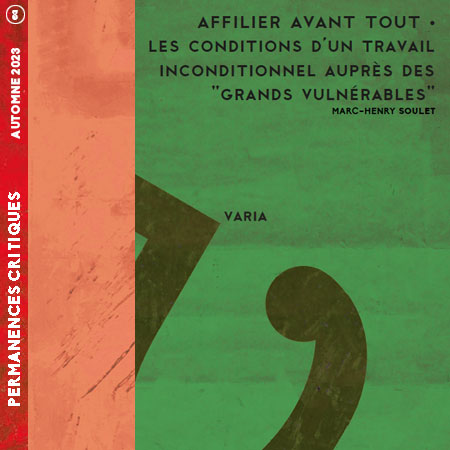
Pourquoi accompagner les « grands exclus » est-il si difficile ? Tant dans une logique de réduction des risques que dans celle du logement d’abord, les nombreux écueils de la prise en charge viennent témoigner de la difficulté et de la dureté d’un tel accompagnement (pour les professionnels comme pour les accueilli·e·s).
Navigations épistémiques à l’encontre du monologue de la psychiatrie
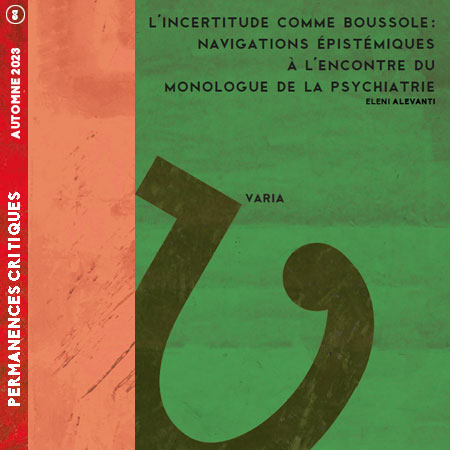
L’injustice épistémique est un concept de plus en plus mobilisé par les personnes psychiatrisées. Il permet de reconnaitre les formes d’oppression dans la production de savoirs expérientiels face aux discours dominants de la psychiatrie.
Violences conjugales : quelle(s) justice(s) ?
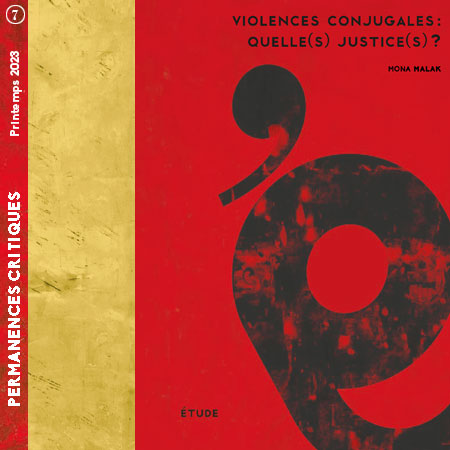
Cette étude a pour but d’analyser le rapport qu’entretient la justice pénale avec les violences conjugales et de questionner le réflexe punitif qui préconise un durcissement des peines comme réponse privilégiée auxdites violences. Il s’agira de montrer qu’il existe d’autres manières, parfois plus
L’économie du télétravail
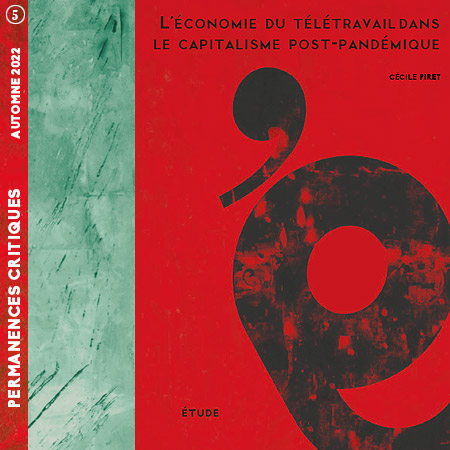
Quels sont les processus sociaux et économiques qui sous-tendent le télétravail comme modalité de mise au travail dont l’essor depuis la pandémie de la Covid-19 a été spectaculaire ? Et en quoi peuvent-ils être comparés à ceux façonnant des situations de travail elles-mêmes redéfinies par la digitalisation ?
Quand le digital s’attaque au travail social

Lorsque ce sont les travailleurs des services et des administrations publiques qui passent au télétravail, on assiste à une digitalisation du guichet social aux effets délétères. Alors que les travailleuses et travailleurs sociaux sont forcés de devenir officieusement des sous-traitants des services qui refusent dorénavant de prendre en charge l’accueil et l’accompagnement des usagers
BruZelle : précarité menstruelle et associative
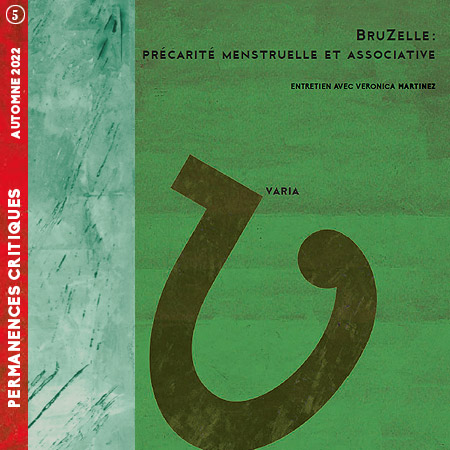
« Brisons les tabous. Changeons les règles ! » : voilà le mot d’ordre de BruZelle, une association belge qui œuvre à la lutte contre la précarité menstruelle depuis 2016 notamment en organisant des collectes et des distributions de serviettes menstruelles jetables.
Penser et combattre les dominations structurelles
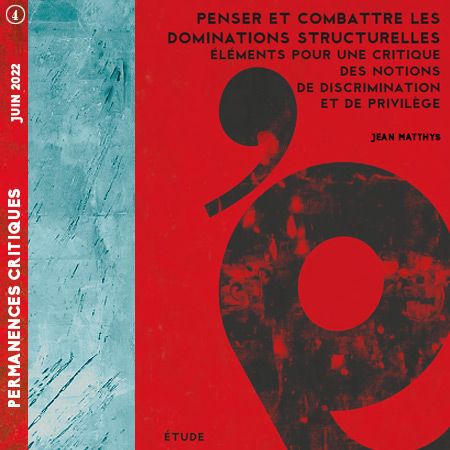
Cette étude propose une critique des concepts de discrimination et de privilège qui sont souvent mobilisés pour penser les phénomènes d’inégalités et de dominations sociales (racisme, sexisme, inégalités de classes, etc.). En montrant que ces notions et certains de leurs usages au sein des milieux associatifs…
ÉTAT ET ASSOCIATIONS – De l’autonomie à l’encastrement idéologique
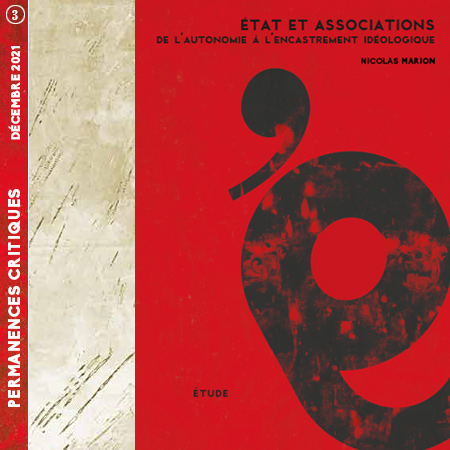
Cette étude propose une déconstruction épistémologique de la façon dont une pensée de l’État se développe au sein des associations, en montrant comment cette pensée permet en fait – à travers l’(auto)évaluation des associations elles-mêmes – à l’État de se penser lui-même et d’intégrer dans la conception et l’implémentation de ses politiques les formes de résistance des populations soumises à sa souveraineté.
Les ambivalences de l’éducation populaire des travailleurs entre pacte social et néolibéralisme.
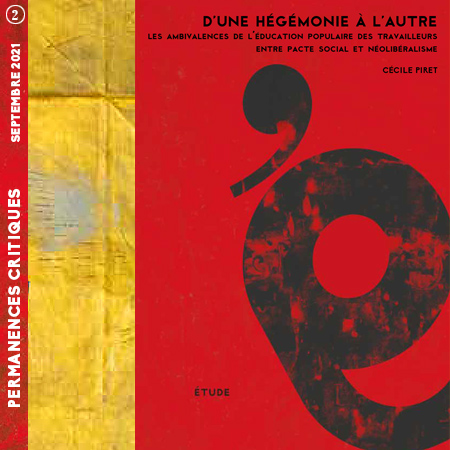
Tant les réformes successives de l’éducation permanente que le contexte de crises multiples donnent lieu régulièrement à des publications participant d’un savoir critique sur le rôle social de ce secteur.
Vingt thèses sur l’actualité intempestive de l’enquête ouvrière
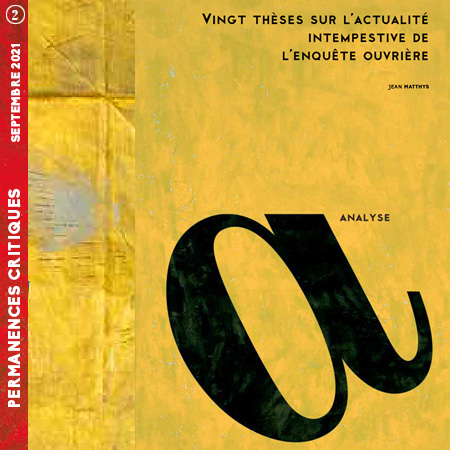
Enquêtes militantes, enquêtes ouvrières, enquêtes populaires : on ne peut que se réjouir de voir aujourd’hui la question de l’enquête resurgir, en discours et en actes, au sein du secteur associativo-militant. Nous avançons ici quelques réflexions concernant le statut de l’enquête comme pratique de production collective d’un savoir militant
