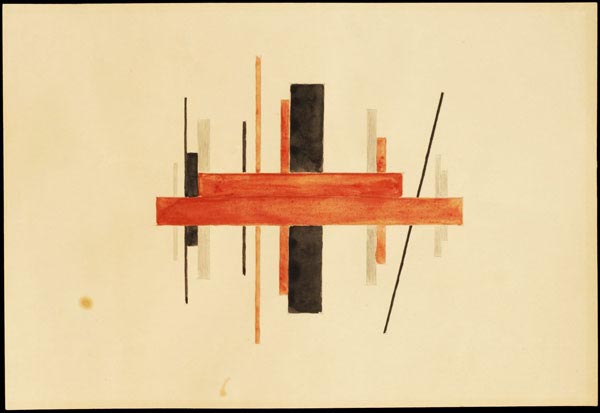Les limites des droits humains.
Plaidoyer pour la nécessité d’un nouveau registre de mobilisation dans la lutte contre la pauvreté
Introduction
Les droits humains[1] sont-ils une référence incontournable de la lutte contre la pauvreté ? Cette référence, surtout lorsqu’elle est prise comme guide unique de l’action associative, est-elle exempte de toute ambiguïté ? Ne comporte-t-elle pas des risques au premier abord imperceptibles ? Inversement, ne peut-on pas imaginer un registre de mobilisation autre que celui des droits humains ?
Cette étude vise à relancer ces questionnements à une époque où le référentiel des droits humains semble révéler son inefficacité, notamment dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, face au développement du néolibéralisme[2]. Pour ce faire, nous proposerons, en nous concentrant spécifiquement sur la Belgique, un bref historique de la montée en puissance et de l’entrée en crise du référentiel des droits humains comme registre de mobilisation, en étudiant la manière dont ces développements ont eu lieu en concomitance avec la transformation des politiques sociales de l’État par l’intégration de l’idéal néolibéral. Nous identifierons ensuite dans le concept de dignité humaine tel qu’il est appréhendé dans le référentiel des droits humains la source de l’impuissance actuelle de ce registre de mobilisation. En concluant, nous identifierons dans l’idée d’une oppression sans oppresseurs, qui n’est pas reconductible à un sujet de droit et qui ne peut être identifiée et combattue qu’à travers une nouvelle conception de la dignité des opprimés, la possibilité d’un changement de registre de mobilisation. Cette étude s’adresse donc avant tout aux personnes en prise avec la question des droits humains comme registre de mobilisation, aux travailleur.euse.s des institutions et des mouvements de lutte contre la grande pauvreté et de défense et promotion des droits humains et aux politiques en charges des politiques sociales.
1. Les droits humains, du sacre à la crise : bref historique d’un registre de mobilisation
1.1 Du sacre…
Depuis un quart de siècle, la référence explicite ou implicite aux droits humains constitue le registre de mobilisation[3] commun à la plupart des organisations du secteur associatif, dont les associations s’étant donné pour but la lutte contre la pauvreté sous toutes ses formes. Cependant, loin d’être l’apanage du secteur associatif, les droits humains, par une ascension fulgurante, sont devenus au cours des vingt-cinq dernières années la principale norme organisatrice de la conscience collective, en même temps que l’incarnation des valeurs fondamentales de l’ordre social et de l’action politique, s’instituant en véritable « langage hégémonique de la démocratie »[4]. Ce « sacre des droits de l’homme »[5] advient au terme d’une séquence historique particulière marquée par la crise puis l’effondrement de l’Union Soviétique, l’essor du néolibéralisme, l’ébranlement de l’État social, la crise concomitante des idéaux et référents théoriques marxistes, allant de pair avec l’affaiblissement des institutions et mouvements qui y puisaient leur orientation, notamment les syndicats, les partis communistes et les mouvements anti-impérialistes[6]. L’esprit de l’utopie et la volonté corrélative de sonder le sens de l’histoire en vue d’une transformation sociale révolutionnaire laissent leur place à l’exigence moins radicale mais d’autant plus pressante de dévoiler et redresser « les manquements au corps de normes autour duquel s’organisent l’accord et le débat général »[7] dans une société considérée comme étant désormais « pacifiée ». Dans ce cadre historique et idéologique, les droits humains se présentaient comme l’unique alternative globale et cohérente à des discours politiques largement discrédités, capable de relayer ces derniers dans leur fonction de fournir une orientation pour l’action sociale et politique.
Pour les organisations du secteur associatif de lutte contre les diverses formes de pauvreté, la référence aux droits humains signifiait en premier lieu une interprétation des situations de marginalisation et d’exclusion en termes de « décalages entre des droits formels, reconnus à tout individu et l’application effective de ces droits »[8]. Cela revenait à refouler l’intuition marxiste d’une société clivée par la lutte des classes pour partir du postulat d’une unité sociale déjà acquise où, en dernière analyse, tous les acteurs – publics comme privés – partageraient les mêmes valeurs et seraient donc capables d’agir en fonction d’intérêts communs. Dans un tel cadre interprétatif, l’État ne pouvait que devenir l’interlocuteur privilégié de l’action associative et militante, et ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un État qui parlait lui-même le langage des droits humains. C’est ainsi qu’une nouvelle confiance légaliste investit l’État de la fonction essentielle de pallier, par une législation et des politiques adaptées, les situations de marginalisation et d’exclusion, en réduisant l’écart entre les droits formels et le droit positif, ainsi qu’en améliorant l’effectivité de ce dernier. Du point de vue de l’action associative, la fonction du discours juridique consistait à recréer du collectif à partir d’acteurs isolés, hétérogènes, marginalisés et mal représentés, et à définir une stratégie de lutte commune, afin de parvenir à une interpellation efficace des pouvoirs et de l’opinion publique, notamment en formulant et en amplifiant les demandes de reconnaissance des intéressé.e.s[9].
La crédibilité de ce registre de mobilisation était indexée à la réorientation majeure des politiques sociales vis-à-vis du phénomène de la pauvreté (et de ses nouveaux avatars, tels l’« exclusion ») qui eut lieu dans certains pays européens à partir du milieu des années 70. Cette réorientation peut être décrite comme un dépassement progressif du programme de la réinsertion par le travail en faveur de l’idée de la réinsertion par l’accès aux droits fondamentaux, fondée sur une certaine conception de la dignité de la personne humaine[10]. D’un côté, cette évolution impliquait une juridicisation de la notion de pauvreté, cette dernière comprise désormais à la fois comme menace à l’encontre de l’exercice des droits humains et fondamentaux et comme conséquence de l’incapacité de les exercer[11]. D’un autre côté, la sortie de la logique de la contrepartie, fondée sur le devoir de travailler, vers une inconditionnalité de l’aide sociale, pointait en conséquence vers l’éventualité d’une sortie hors de la logique de l’assistance par le travail (ayant pour base l’idée d’un droit au travail), perçue non plus comme un chemin vers mais plutôt comme une entrave à l’effectivité des droits fondamentaux et à la véritable autonomie que celle-ci rendrait possible[12]. La Belgique est un pays où cette évolution est aisée à retracer : à la loi du 7 août 1974, instituant le droit à un minimum d’existence (« minimex ») succède la loi organique du 8 juillet 1976 des Centres Publics d’Aide Sociale (CPAS), qui fonde explicitement le droit à l’aide sociale sur le principe de la préservation de la dignité humaine[13]. Ce dernier principe est par la suite intégré dans la Constitution belge[14] et est considéré à partir de ce moment (17 février 1994) comme le fondement du droit à la sécurité et l’aide sociales[15].
1.2 … à la crise
Cependant, à partir des années 90 – la période de la consolidation du régime néolibéral –, on assiste à une ré-inflexion profonde des politiques sociales : celles-ci se réalignent sur le schéma séculier de l’insertion du pauvre par le travail – schéma qui est d’ailleurs loin d’avoir disparu dans la période précédente, pourtant favorable à une politique de la pauvreté basée sur l’exercice des droits fondamentaux – au détriment de la référence aux droits humains et à la dignité humaine. Avec ceci de spécifique que ce retour du schéma de l’insertion par le travail se produit dans une situation d’absence de travail, de chômage structurel de masse. Ainsi la loi du 12 janvier 1993 modifie-t-elle l’article 60, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 en conditionnant l’octroi de l’aide sociale à la « disposition au travail »[16]. Dorénavant et de manière tendancielle,
« [l]’octroi d’un minimum de revenus d’existence, qui serait désormais qualifié de ‘‘revenu d’intégration [sociale]’’, ne se justifierait que comme la contrepartie à la disponibilité et à la disposition du demandeur d’aide sociale à accepter un ‘‘emploi adapté’’ ou du moins à s’engager dans un projet d’intégration sur le marché de l’emploi (…). Du droit, établi sur base de l’état de besoin, on passerait – d’aucuns diraient qu’on reviendrait – au ‘‘mérite’’, évalué par le CPAS sur base des indications du législateur »[17].
Dans la même lignée défavorable à une politique de la pauvreté basée sur les droits humains, la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale introduit un élément nouveau en liant l’intégration sociale à la notion de « contrat d’intégration »[18]. Et J. Fierens de constater que « [l]’aide sociale aux plus démunis s’adapte ainsi à l’individualisme libéral qui tend à analyser toutes les relations politiques et humaines à travers la figure juridique du contrat »[19]. Depuis lors, les évolutions confirment le jugement de Fierens, puisque la tendance à la contractualisation s’est généralisée à tous les types de rapports entre les bénéficiaires ou usagers de prestations sociales en tous genres, d’un côté, et les pouvoirs publics, de l’autre. Ainsi Abraham Franssen note-t-il que, dorénavant, tout un ensemble de processus hétérogènes – prévention, formation, intervention, socialisation, orientation… –, à l’adresse des publics les plus divers, est envisagé sous la modalité du contrat et du « projet » : plan d’accompagnement pour les chômeurs, « sas »[20] pour les élèves en décrochage scolaire, « contrats de sécurité » pour les « jeunes délinquants »[21], projet individualisé d’intégration sociale (PIIS) pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (RIS)…[22] Loin d’être passée, la vague contractualiste grossit encore puisque, depuis le 1er septembre 2016, les CPAS ont désormais l’obligation légale d’imposer à tout nouvel usager la signature d’un PIIS. Cette loi, qui contient également d’autres mesures discutables ou problématiques, a reçu des critiques vigoureuses de la part d’associations du secteur non-marchand, et plus spécifiquement de l’éducation permanente[23], qui défendent les droits des plus démunis[24]. L’« activation » des bénéficiaires des prestations sociales – nouveau nom de l’insertion par le travail en l’absence de travail – et leur contractualisation illustrent bien le passage de l’État social à l’État social actif.
Cette évolution des politiques sociales, mettant à mal l’idée d’une « cohésion sociale » fondée sur les droits humains, ne doit pas être traitée séparément des atteintes récentes aux principes de base de l’État de droit, ainsi qu’aux droits humains et fondamentaux, portées au nom de la sécurité nationale et de l’ordre public. En effet, les mesures récentes en la matière sont symptomatiques d’un glissement général dans le rapport de l’État à ces droits : mentionnons d’abord la loi exigeant la levée du secret professionnel des membres du personnel de la sécurité sociale – notamment des CPAS – ainsi qu’une « information active » de leur part en cas de soupçon d’infraction terroriste[25] ; ensuite celle autorisant l’expulsion, sans condamnation par un juge, des étrangers résidant légalement et depuis une longue durée sur le territoire du Royaume, pour motifs de mise en danger grave de l’ordre public et de la sécurité nationale[26]. Comme le soulignent de nombreuses associations[27], ces deux lois – sans même mentionner ici des mesures et pratiques déjà en cours[28] – participent d’un véritable virage sécuritaire de l’État et sont à même de mettre à mal plusieurs piliers de l’État de droit ainsi que les droits humains et fondamentaux.
Si ces mesures sécuritaires et liberticides concernent de près la question de la lutte contre la pauvreté, ce n’est pas seulement parce que, dans les faits, elles impactent des populations majoritairement pauvres ou précarisés, mais parce qu’elles remettent en cause un présupposé essentiel de la stratégie des associations luttant contre la pauvreté sur la base de la défense des droits humains, à savoir que les pouvoirs publics sont des partenaires de fait dans la lutte pour le plein exercice de ces droits. Force est de constater que, pour ce qui concerne la question de l’engagement de l’État belge[29] en faveur d’un renforcement de l’effectivité des droits humains et fondamentaux, les tendances générales récentes en matière de politiques sociales et sécuritaires autorisent à tout sauf à l’optimisme. Il n’est dès lors pas surprenant que, confrontées à ce qui peut apparaître à certains comme un désintérêt de l’État social actif pour la dignité[30], des personnes pourtant fortement engagées pour la cause des droits humains en viennent à la conclusion fatidique selon laquelle, dorénavant, « les réponses (…) devront être cherchées en dehors du droit »[31].
1.3 Les conséquences possibles de la crise des droits humains comme registre de mobilisation
Cependant, avant d’avaliser une conclusion qui peut sembler excessive au premier abord, il convient de mieux cerner la signification des changements en cours. Que se joue-t-il dans le passage de l’État social à l’État social actif dont ces évolutions sont les manifestations ? À première vue, l’interprétation la plus plausible semble être celle, susmentionnée, selon laquelle cette transformation témoignerait d’un changement de paradigme dans les politiques publiques, se dévoilant sous les espèces du désintérêt de l’État social actif pour la cause des droits humains et de la défense de la dignité humaine. Certains auteurs soutenant cette thèse considèrent qu’au fondement de ce changement de paradigme se trouverait une sorte de loi historique qui veut qu’à une période de progression des politiques de la dignité succède, comme par contrecoup, une période de reflux, marquée par le retour en force des idéaux libéraux contractuels[32]. Nous serions donc aujourd’hui dans un telle période marquée par le mot d’ordre omniprésent de l’« activation », qui n’aurait dès lors « rien de récent ni d’original »[33] en tant qu’il ne serait que l’expression de la résurgence du vieux programme libéral – certes remis au goût du jour – d’insertion par le travail.
À y regarder de plus près, cette interprétation comporte toutefois plusieurs inconvénients. Tout d’abord, il semble plus plausible qu’au fondement desdites transformations se trouve non une quelconque « loi historique », mais la volonté bien plus banale des élites étatiques de s’adapter à la restructuration profonde du marché de l’emploi, elle-même effet des mutations contemporaines d’un capitalisme mondialisé débridé[34]. Ensuite, rien ne semble moins sûr que le désintérêt de l’État social actif pour la question de la dignité humaine, et c’est précisément l’analyse des dispositifs d’« activation » qui permet d’en prendre conscience. Comme nous l’avons montré dans une étude précédente[35], la mobilisation massive du registre de l’autonomie dans le cadre des dispositifs d’activation propres à l’État social actif produit des conséquences culturelles qui permettent à l’État de légitimer ses pratiques comme rétablissant la dignité de ses bénéficiaires alors même que ces pratiques ne cessent de donner lieu à ce qu’on pourrait appeler une production de l’indigne. Ainsi, loin d’avaliser la thèse de la « répétition du même », une telle analyse dessine bien plutôt les contours d’une conjoncture nouvelle et spécifique où la référence à la dignité garde toute son importance. Selon l’hypothèse que nous défendrons dans la suite de ce travail, c’est précisément en saisissant en quoi et pourquoi la dignité humaine intéresse au plus haut point l’État social actif que l’on parviendra à comprendre les raisons de l’impuissance croissante, dans le contexte présent, des droits humains en tant que registre de mobilisation ainsi que des pratiques qui y sont associées.
2. La notion kantienne de dignité comme fondement de l’injonction institutionnelle à la dignité
L’idée de dignité charrie un ensemble de représentations implicites qui permettent des usages divergents de la notion. Une définition rigoureuse de la dignité est d’autant plus urgente si l’on souhaite démontrer que la référence aux droits humains et plus particulièrement à la dignité humaine est centrale non seulement pour les associations de lutte contre la pauvreté et de défense des droits humains, mais aussi pour l’État de droit contemporain. Il s’agit là d’une situation qui est source d’une tension qu’il convient de mettre en lumière et d’analyser. Qu’est-ce qui rend possible cette référence commune à la dignité humaine par deux types d’institution aussi divergents que l’État et le monde associatif ? Quelle est la portée et la signification de la communauté de cette référence ? Quelles en sont les implications pour l’action associative ?
Ces questions appellent tout d’abord quelques remarques d’ordre historique. D’un point de vue textuel, la référence étatique comme associative à la dignité humaine se fonde sur la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui pose comme objectif la reconnaissance de la dignité de la personne[36]. Cette notion de dignité de la personne n’est toutefois pas explicitée par la Déclaration de 1948. Nous proposerons donc de remonter à ce qui nous semble constituer le lieu même de sa fondation, à savoir la philosophie morale du philosophe allemand Immanuel Kant (1724-1804)[37]. Si les cadres de cette étude ne nous donnent pas la possibilité de traiter en détail des questions philosophiques relatives à cette matrice, il convient néanmoins de mettre en lumière le caractère problématique de trois présupposés relatifs à la notion de dignité humaine telle qu’elle figure dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
On considère habituellement que, dans la tradition dont se nourrit la Déclaration, la dignité humaine serait quelque chose d’inconditionnel qui incomberait à l’homme en tant qu’homme et dont la reconnaissance s’imposerait à tout un chacun. Ceci n’est pourtant pas évident.
En effet, pour Kant, affirmer la dignité de quelque chose équivaut à affirmer que quelque chose a une valeur absolue, non traduisible sous la forme d’un prix, donc non échangeable sur le marché[38]. Est digne un être qui n’a pas de prix – c’est le sens de l’idée de « valeur absolue ». Dans la philosophie kantienne, la dignité est l’attribut de la personne. Or, ce que Kant entend par « personne » n’est pas ce que le langage courant entend par là. La « personne » au sens usuel du terme est ce qui singularise un individu, ce qui le rend unique. Pour Kant, il s’agit de l’inverse : la « personne » peut être définie chez lui comme l’élément générique, universel en l’homme, ce qui est pareil chez tout un chacun. La « personne » est ce qui reste de l’homme « empirique », concret, réel, une fois qu’il a été dépouillé par l’analyse philosophique de toutes ses caractéristiques singulières (son appartenance géographique, nationale, religieuse, ethnique, son histoire de vie familiale, individuelle, ses goûts, préférences, etc.). Or, ce qui est universel ou générique en l’homme, ce qui a la même « forme » chez tous les individus, c’est la raison, la rationalité. Dans la pensée kantienne, la « personne » est donc le « site » ou le « support » – accessible via l’abstraction philosophique – de la raison en l’homme.
Selon Kant, la raison n’est pas uniquement théorique, mais aussi pratique. En tant qu’elle est pratique, la raison se manifeste notamment sous la forme de l’autonomie. Pour le penseur allemand, l’autonomie est la capacité d’un sujet à décider de ses actions conformément aux règles universelles prescrites par la raison[39]. Or, à la lumière de la définition kantienne de la dignité, cela revient à dire que le critère permettant de distinguer entre ce qui a un prix et ce qui a une dignité est ce « potentiel humain universel à diriger sa propre vie selon des principes »[40]. Autrement dit, contrairement à un premier présupposé largement partagé, dans la tradition sur laquelle se fonde la Déclaration universelle des droits de l’homme, la dignité humaine n’est pas un attribut inconditionnel de l’être humain mais est indexée à sa capacité d’agir de manière autonome. Kant le dit de façon explicite : « L’autonomie est (…) le fondement de la dignité de la nature humaine et de toute nature raisonnable »[41]. En résumé, l’homme est digne dans la mesure où – et seulement dans la mesure où – il agit de manière autonome, c’est-à-dire conformément aux règles universelles prescrites par la raison.
Le second présupposé qu’il convient d’expliciter et de soumettre à la critique est que, dans la tradition kantienne, la dignité serait un attribut anthropologique. Ce dernier adjectif renvoie au fait que la dignité de l’homme concret, réel, découlerait de son appartenance à l’espèce humaine. L’homme serait digne parce qu’il est un homme. Or, ce second présupposé est étranger à la tradition kantienne dans laquelle s’ancre la Déclaration. Nous venons de voir en effet que la dignité de l’homme était en rapport avec sa capacité de conduire sa vie d’une manière autonome. Nous avons vu également que cette capacité était fondée dans la raison. Or, pour Kant, la raison n’est pas un attribut anthropologique, c’est-à-dire qui serait lié de façon essentielle à l’existence et au développement de l’espèce humaine. Pour le dire dans une formule lapidaire, pour Kant la raison n’est pas essentiellement humaine. Elle a certes son siège en l’homme, mais il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Kant est convaincu que d’autres créatures rationnelles peuvent exister de par l’univers et si c’était le cas, ce serait la même raison qui siégerait en chacune d’entre elles. Qu’à côté de l’homme l’on ne connaisse pas d’autres espèces vivantes qui soient porteuses de la raison n’est donc pas en soi un argument en faveur du caractère spécifiquement humain de la raison.
En toute rigueur, pour la tradition kantienne, l’humanité en tant qu’espèce peut aussi bien ne pas être raisonnable. Cela vaut à plus forte raison pour les individus de cette espèce qui, eux, ne sont manifestement pas nécessairement raisonnables et autonomes – comme les « aliénés », les jeunes enfants, et d’une manière générale toute personne jugée « immature ». Cette remarque a son importance quand on sait qu’encore à l’époque de Kant les femmes n’étaient pas considérées comme des êtres autonomes, sans parler des esclaves et peuples colonisés – « indigènes » des cinq continents – sous prétexte précisément de leur caractère supposément déraisonnable. En résumé, dans la tradition du kantisme, la dignité de l’homme concret, réel, ne lui est pas reconnue de par son appartenance à l’espèce humaine, mais par la possession de la faculté de l’auto-détermination selon des principes rationnels.
Le troisième présupposé qu’il nous faut étudier est de nature plus implicite que les deux précédents mais possède une importance égale. Il découle en réalité du second présupposé qui veut que la dignité soit un attribut anthropologique. Si tel était le cas, la reconnaissance de la dignité devrait s’imposer à tout un chacun comme une évidence dès lors que l’on est confronté à son semblable, à la forme corporelle d’un individu de la même espèce, que l’on reconnaît comme étant un corps humain, donc passible d’un traitement non-dégradant. Cependant, du moment que la reconnaissance de la dignité est indexée à la reconnaissance de l’autonomie d’autrui, et non à la simple reconnaissance de l’appartenance à la même espèce, les choses se compliquent. En effet, comme nous venons de le voir, l’autonomie n’étant pas un attribut anthropologique, sa « présence » chez un individu donné ne s’impose pas avec évidence à la perception. On ne peut jamais avoir l’évidence immédiate qu’autrui est autonome, c’est-à-dire qu’il use effectivement, dans ses actes et son « mode de vie », de sa faculté d’auto-détermination rationnelle. Pour revenir aux exemples évoqués plus haut, c’est précisément l’impossibilité de cette attestation immédiate de l’autonomie qui a permis aux puissances coloniales d’établir le « degré d’humanité » des peuples colonisés et/ou esclavagisés, ainsi que le « degré de leur infériorité » en fonction duquel les modalités de leur traitement devaient être déterminées[42].
Sur base de ces considérations, les deux principales caractéristiques de cette conception de la dignité semblent être sa conditionnalité – à savoir par rapport à l’autonomie – et son caractère empiriquement non-attestable. De cela découle que, contrairement à ce qu’affirme Jacques Fierens[43], la dignité, au sens où l’entend la tradition kantienne, ne peut être accordée que par un jugement, accompli par celui qui est réputé en avoir les compétences interprétatives et l’autorité juridico-politique.
Ce raisonnement se trouve confirmé par l’analyse de la juriste et psychanalyste Hélène Thomas de la suite de l’affaire dite du « lancer de nain ». Celle-ci s’est développée en France entre 1991 et 2002 et concernait une interdiction posée par les pouvoirs publics, pour raison d’atteinte à la dignité humaine, sur un spectacle consistant à lancer le plus loin possible sur des matelas, à l’aide d’un canon, une personne (munie d’une combinaison protectrice) atteinte de nanisme, Manuel Wackenheim[44]. Selon les dires du « nain », cette activité lucrative – probablement l’une des rares qui lui étaient ouvertes – lui permettait de bien gagner sa vie et d’échapper à la menace de tomber dans un statut socio-économique difficile qui l’aurait exposé à des conditions de vie dégradantes l’empêchant d’exercer ses droits et libertés civiles et civiques[45]. Le commissaire du gouvernement Frydman estimait au contraire que ce qui était en jeu dans cette affaire, c’était « la dignité des personnes de petite taille et de la personne humaine » en général, qui était entamée par l’activité du « nain ». Celui-ci, en faisant de sa condition corporelle un spectacle et une attraction, aurait engendré « un trouble à l’ordre et à la moralité publics »[46]. Le juge aura retenu l’argumentation du commissaire Frydman en assurant « l’égale dignité, ‘‘concept absolu, s’il en est’’ de tous en général et celle des gens de petite taille en particulier en confirmant l’interdiction d’un comportement indigne à un individu pour préserver à travers son humanité celle des autres »[47].
L’affaire du « lancer du nain » est exemplaire dans la mesure où elle permet de saisir la logique inhérente dans la notion kantienne de dignité, ainsi que les risques qu’elle comporte notamment dans le cadre du traitement du phénomène de la pauvreté. En effet, cette affaire met face à un cas où la dignité humaine est opposée à la personne de petite taille comme une obligation[48]. En d’autres termes, la personne en question fait l’objet d’une injonction institutionnelle à la dignité. Le « nain », en tant qu’il se vend lui-même en spectacle, est jugé eo ipso indigne. L’indignité du « nain » n’est pas son affaire personnelle car, en tant que violation des droits humains, elle atteint toutes les autres personnes humaines. Dès lors, le juge a estimé avoir l’obligation de mettre fin à sa « déchéance » en s’y opposant, contre son gré[49].
Comme il ressort de l’analyse d’H. Thomas, il s’agit là d’une situation classique de « double contrainte » qui est généralisable et applicable à toute personne connaissant des conditions de vie caractérisées par des atteintes régulières ou permanentes à la dignité, notamment aux personnes vivant dans la grande pauvreté. Le pauvre, afin d’échapper au moins en partie à des conditions de vie indignes, a recours à la solidarité nationale (l’aide sociale). En même temps, selon un préjugé social très répandu, le pauvre, avec sa « culture de la pauvreté »[50], son incivilité, son mode de vie, sa paresse, sa tendance à la toxicomanie, etc., trahirait quotidiennement et presque nécessairement la dignité humaine. Afin d’éviter que les fonds publics ne soient versés pour alimenter la reproduction indéfinie de cette indignité quotidienne qu’est la pauvreté, de nombreux citoyens estiment que l’exercice des droits fondamentaux du pauvre devrait être conditionné à sa bonne volonté manifeste de vivre dignement. Dans cette logique, « [l]e devoir de vivre avec dignité constitue (…) la contrepartie – morale et parfois juridique –, naturelle, prescrite au pauvre à qui l’aide publique est accordée »[51]. Cette mentalité est en phase avec le traitement séculaire des pauvres à travers l’histoire moderne : une fois bénéficiaires des aides sociales, « l’on attend d’eux discrétion, honte, retenue et modestie. Cela les contraint à se montrer ‘‘méritants’’ de ce devoir de la nation vis-à-vis d’eux, à se comporter de façon responsable et à prendre par avance la posture de la dignité recouvrée, alors même qu’elle est chez eux absente du fait de leur situation sociale »[52].
L’on comprend par-là pourquoi le mépris, le dégoût et la stigmatisation du pauvre sont tout à fait compatibles avec la défense de sa dignité humaine. Dans le paradigme kantien, cette compatibilité est rendue possible par la dévalorisation de la singularité, de l’être-ainsi de l’homme concret, réel, « empirique », qui est le revers de la survalorisation de cette qualité abstraite qu’est la capacité d’agir selon des principes. C’est cela qui permet la duplicité du rapport aux pauvres : d’un côté reconnaissance formelle de leur dignité en tant qu’ils sont des êtres capables d’autonomie ; de l’autre, domination, mépris et violence symbolique à leur encontre, en tant qu’êtres ignobles, hétéronomes, sans culture. Dans la même logique, si l’État et les associations de défense des droits humains s’accordent pleinement sur le fait que misère et pauvreté doivent être combattues, voire éradiquées[53], s’ils désirent ardemment la disparition de ces formes de vie perçues comme ignobles, n’est-ce pas parce qu’elles trahissent la conception de la dignité humaine implicite dans la Déclaration universelle des droits de l’homme ?[54] Il nous semble que c’est dans cette ambiguïté que réside la raison de la relative impuissance du discours des associations de défense des droits humains face au traitement répressif et dégradant des populations paupérisées par les politiques socio-sécuritaires de l’État.
En effet, cette ambiguïté de la notion de la dignité propre au référentiel des droits humains n’est pas due à une dérive ou à une interprétation abusive de la notion, mais elle y est inscrite comme une virtualité attendant son activation par les circonstances. C’est ce que rappelle H. Thomas lorsqu’elle renvoie au fait qu’avant que le philosophe Immanuel Kant en ait fait un singulier universel (« la » dignité), le mot « dignité » s’employait au pluriel, « les » dignités étant ces charges, fonctions et statuts socio-politiques qui conféraient à ses porteurs pouvoir et prérogatives d’un côté, devoirs et obligations, de l’autre[55]. Les dignités étaient donc l’expression du principe inégalitaire au fondement de l’ordre social oppressif de l’Ancien Régime. À la lumière de notre analyse de la notion kantienne de dignité, il n’est pas certain que le philosophe allemand et ses successeurs aient effectivement réussi à dépasser les connotations inégalitaires et répressives de l’idée des dignités au pluriel. Il se pourrait en effet que l’injonction contemporaine à la dignité réactive l’esprit antidémocratique des dignités de l’Ancien Régime en réintroduisant cet esprit au sein même du singulier universel de la dignité, faisant en sorte que
« [l]’impératif de jadis fait aux détenteurs de privilèges de conformer leur comportement à leur position éminente, d’agir avec maintien, mesure et retenue, s’impose aujourd’hui, de manière à peine transposée, à ceux qui, démunis de tout et de toute position, privés de dignités au pluriel, se voient menacés de l’être aussi au singulier, c’est-à-dire boutés hors de la famille humaine. (…) Cette dignité impose des obligations morales à tout homme qui n’en est que dépositaire, dans l’ordre social comme dans l’ordre politique. (…) Alors, de socle de la garantie de ses droits de citoyen, aux secours, à l’emploi, au logement, à l’éducation, etc., la référence devient injonction de se conformer à cette dignité menacée, perdue et de la reconquérir au nom de la ‘‘vie nue’’ et non qualifiée d’être humain. Cette injonction s’adresse à celui-là même qui est vu comme privé de par son état de pauvreté ou d’exclusion, de toute qualité sociale et ainsi de dignité afférente à un statut »[56].
On pourrait ajouter à cette généalogie du concept de dignité qui remonte aux dignités d’Ancien Régime, une deuxième généalogie qui rattache sa racine latine dignus à la compréhension de dignité promue par le néolibéralisme :
« Pour [de nombreux penseurs néolibéraux] la notion de dignité conservait une partie du sens original de sa racine dignus, qui signifiait valeur ou mérite. De la même manière que dignité était originairement un terme de réputation morale, les néolibéraux croyaient que seulement les individus autonomes et responsables pourraient mener des vies dignes. Rechercher de l’aide sociale de l’Etat, depuis cette perspective, était intrinsèquement indigne. Pour les néolibéraux, la dignité requerrait un ordre compétitif dans lequel les individus seraient responsables de leur destin »[57].
Cet état de fait possède des implications importantes pour la question du rapport entre la logique de la contrepartie et la logique de l’inconditionnalité des aides sociales fondée sur l’idée de l’égale dignité de tous. En effet, s’il est vrai que ces deux logiques, que tout semblait opposer, demeurent divergentes, à la lumière de notre analyse de la notion de dignité, leur opposition n’apparaît plus comme étant absolue. Il ressort désormais que la logique de la contrepartie – avec tout l’appareillage socio-sécuritaire qu’elle implique – est non seulement conciliable avec la défense de la dignité, mais est même fondée sur cette dernière, et cela sans que l’on puisse accuser l’État d’opérer un détournement du sens de la notion. Comme nous venons de le voir, cela tient à l’ambiguïté constitutive de la conception occidentale moderne de la dignité, qui ne parvient pas à dépasser les accents moralisateurs, inégalitaires et différencialistes de la conception traditionnelle[58]. Là réside la raison pour laquelle, contrairement à ce qu’affirme Jacques Fierens, la dignité intéresse au plus haut point l’État social actif. Aussi, du point de vue de l’action associative fondée sur la référence aux droits humains, la difficulté tient-elle à ce que la logique de la contrepartie, supposée contrariée par la logique de l’inconditionnalité, se fonde en réalité elle aussi sur la notion de dignité véhiculée par le discours des droits humains. La conséquence pratique de cet état de fait est que les associations de lutte contre la pauvreté restent démunies face aux dispositifs de l’État social actif participant à la production de conditions de vie indignes. C’est en cela que réside selon nous la nécessité d’élaborer un registre de mobilisation qui ne s’appuie plus prioritairement sur l’idée de dignité propre au discours de défense des droits humains.
Conclusion
Afin de proposer quelques éléments permettant d’ouvrir sur une telle élaboration, il importe de repartir de l’indignité produite de manière quotidienne par les dispositifs de l’État social actif en s’appuyant sur la dévalorisation de la singularité, de l’être-ainsi de l’homme concret, réel, rendue possible par la notion de dignité humaine que ces dispositifs partagent avec le discours des droits humains[59]. Rappelons en effet que l’inscription de la dignité dans les instruments juridiques nationaux et internationaux intervient en réaction à une séquence d’événements parmi les plus destructrices que l’humanité ait connues, à savoir la seconde guerre mondiale, avec ses génocides – dont celui des Juifs et des Tziganes –, ses meurtres de masse, ses bombes nucléaires, ses millions de réfugiés… La conscience de la nécessité d’une protection juridique et politique de la dignité humaine apparaît à la suite d’une intensification spectaculaire et pour ainsi dire « globalisée » de l’expérience de l’indignité. Or, si ce sursaut est compréhensible et est même à saluer, il est aussi le signe d’un scandale permanent, à savoir de l’insensibilité sociale envers les formes de l’indignité quotidienne, parmi elles celles qu’ont dû expérimenter les populations paupérisées depuis le début des Temps modernes. Paradoxalement, loin d’avoir attiré l’attention sur l’expérience de l’indignité quotidienne, l’inscription du principe de défense de la dignité humaine contre ses violations paroxystiques dans les textes juridiques fondateurs de l’ordre mondial post-1945 a eu pour conséquence corollaire la consolidation de l’insensibilité face à cette expérience. En un sens, prendre les meurtres de masses et les actes de torture – qui restent malgré tout, dans les États de droit contemporains, des exceptions et non la règle – comme mesure de violation de la dignité met la barre de la sensibilité à l’indignité trop haut pour que des expériences de l’indignité, moins intenses mais plus décisives en raison de leur caractère structurel, puissent atteindre le seuil de réaction du citoyen moyen[60].
À la relative indifférence sociale au sort des groupes sociaux vivant l’indigne au quotidien correspond la difficulté extrême d’exiger les droits afférents au principe de l’inviolabilité de la dignité humaine auprès des juridictions des États de droits occidentaux : ne pouvant être dites volontaires ni imputées à un auteur spécifique, les atteintes à l’intégrité de la personne, même si elles sont constatées par le juge, rendent très rarement possible au justiciable – souvent représenté par des associations de défense des droits humains – d’exiger réparation[61]. En même temps, le caractère proprement désespéré de la plupart de ces recours ne semble pas fondamentalement affecter la stratégie desdites associations, consistant à organiser leurs actions autour de l’axe de revendication juridique. Dès lors, la question se pose de savoir, d’un côté, pourquoi les juridictions peuvent si facilement débouter les demandes de réparation des requérants, et de l’autre, pourquoi les associations de défense des droits humains éprouvent une difficulté à aller au-delà de la répétition contrainte du même – les recours juridiques souvent mis à l’échec – et pourquoi elles ne parviennent pas à questionner sous un angle critique les ressorts de ce blocage juridique.
Pour pouvoir répondre à ces questions, il faut se rendre compte que le véritable problème des requêtes déboutées malgré leur légitimité apparente par les divers tribunaux n’est pas avant tout d’ordre juridique, mais bien idéologique. Le point névralgique de l’argument « officiel » de l’État réside moins dans ce qu’il dit – à savoir que l’absence d’intentionnalité et l’impossibilité d’identifier un auteur en particulier dans les cas des atteintes « quotidiennes » à la dignité rend inexigible la garantie effective par l’État des droits humains et fondamentaux –, que dans une conséquence tacite de ce constat. Dire en effet que seule une atteinte volontaire à la dignité perpétrée par un acteur identifiable est passible d’une réparation juridique suggère tacitement qu’il n’y a pas de sens à parler d’atteintes à la dignité humaine qui ne soient pas les résultats d’une action concertée par des acteurs sujets-de-droit. Le phénomène nié par cette argumentation n’est rien d’autre qu’un type d’atteinte à la dignité humaine qui est structurelle car institutionnellement orchestrée, sans pour autant être l’œuvre préméditée de personnes particulières. Tant que ce phénomène ne sera pas reconnu, on ne pourra rien objecter à la ligne de défense de l’État face aux réclamations de garanties effectives des droits humains et fondamentaux. Car qui pourrait sensément prétendre que, dans nos sociétés démocratiques, l’indignité quotidienne en tant que le lot de celles et ceux vivant en grande pauvreté ou en grande précarité serait produite de façon volontaire, conformément à quelque plan diabolique forgé par une minorité tyrannique ? C’est dans le gouffre ouvert par l’impossibilité de reconnaître, à travers la notion de dignité humaine propre au registre des droits humains, une atteinte à la dignité structurelle et institutionnellement organisée que se niche la notion de dignité promue par l’État social actif (dont nous avons explicité les sources communes avec le registre des droits humains). Car si seul un sujet-de-droit peut être tenu responsable d’atteintes à la dignité humaine, et si un tel sujet ne peut pas être identifié, la faute retombe de nouveau sur le sujet « indigne » lui-même.
La reconnaissance d’une injustice systémique, subie entre autres en vertu de la gestion administrative, de surcroît « bien intentionnée », de la vie des populations vivant sur le territoire des États de droits suppose donc d’admettre l’existence d’une forme d’oppression sans oppresseur, qui caractériserait une société – la nôtre – pourtant réputée « libre ». À la différence de la notion classique d’oppression, qui renvoie à la tyrannie qu’une minorité exerce ouvertement sur certains groupes sociaux, voire sur l’ensemble de la société, ce concept d’oppression – théorisé par la philosophe américaine Iris Marion Young – dénote un ensemble de « processus systématiques et institutionnels qui entravent l’apprentissage ainsi que l’usage satisfaisant et étendu de compétences dans des contextes socialement reconnus », ou encore « des processus sociaux institutionnalisés qui inhibent la capacité des personnes à composer et communiquer avec autrui, ou d’exprimer leurs sentiments et perspectives sur la vie sociale dans des contextes où ils sont écoutés »[62].
Or, reconnaître l’existence d’une telle oppression systémique au sein de nos sociétés, à laquelle l’État participerait d’une manière active, quoique pas nécessairement programmatique, remettrait en question l’un des postulats de base du discours des droits humains, qui est le caractère pacifié et unifié des sociétés occidentales. En effet, bien qu’il soit malaisé d’identifier des groupes concrets organisant consciemment l’oppression d’autres groupes sociaux, il n’en demeure pas moins que le fondement et l’enjeu de l’oppression consistent en la reproduction des privilèges que certains groupes possèdent par comparaison avec d’autres groupes, dits dominés ou opprimés. La rationalité de l’oppression réside dans la reproduction d’une structure sociale inégalitaire qui permet des privilèges pour certains au prix de l’oppression d’autrui[63]. Dans cette optique, la société n’est donc ni unifiée ni pacifiée, mais elle demeure clivée et traversée par des luttes entre intérêts proprement inconciliables.
Cette vision des rapports sociopolitiques contrarie la lecture de la réalité sociale selon laquelle les situations d’injustice sociale seraient traductibles en termes de décalage entre droits formels, revenant à tous, et faisant l’objet d’un accord général, et l’exercice réel de ces droits, interdit à certains. Dans cette optique, la pauvreté serait le résultat du dysfonctionnement contingent d’un système socio-économique et politique – la société de marché globalisée – fondamentalement bon et fonctionnel ; un dysfonctionnement qui serait donc par essence réparable. Dans cette mesure, quelques ajustements institutionnels d’envergure, opérés par des organismes internationaux comme l’ONU, la Banque Mondiale et le FMI, suffisent pour se débarrasser de la misère, perçue avant tout en tant que problème moral[64]. En revanche, pour une perspective partant de l’idée d’« oppression sans oppresseur », la conception basée sur les droits humains masque le fait que le « décalage » en question n’est pas une imperfection contingente d’une société pacifiée et unifiée, corrigible moyennant une action juridique concertée des grandes organisations internationales, mais l’expression nécessaire d’un mode d’organisation politique, économique et sociale dont la transformation suppose des changements d’ordre structurel, en amont de toute codification juridique. C’est pourquoi, de ce point de vue, dans le cadre de la distribution inégale des pouvoirs, des compétences et des privilèges s’accomplissant moyennant la médiation de l’État – notamment via ses politiques socio-sécuritaires –, la stratégie d’interpellation des pouvoirs publics et leur éventuelle invocation devant les tribunaux paraissent participer autant de la légitimation que de la contestation de l’ordre social inégalitaire. Il faut donc s’efforcer de les dépasser dans le sens du déploiement d’une analyse des structures productrices d’oppression systémique, analyse capable de soutenir une véritable stratégie de transformation structurelle. Pour ce faire, il est essentiel de se questionner sur le sujet même d’une telle analyse. Il faut donc se poser la question de la co-recherche menée avec les personnes qui subissent une atteinte à la dignité humaine, méthode de réflexion et d’action collective à laquelle l’éducation permanente peut contribuer de manière significative[65]. C’est une nouvelle figure de la dignité – ancrée dans le mouvement par lequel un opprimé se reconnaît en tant qu’opprimé, pense la situation qui lui est faite et lutte pour la transformer –, la figure de la dignité de l’opprimé en tant qu’opprimé, qui pourrait émerger d’un tel travail[66].
Gabor TVERDOTA
Philosophe. Professeur à Villanova University, Philadelphie, USA
- [1] Sauf dans les citations et les titres d’ouvrages, nous privilégierons la dénomination « droits humains » à celle, classique, de « droits de l’Homme ».
- [2] « Les droits humains sont restés principalement rhétoriques dans leurs incursions dans le domaine socioéconomique, alors que le néolibéralisme a transformé profondément le globe » (MOYN, S., « A Powerless Companion : Human Rights in the Age of Neoliberalism », Law and Contemporary Problems, 77, 2015, p. 168, pour les ouvrages disponibles seulement en langue anglaise, la traduction est la nôtre). L’auteur souligne par ailleurs qu’il ne faut pas oublier que le registre des droits humains et celui de la lutte pour une égalité matérielle ne sont pas a priori synchronisés : « Dans leur forme légalisée, les droits humains ne visent pas à proposer un agenda égalitaire. Il est parfaitement possible d’imaginer un régime de protection des droits humains pleinement accompli localement et globalement qui serait en même temps caractérisé par la pire hiérarchie de richesses et autres biens primaires connue dans l’histoire » (ibid. p. 161).
- [3] En se basant sur l’ouvrage de TILLY, V. C., From Mobilization to Revolution, Reading (Massachusetts), Addison-Wesley, 1978, MARTIN Ph. et POUCHADON M.-L. définissent le concept de registre de mobilisation comme « un thème mobilisateur reposant sur un discours et une logique revendicatifs spécifiques », permettant de structurer l’action collective à partir d’une interprétation spécifique du sens du conflit social (« Les chômeurs et leurs droits : itinéraire d’une mobilisation collective », Droit social, N° 7/8 Juillet-Août 2000, p. 746.)
- [4] GAUCHET, M., « Quand les droits de l’homme deviennent une politique », Le Débat, 2000/3 n° 110, p. 260 et 283.
- [5] Ibid., p. 258.
- [6] Le fait que la montée en puissance du référentiel des droits humains s’opère dans la période finale de la guerre froide, ayant opposé, dans l’imaginaire occidental dominant, le monde de la liberté – l’Europe capitaliste et les États-Unis, ainsi que leurs alliés – au monde de l’oppression – le bloc Soviétique et ses alliés, explique la cooptation de ce référentiel par des projets impérialistes, qui ont voulu tirer leur légitimité du prétendu non-respect des droits humains dans les lieux de leurs interventions. Dans cette étude, nous ne nous concentrerons pas sur l’usage géopolitique du référentiel des droits humains ; nous étudierons exclusivement son usage « domestique » dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.
- [7] Ibid., p. 283.
- [8] MARTIN Ph., POUCHADON M.-L., « Les chômeurs et leurs droits : itinéraire d’une mobilisation collective », art. cit., p. 746.
- [9] Pour une fondation philosophique de ces discours et pratiques, voir HABERMAS, J., Droit et démocratie. Entre faits et normes, tr. fr. Rochlitz, R. et Bouchindhomme, C., Paris, Gallimard, 1997.
- [10] ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, LGDJ, 221, Coll. Bibliothèque de droit public, 2002, 2-275-02152-3. <hal-01080534>, p. 378. Voir aussi THOMAS, H., « Du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’Etat social », Raisons politiques, 2002/2 (n° 6), pp. 37-52.
- [11] Voir entre autres FIERENS, J., « Le coup de Jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique et dans l’action sociale », dans : Van Der Plancke, V. (dir.), Les droits sociaux fondamentaux dans la lutte contre la pauvreté, Bruxelles, La Charte (coll. « Droit en mouvement »), 2012, p. 106 : « Est pauvre celui à qui ne sont pas reconnus ou qui n’est pas en mesure d’exercer ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. » Pour un exposé de l’évolution doctrinale et politique ayant mené à la redéfinition juridique de la pauvreté, ainsi que ses implications, voir ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, op. cit., pp. 378-385, 442, 445-446.
- [12] ROMAN, D., Le droit public face à la pauvreté, op. cit., p. 379.
- [13] Article 1er, alinéa 1er de la Loi organique des Centres Publics d’Aide sociale du 8 juillet 1976.
- [14] Article 24bis, alinéa 1er de la Constitution belge.
- [15] FIERENS, J., « Le coup de Jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique et dans l’action sociale », art. cit., p. 104. À ce compte-rendu, il convient cependant d’apporter un amendement majeur. En effet, autant les adeptes (comme J. Fierens) que les critiques (comme H. Thomas, voir notamment son article cité dans la note 10) de la centralité de la notion d’« égale dignité » – socle de toute « politique » des droits humains – sont unanimes pour souligner la difficulté, voire la réticence extrême des jurisprudences nationales et internationales à concrétiser le principe de défense de la dignité de la personne humaine (pour des exemples concrets, voir Fierens, J., « La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels », Revue belge de droit international, Bruylant, Bruxelles, 1999, pp. 47-57.) Certains, comme J. Fierens, osent tirer la conclusion que la coïncidence de la norme et du réel s’avère dans ce cas incompatible avec le régime social et politique qui est le nôtre : « si le droit admet ce que beaucoup d’humanistes voient comme une évidence, à savoir que la pauvreté et la misère constituent une violation flagrante du droit à une vie digne de ce nom ou du droit d’être protégé contre un traitement inhumain ou dégradant, les conséquences d’une telle constatation juridique seraient incalculables. Ni le législateur, ni les tribunaux, ni les juristes ne sont prêts à les assumer » (Ibid., p. 56-57.)
- [16] FIERENS, J., « Le coup de Jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique et dans l’action sociale », art. cit., p. 115.
- [17] FRANSSEN, A., « L’Etat social actif et la nouvelle fabrique du sujet », In : ASTIER, I., DUVOUX, N., La société biographique : une injonction à vivre dignement, Paris, L’Harmattan (coll. « Logiques sociales »), 2012, p. 78.
- [18] Article 6, § 2.
- [19] FIERENS, J., « Les droits des plus défavorisés à une aide sociale : une réplique désespérée à l’idéologie contractuelle triomphante », dans : VERDUSSEN, M. (dir.), Les droits culturels et sociaux des plus défavorisés, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 572.
- [20] « Service d’accrochage scolaire ». Pour les dispositifs mis en place dans ce cadre, voir le décret du 1er septembre 2014, à l’adresse http://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/39909_001.pdf.
- [21] Sur les « contrats de sécurité », voir De Fraene, D., et Delens-Ravier, I., « Des limites de l’aide et de la protection à l’émergence d’une nouvelle figure de dangérosité », Jeunesse & Droit Journal, Liège, n° 199 – novembre 2000, pp. 4-13.
- [22] FRANSSEN, A., « L’Etat social actif et la nouvelle fabrique du sujet », In : ASTIER, I., DUVOUX, N., La société biographique : une injonction à vivre dignement, Paris, L’Harmattan (coll. « Logiques sociales »), 2012, p. 76.
- [23] Voir par exemple les réactions de la FéWASC, « Généralisation obligatoire du PIIS », www.uvcw.be/no_index/…/240-53993792402404262016045341571335562176.pdf ; d’ATD Quart Monde, « Contrat obligatoire entre les CPAS et les bénéficiaires du RIS : une mesure injuste », posté le 6 avril 2016, http://www.atd-quartmonde.be/Contrat-obligatoire-entre-les-CPAS-et-les ; de Christine Mahy, secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Jean Blairon, directeur de l’asbl RTA, « CPAS, majorité fédérale et mensonges d’Etat », Intermag.be, analyses et études en éducation permanente, RTA asbl, avril 2016, URL : www.intermag.be/560.
- [24] Pour que le tableau soit plus complet, il conviendrait d’adjoindre à ces mesures le durcissement considérable des conditions d’octroi des allocations chômage (dans le cadre de l’« activation » des chômeurs : voir sur cette question le dossier thématique « chasse aux chômeurs » de la revue Ensemble !, n° 90, Mars 2016), ainsi que, bien entendu, la notable réduction de leur volume et leur dégressivité (sur cette question, voir GALAND, S., « La dégressivité renforcée des allocations de chômage : quel effet sur la pauvreté ? », La Revue Nouvelle, n° 6/7, juin-juillet 2014). On sait également que, depuis le début de l’année 2017, la vague activatrice a atteint les malades de longue durée et les personnes souffrant d’un handicap, qui sont désormais sommées par la Ministre de la Santé à se défaire de leur « irresponsabilité » en réintégrant le marché du travail…
- [25] Sur ce point, voir entre autres les communiqués et protestations très énergiques : de la Fédération des CPAS, « Le secret professionnel (en CPAS), une valeur fondamentale en danger ! », http://www.avcb-vsgb.be/fr/le-secret-professionnel-une-valeur-fondamentale-en-danger.html?cmp_id=7&news_id=5320; du Front peu commun, « Le secret professionnel : une valeur fondamentale des droits sociaux en danger », http://www.liguedh.be/espace-presse/138-communiques-de-presse-2017/2776-le-secret-professionnel-une-valeur-fondamentale-des-droits-sociaux-en-danger ; de la Fédération Wallonne des Directeurs généraux de C.P.A.S. (centre public d’action sociale) – ASBL, « Les directeurs généraux des CPAS wallons s’opposent à la levée partielle du secret professionnel », www.uvcw.be/no…/cpas/…/314-57189793330302092017030851633819049762.pdf.
- [26] Voir à ce sujet le communiqué de la Ligue des Droits humains, « Non aux citoyens de seconde zone », posté le 6/3/2017, http://www.liguedh.be/espace-presse/138-communiques-de-presse-2017/2789-non-aux-citoyens-de-seconde-zone.
- [27] Voir les deux notes précédentes.
- [28] FIERENS, J., « Le coup de Jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique et dans l’action sociale », art. cit., p. 124.
- [29] Bien entendu, la Belgique est loin d’être le seul pays où ces évolutions peuvent être observées. De manière certes inégale, cette tendance est présente dans l’ensemble des pays de l’Union Européenne, jusqu’au niveau de la gouvernance de l’Union elle-même.
- [30] FIERENS, J., « Le coup de Jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique et dans l’action sociale », art. cit., p. 126.
- [31] FIERENS, J., « Les droits des plus défavorisés à une aide sociale : une réplique désespérée à l’idéologie contractuelle triomphante », art. cit., p. 575.
- [32] Ibid., p. 569-570.
- [33] FIERENS, J., « Le coup de Jokari. L’image du pauvre dans l’assistance publique et dans l’action sociale », art. cit., p. 99.
- [34] Le constat n’est pas neuf : il était déjà celui de LAVILLE, J.-L., il y a plus de vingt ans de cela dans « La crise de la condition salariale : emploi, activité et nouvelle question sociale », Esprit, No. 217 (12) (Décembre 1995), pp. 32-54.
- [35] TVERDOTA, G., L’Etat social actif et ses pauvres. Réflexions sur la dimension culturelle des politiques d’activation, Etude de l’ARC, 2017 : https://arc-culture.be/blog/publications/letat-social-actif-et-ses-pauvres-reflexions-sur-la-dimension-culturelle-des-politiques-dactivation/.
- [36] RICARD, M.-A., « Le défi du politique », dans DE KONINCK, Th., LAROCHELLE, G., La dignité humaine. Philosophie, droit, politique, économie, médecine, Paris, PUF, 2005, p. 90.
- [37] Ibid. et FIERENS, J., « Les droits des plus défavorisés à une aide sociale : une réplique désespérée à l’idéologie contractuelle triomphante », art. cit., p. 575.
- [38] KANT, I., Métaphysique des mœurs I, Fondation de la métaphysique des mœurs [1795], tr. fr. Renault A., Paris, GF-Flammarion, 1994, p. 116.
- [39] Dans le langage technique de Kant : de diriger ses actions en fonction de maximes pouvant prétendre à l’universalité, c’est-à-dire pouvant valoir pour tout être raisonnable possible, voir ibid., pp. 111-116.
- [40] TAYLOR, Ch., Multiculturalisme : différence et démocratie [1992], tr. fr. Canal, D.-A., Paris, Flammarion (coll. « Champs »), 1997, p. 61 (souligné dans le texte).
- [41] Ibid., p. 117 (souligné dans le texte).
- [42] Pour ne prendre que quelques exemples dans une vaste littérature, nous renvoyons à Fabre, M., « La controverse de Valladolid ou la problématique de l’altérité », Le Télémaque, 2006/1 (n° 29), p. 7-16, URL : http://www.cairn.info/revue-le-telemaque-2006-1-page-7.htm, à Edda, M., « Le retour de la guerre juste. Francisco de Vitoria et les fondements juridiques de la domination globale », L’Homme et la société, 2010/1 (n° 175), p. 13-38, URL : http://www.cairn.info/revue-l-homme-et-la-societe-2010-1-page-13.htm, ainsi qu’aux ouvrages « classiques » de la théorie raciale par GOBINEAU, J., A., de, Essai sur l’inégalité des races humaines [1853-1855], Paris, Editions Pierre Belfond, 1967 et par Porot, A., « Notes de psychiatrie musulmane », Annales medico-psychologiques, 1918, 74, p. 377-384.
- [43] « La dignité humaine en tant que telle ne peut être accordée par jugement », FIERENS, J., « Les pauvres, leurs avocats et l’hypomochlion », dans Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale/Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (eds.), Pauvreté – dignité – droits de l’homme, Les 10 ans de l’accord de coopération, Bruxelles, décembre 2008, p. 51.
- [44] Article « Dignité », par Baertschi, B., in L’Encyclopédie Philosophique [en ligne], URL : http://encyclo-philo.fr/dignite-a/.
- [45] THOMAS, H., « Du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social », in Raisons Politiques, n° 6, 2002, p. 45.
- [46] Ibid.
- [47] Ibid.
- [48] Ibid., p. 47.
- [49] Ibid., p. 45.
- [50] Il s’agit d’une référence (ironique) à l’ouvrage de l’ethnologue américain Lewis, O., La vida : A Puerto Rican Family in the Culture of Poverty – San Juan and New York, Random House, 1966. Selon cet auteur, la perpétuation de la pauvreté chez certaines populations nord-américaines aurait des raisons d’ordre culturel. Une prétendue « culture de la pauvreté » – c’est-à-dire un ensemble de valeurs, de comportements et d’attitudes – foncièrement différente de celle des populations plus aisées, constituée initialement en réaction à une exclusion sociale mais intégrée et rigidifiée par les générations successives, ferait que les pauvres sont congénitalement incapables de s’intégrer dans la société.
- [51] THOMAS, H., « Du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social », art. cit., p. 48.
- [52] Ibid.
- [53] Selon le titre d’un ouvrage dirigé par GODINOT, X., Eradiquer la misère. Démocratie, mondialisation et droits de l’homme, Paris, PUF, 2008. Nous reviendrons plus loin sur les implications du vocabulaire de la « lutte contre la pauvreté ».
- [54] Voir notamment le point E/97/b) du Rapport Despouy sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté : « Eu égard aux effets pernicieux que la pauvreté a sur la vie matérielle et spirituelle de l’individu, son élimination de la surface du globe est un impératif moral, social, politique et économique de notre temps. Ainsi considérée, l’extrême pauvreté apparaît comme un outrage à la dignité humaine. Elle empêche l’individu de jouir pleinement de ses droits et le place dans une situation telle qu’il lui est impossible d’assumer ses responsabilités. » Pour être juste, il faut mentionner ici qu’un défenseur aussi résolu de l’approche de la pauvreté en termes de droits de l’homme que le juriste belge Patrice Meyer-Bisch a parfaitement entrevu le caractère problématique du langage courant des associations adhérant à cette approche. Il n’empêche cependant – et nous y reviendrons sous peu – que cette intuition valable ne permet pas à elle seule de résoudre les antinomies de l’approche en question. Voir MEYER-BISCH, P., « Le droit à participer à la vie culturelle, premier facteur de liberté et d’inclusion sociale », dans Le rôle de la culture dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, Service général de la Jeunesse et de l’Education permanente, Administration générale de la culture (eds.) (Coll. « Culture Education permanente »), N°19, 2013, p. 59, n. 44.
- [55] THOMAS, H., « Du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social », art. cit., p. 43. Il n’est pas superflu de rappeler que le texte kantien contient des passages moins connus qui témoignent de la difficulté éprouvée par le philosophe à débarrasser la nouvelle notion de dignité de ses « connotations hiérarchiques et différencialistes » (H. Thomas, art. cit., p. 51). Un tel passage se trouve dans la Métaphysique des mœurs (1795) où Kant écrit expressis verbis que « L’humanité est une dignité ». L’usage du verbe être (au lieu du verbe avoir) et de l’article indéfini signale la persistance de l’idée traditionnelle des dignités : l’homme est séparé de son humanité, qui est comprise en tant que statut qui se mérite, à savoir par l’exercice de la faculté d’autonomie.
- [56] Ibid., pp. 43 et 49.
- [57] WHYTE, J., The Morals of the Market. Human Rights and the Rise of Neoliberalism, London-New York, Verso, 2019, p. 27.
- [58] THOMAS, H., « Du lancer de nain comme canon de l’indignité. Le fondement éthique de l’État social », art. cit., p. 51.
- [59] L’idée de l’indignité quotidienne, ou encore de la quotidienneté indigne, est l’un des apports majeurs de l’ouvrage de AJARI, N., La dignité ou la mort. Éthique et politique de la race, Paris, La Découverte, 2019. Sur base de ce livre, nous avons analysé la manière dont les associations d’éducation permanente peuvent contribuer à lutter contre l’invisibilisation de l’indignité quotidienne en aidant les opprimés à se reconnaître en tant qu’opprimés – ce qui peut aboutir à une définition de la dignité différente de celle propre à la tradition kantienne dans TVERDOTA, G., L’Etat social actif et ses pauvres. Réflexions sur la dimension culturelle des politiques d’activation, op. cit.
- [60] Cf. AJARI, N., La dignité ou la mort, op. cit., p. 29-30, 67, 86.
- [61] Ibid., p. 42. Voir aussi Fierens, J., « La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels », art. cit.
- [62] YOUNG, I. M., Justice and the Politics of Difference, Princeton/New Jersey, Princeton University Press, 1990, p. 38
- [63] Voir ibid., pp. 42 et 53.
- [64] Pour une expression paradigmatique de ce traitement de la question de la pauvreté, le lecteur se rapportera avec profit au Rapport Despouy sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté [en ligne], accessible à l’URL : https://fr.wikisource.org/wiki/Le_rapport_Despouy_sur_les_droits_de_l’homme_et_l’extr%C3%AAme_pauvret%C3%A9.
- [65] Sur cette question, voir MARION, N., TVERDOTA, G., « Mélancolie de gauche, enquêtes ouvrières et éducation permanente », Cahiers du GRM, n° 13, 2018.
- [66] Nous donnons des éléments pour penser cette nouvelle figure de la dignité dans TVERDOTA, G., L’Etat social actif et ses pauvres. Réflexions sur la dimension culturelle des politiques d’activation, op. cit.