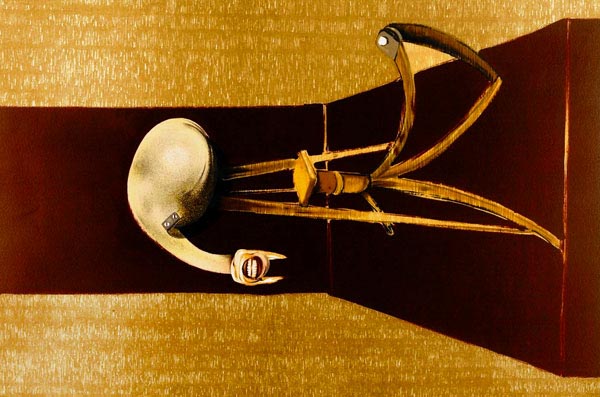INTRODUCTION
Le fait de s’exprimer est-il politique par lui-même ? Est-ce le pouvoir de s’exprimer qui – dès lors qu’il excite ce lieu commun de la gauche qu’est le « pouvoir d’agir » – nous autorise à penser « politique » dès lors que nous pensons « expression » ? L’enjeu semble trivial, mais ce n’est là qu’une apparence, en particulier quand – à l’instar de nombreux opérateurs culturels, associatifs et militants – on est amené à vouloir ou à devoir favoriser et soutenir « l’expression culturelle »[1] du peuple. Nous pourrions aussi nous demander s’il suffit de s’exprimer, ou de pouvoir s’exprimer, pour faire de la politique, car apparaît là – en filigrane – le problème dont la présente étude fera l’objet : à partir de quand, c’est-à-dire en fonction de quelles coordonnées sociales, culturelles, historiques et politiques, l’expression est-elle devenue un enjeu politique fondamental ? Plus généralement, à partir de quelles circonstances toute politique émancipatoire est-elle devenue liée, intimement et réciproquement, à la question de l’expression et, à partir de là, de la « participation » ? Enfin, sous l’effet de quelles puissances peut-on être amené à distinguer, parmi la multitude des formes d’expression existantes, celles qui émancipent et celles qui aliènent, celles qui sont libres et celles qui sont contraintes, celles qui intègrent et celles qui excluent, celles qui sont mineures et celles de la majorité ? Notre première ambition sera donc celle-là : contribuer à mettre en tension critique ce qui semble être devenu une pure évidence, soit l’idée que pour s’émanciper, il faut pouvoir s’exprimer.
Nous partons, par ailleurs, d’un contexte particulier pour poser ces questions puisque c’est à travers le prisme de l’éducation permanente (ici comprise comme pratique autant que comme secteur d’activité) que notre problématique d’une « politique de l’expression » vient à prendre sens. Le notifier est important compte tenu du fait que nous aimerions, ici, approfondir une hypothèse spécifique : que sa situation intermédiaire entre population et pouvoir publics permet au secteur associatif (belge dans notre cas) de problématiser de manière particulièrement congrue à la fois l’émancipation des classes populaires et les méthodes présidant à leur domination et à leur invisibilisation.
En effet, par-delà les prescrits officiels (décrets, lois, etc.) et/ou subjectifs (valeurs, militance, etc.) qui déterminent le sens de l’action des structures qui constituent ce secteur, il est nécessaire de toujours réévaluer ce même sens comme étant le symptôme direct d’une tendance sociale plus large et plus impersonnelle qui constitue, en fait, la motivation fondamentale de toutes les formes d’action sociale. Cette tendance plus large pourrait, par exemple, être celle de compenser le plus adéquatement possible « le peu de bénéfices que l’État retire de l’élevage d’une population qui n’arrive que très exceptionnellement à un âge où elle peut rembourser les frais qu’elle a occasionnés »[2]. Donzelot décrit ici les raisons qui motivèrent au XIXème la naissance de l’économie sociale au sens le plus fondamental, soit l’ensemble des pratiques socio-économiques visant la maximisation du profit (à la fois économique et social) de l’action sociale elle-même[3]. Et si l’on doit bien accepter qu’il s’agit moins aujourd’hui de « faire du social » pour compenser les frais générés par une population coutant (trop) cher malgré sa mortalité élevée, cette perspective a le mérite de relever que le champ associatif dépend aussi des logiques qui, historiquement, président à la production de ce qu’on peut nommer un corps social, l’agencement complexe des dimensions de la population (individus, productions, santé, culture, etc.) qui seront soumises à la souveraineté d’un État, à ses capacités de production et à ses intérêts particuliers.
C’est aussi par ce biais que le secteur socioculturel forme un excellent ancrage pour problématiser le réel des luttes de classes, le regard qu’il permet, par sa position excentrée mais néanmoins interne, sur l’État et ses pratiques étant profondément révélateur des lignes de fractures fortes de notre société. En effet, le « social » désigne un pan du réel qui
ne se confond pas […] avec le secteur économique, puisqu’il invente précisément toute une économie sociale, et recoupe sur de nouvelles bases la distinction du riche et du pauvre. Ni avec le secteur public, ou le secteur privé, puisqu’il induit au contraire une nouvelle figure hybride du public et du privé, et produit lui-même une répartition, un entrelacement original des interventions de l’Etat et de ses retraits, de ses charges et de ses décharges.[4]
De la même manière, penser à partir du secteur associatif permet de penser le sens de ce que l’État reconnaît comme une charge légitime et ce qu’il se permet d’ignorer, ce qu’il subventionne en priorité et ce qu’il conjure, ce qui – socialement et culturellement – l’atteint et est entendu par lui et ce qui, de toutes les luttes qui le confrontent directement, devient pour lui une sphère d’intervention légitime. En d’autres mots, l’action sociale fournit un angle de vue où l’État se révèle comme la cristallisation d’un ensemble de rapports de forces : c’est du conflit et de la puissance des antagonismes sociaux que dépendent les possibilités mêmes d’un État, autant que sa capacité à évoluer. C’est en ce sens que notre question, ici, sera aussi d’interroger la logique et les motifs qui ont conduit les États néolibéraux à reconnaître dans « l’expression » (linguistique, identitaire, culturelle, etc.) un enjeu d’intervention légitime, dont les associations socioculturelles seraient devenues, avec les institutions éducatives et scolaires, les opérateurs préférentiels.
En raison de cette centralité, pour notre perspective, du conflit et de l’antagonisme, une réflexion sur les politiques de l’expression doit être élargie à la question des liens qui nouent langage et capitalisme et aux intrications réciproques existant entre cette dimension constitutive de l’humanité (sa capacité langagière et expressive) et le modèle dominant de souveraineté sociétale aujourd’hui (le capitalisme néolibéral). Ces discussions ont occupé une large part des débats philosophiques et linguistiques de nombreux courants intellectuels du XXème et du XXIème siècle et il serait ridicule de vouloir en fournir ici la synthèse. Nous ne pourrons donc pas être exhaustif quant à l’étendue des problématisations que rend possible cette réflexion, mais nous en tirerons les éléments critiques qui sont (selon nous) indispensables pour penser toute politique de l’expression aujourd’hui, en particulier pour l’éducation permanente. Nous tenterons donc de suivre une piste qui s’inscrit dans la continuité de notre réflexion sur le tournant néolibéral du capitalisme aux alentours des années 80 et sur les conséquences de ce dernier sur notre capacité à penser l’émancipation et le travail social lorsqu’ils ont pour objet le corps et ses souffrances[5] en en élargissant le cadre à la problématique de l’expression.
Cette problématique nous fournira le point d’entrée de notre recherche. Le capitalisme néo-libéral tend à vouloir/devoir produire des travailleurs·euses maximalement productif·ve·s, mais en évitant les risques et les écueils des modèles de rationalisation du travail productif qui furent longtemps dominants et avaient joué un rôle clé dans la mise en crise de la période dite des trente glorieuses (fordisme, taylorisme, etc.). Pour indiquer ce qui nous autorise à penser que ce changement a été à l’origine d’un virage important quant aux politiques de l’expression, nous partirons d’une thèse, partagée par de nombreux auteurs, qui argue que l’une des différences majeures entre le taylorisme et le « post-taylorisme »[6], que nous pouvons comprendre comme la différence, au niveau de la rationalisation du travail productif, entre le capitalisme keynésiano-fordiste-tayloriste et le néolibéralisme, repose sur un changement global de rapport à la question du langage. En effet, là où travailler et parler étaient perçus comme deux activités opposées dans le modèle tayloriste classique, le tournant néolibéral aurait fait du langage ou de la communication l’une des ressources essentielles de la gestion entrepreneuriale généralisée de la société, notamment en misant massivement sur le potentiel qu’incarne le droit à l’expression comme base de la participation des employés aux différentes dimensions de l’entreprise. Le pouvoir et le droit de s’exprimer seraient de ce fait devenus, dans le modèle de l’entreprise néolibérale, l’une des clés fondamentales pour pousser à une « implication accentuée des travailleurs dans l’autosurveillance »[7] et pour encourager la docilité et le consensus à des pratiques aliénantes, d’exploitation et de domination. Dans le même mouvement se précisera l’orientation de la société vers la centralité de l’information et son traitement : l’informatique et ses modèles, nous le verrons, ont également profondément influencé l’importance actuelle de l’expression. Alors que la récolte d’informations augmente progressivement la prédictibilité et la lisibilité des comportements humains, le pouvoir de s’exprimer est en même temps compris comme décisif quant à la diminution de la conflictualité sociale et, par conséquent, de la résistance des individus à leur oppression.
Nous nous demanderons, sur ces différentes bases, si l’émergence (à l’intérieur du secteur socio-culturel) d’un travail sur l’expression reconnu par l’État comme axe prioritaire n’est pas – précisément – l’un des symptômes de cette transformation du capitalisme vers une (bio)politique néolibérale. Et, si cette hypothèse devait se vérifier, quelles conclusions nous pourrions en tirer sur nos pratiques touchant à l’expression des classes populaires, sur nos dispositifs d’« alphabétisation » et de travail de la langue, sur nos croyances quant à la puissance des mots pour atteindre une transformation de la société, sur nos encouragements à l’accès au numérique. Si l’on peut supposer que les motifs du travail social sur le langage répondent à des impératifs différents de ceux des entreprises du secteur marchand, il demeure intéressant de réfléchir à la raison pour laquelle un État décide, à un moment donné de l’histoire du capitalisme, de reconnaître que le langage est, en fait, un élément fondamental de l’« intégration » et de l’« insertion » sociale et professionnelle. Ou, pour le dire en d’autres termes, à la raison pour laquelle il devient légitime de financer le travail sur l’expression comme appartenant aux œuvres sociales de l’État, de nombreux droits sociaux étant désormais conditionnés à la maîtrise de la langue[8]. Dans cette mesure, il nous faudra évaluer, dès lors qu’on accepte que personne n’est per se incapable d’expression, combien ce n’est pas à partir d’une forme de silence (dont il nous reste à fournir le concept) que quelque chose comme une expression populaire devrait être envisagé.
Nous espérons que ces éléments permettront à nos lecteurs et à l’ensemble des travailleur·euse·s et des acteurs sociaux issus de cette sphère qu’est le « travail de l’expression » de formuler les bases d’une véritable politique de l’expression, autrement dit de comprendre que cette dernière est le territoire de rapports de forces dont il convient, pour y engager des luttes, d’identifier les pôles dominants. Et si l’on ne pourra éviter d’écorcher certaines évidences qui structurent le travail associatif tel que ne le connaissons, c’est bien dans la perspective d’un renforcement des luttes sociales que nous entendons le faire.
CHAPITRE 1 – FAIRE PARLER LES TRAVAILLEURS
L’expression comme injonction néolibérale
-
L’émergence postmoderne de la question
Le tournant néolibéral des années 80 fut, entre autres choses, un tournant managérial majeur. Si la notion de « management » répond d’une histoire plus ancienne, elle gagne là une importance théorique et pratique sans précédent dans les théories gestionnaires de l’entreprise ; importance qui, nous le verrons, n’est pas sans lien avec celle que gagna la topique du langage et de l’expression au XXème siècle et plus particulièrement dans la deuxième moitié de ce dernier. Dardot et Laval ont pointé très précisément cette dynamique managériale de la société néolibérale :
Dans les années 1980, la priorité est donnée à l’entreprise, vecteur de tous les progrès, condition de la prospérité et d’abord pourvoyeuse d’emplois. […] Face à l’entreprise parée de toutes les qualités, l’État-providence est présenté comme une « charge », frein à la croissance et source d’inefficacité. « Faire reculer les frontières de l’État-providence », selon le mot d’ordre thatchérien, donne naissance à un ensemble de croyances et de pratiques, le managérialisme, qui se présente comme un remède universel à tous les maux de la société, réduits à des questions d’organisation que l’on peut résoudre par des techniques cherchant systématiquement l’efficience. Ce managérialisme donne évidemment au manager et à son savoir une place éminente qui en fait un véritable héros des temps nouveaux.[9]
Comme aucune dynamique socio-historique n’apparaît d’un seul coup mais bien au travers d’une constellation d’événements qui rythment, dans un temps long, le devenir social, ce qui devint dans cette même décennie un véritable « tournant linguistique de l’économie »[10] était déjà en réalité palpable, pressenti voire annoncé dans les analyses des chefs de file du courant intellectuel dit « post-moderne ».
C’est ainsi qu’au moment où Margaret Thatcher devint première ministre en Angleterre, Jean-François Lyotard publia La condition postmoderne (1979), œuvre qui entérinera définitivement en France la popularité de l’idée de post-modernité, soit d’une période de mise en doute des « grands récits » qui, habituellement, servaient de légitimation au savoir : le récit des Lumières (soit la valeur universelle et progressiste de la raison où « le héros du savoir travaille à une bonne fin éthico-politique, la paix universelle »[11]), de l’émancipation des travailleurs (soit le grand récit marxiste du progrès vers le communisme), ou encore celui du développement de la richesse (soit le grand récit capitaliste de l’équilibre du marché où l’utilité est maximisée dans la perspective d’une croissance indéfinie), pour ne citer qu’eux. S’il n’est pas rare de lire que la postmodernité et le néolibéralisme sont des dynamiques concomitantes, il est intéressant de relever que le point de liaison explicite que releva d’emblée Lyotard touchait au problème du langage et de sa contribution nouvelle à la société productive. Lyotard déclara en effet que la caractéristique déterminant directement son objet de recherche n’était autre que l’omniprésence et la montée en puissance du langage, de l’information et de la communication comme objets du discours scientifique des « sociétés informatisées » :
On peut dire que depuis quarante ans les sciences et les techniques dites de pointe portent sur le langage : la phonologie et les théories linguistiques, les problèmes de communication et la cybernétique, les algèbres modernes et l’informatique, les ordinateurs et leurs langages, les problèmes de traduction des langages et la recherche des compatibilités entre langage-machines, les problèmes de mise en mémoire et les banques de données, la télématique et la mise au point de terminaux « intelligents », la paradoxologie : voilà des témoignages évidents, et la liste n’est pas exhaustive.[12]
Dans un tel contexte de développement, la thèse du philosophe insistait sur la transformation à venir dans le système social post-moderne de la connaissance et de son usage en marchandise et consommation : « le savoir est et sera produit pour être vendu, et il est et sera consommé pour être valorisé dans une nouvelle production : dans les deux cas, pour être échangé »[13]. Suivant sa perspective, la société postmoderne et néolibérale sera une société dont l’objectif deviendra, aussi, celui de produire des producteurs d’éléments de langage, d’informations et de communication. À tout le moins, il s’agira d’introduire ces faits linguistiques dans le champ de la production et de la consommation. Comme Baudrillard le disait avant lui : « Aujourd’hui la consommation – si ce terme a un sens, autre que celui que lui donne l’économie vulgaire – définit précisément ce stade où la marchandise est immédiatement produite comme signe, comme valeur/signe, et les signes (la culture) comme marchandise »[14]. L’idée de postmodernité semble donc bien reposer sur cette hypothèse de la conjonction et du recouvrement de la linguistique et de l’économie, du signifiant et de la marchandise, de l’information et du capital.
Lyotard publiait ses hypothèses en 1979 ; force est d’y constater une certaine puissance d’anticipation théorique, en particulier quand nous considérons le rôle absolument crucial qu’a joué par la suite le développement de l’informatique et des machines de traitement d’informations. Il est en effet presque saisissant qu’un texte relativement daté tel que La condition postmoderne thématise déjà en ces termes l’incidence des transformations technologiques incarnées par le numérique :
On sait comment en normalisant, miniaturisant et commercialisant les appareils, on modifie déjà aujourd’hui les opérations d’acquisition, de classement, de mise à disposition et d’exploitation des connaissances. Il est raisonnable de penser que la multiplication des machines informationnelles affecte et affectera la circulation des connaissances autant que l’a fait le développement des moyens de circulation des hommes d’abord (transports), des sons et des images ensuite (média). Dans cette transformation générale, la nature du savoir ne reste pas intacte. Il ne peut passer dans les nouveaux canaux, et devenir opérationnel, que si la connaissance peut être traduite en quantités d’information. On peut donc en tirer la prévision que tout ce qui dans le savoir constitué n’est pas ainsi traduisible sera délaissé, et que l’orientation des recherches nouvelles se subordonnera à la condition de traduisibilité des résultats éventuels en langage de machine.[15]
L’écho concret d’une telle prédiction ne peut manquer d’évoquer l’essor considérable aujourd’hui gagné par les procédés de digitalisation et de conversion numérique dont l’économie, la culture, voire la société entière sont devenues les objets directs. De façon sans doute moins immédiate, l’impact d’une telle transformation de paradigme est en relation étroite avec le passage du fordisme au post-fordisme, autant qu’avec l’implémentation progressive du néolibéralisme comme logique dominante du marché capitaliste mondialisé. En particulier, le bouleversement technologique impliqué par l’informatique et ses outils – renforçant massivement les procédés d’automatisation au sein des chaînes de production – aura induit une transformation fondamentale de l’organisation du travail et des rapports sociaux qui s’y trament : comme le rappellent Danièle et Robert Linhart, « l’introduction des nouvelles technologies implique dans l’entreprise d’autres rapports sociaux, d’autres relations de travail, d’autres relations professionnelles et un autre type d’organisation »[16].
Il faut donc bien percevoir que dans cette transformation de société, développement technologique, conjoncture socio-économique et organisation de la production s’entrecroisent pour produire une nouvelle culture du capitalisme dont la clé est la circulation la plus fluide possible des informations :
Pour assurer le succès de l’automatisation, il faut impérativement chasser toutes les zones d’ombre et fonctionner dans une transparence complète. […] [I]l faut impérativement assurer une remontée systématique et immédiate de toutes les informations nécessaires pour améliorer ces installations [automatisées, ndr]. Il ne faut plus que les salariés mobilisent clandestinement leurs savoirs, leurs connaissances, ceux-ci doivent circuler et aller directement alimenter le travail des concepteurs et des ingénieurs. […] C’est un autre système de valeurs qui est ici requis. Une autre culture.[17]
C’est ainsi que les travailleurs, certes dépositaires d’un savoir professionnel précis, deviennent dans ce nouveau contexte socio-productif des producteurs d’informations qui, elles, sont dépositaires d’une valeur au sein des processus de performance de l’entreprise ; si bien que le nouvel enjeu entrepreneurial devient, dans cette société de l’information, d’en optimiser la circulation, de favoriser des compétences relationnelles, d’ordonner le travail à des exigences de transparence, de confiance et de dialogue, c’est-à-dire de créer des conditions qui soient favorables à l’expression de ses acteurs : « chacun doit être à même de gérer en permanence un nombre important de relations humaines, de partager son savoir, de transmettre les informations pertinentes au bon interlocuteur »[18].
Il nous faut montrer comment ces éléments sont intrinsèquement liés à notre question directrice, et ce par cette hypothèse de synthèse : dès lors que le paradigme néolibéral et postmoderne introduit l’indistinction entre signes et marchandises et que cette indistinction est ce qui caractérise ce que l’on nomme « information », ce paradigme formera des sociétés où produire des signes, c’est-à-dire s’exprimer, devient une opération clé pour assurer la productivité (et ceci dans les entreprises comme dans le social).
2. Pourquoi les employés doivent pouvoir s’exprimer ?
Ainsi donc la question. Plusieurs aspects de la société contemporaine illustrent les motifs de cette logique et différentes populations pourraient servir de base à son analyse. Si toutefois nous assumons que l’institution-type de la société néolibérale est l’entreprise, il est important de préalablement souligner que nous travaillerons dans ce qui suit à partir d’une conception singulière de celle-ci, dont nous empruntons la formulation à Thibault Le Texier : « l’entreprise, entendue non pas d’abord comme force de production ou comme acteur sur un marché, mais comme lieu d’élaboration et d’exercice d’une rationalité gouvernementale singulière »[19]. Nous envisagerons donc l’entreprise et ses évolutions comme un incubateur témoin des logiques globales du néolibéralisme contemporain en tant que forme de gouvernance. Dès lors que ce sont les travailleurs qui en constituent la population de référence, dans quelle mesure ces derniers sont-ils les objets de ce que nous appellerons désormais l’injonction à l’expression ?
La littérature de management autant que les pratiques managériales constituent à ce titre une ressource remarquable. Dans la Harvard Business review, l’une des plus prestigieuses (et, à ce titre, exemplatives) revue de management, on peut par exemple lire que
Les leaders [d’entreprise, ndr] utilisent une variété d’outils pour amener les gens à s’exprimer, comme les enquêtes sur le « climat (social) » ou encore les sessions de retours avec tous les membres du personnel (« all-staff feedback sessions »). Bon nombre de ces efforts sont axés sur l’amélioration de la communication, de bas en haut de la hiérarchie. Mais, malgré leurs bonnes intentions, elles tombent souvent à court et ce pour deux raisons clés : la peur des conséquences (gêne, isolement, recevoir une faible cote de rendement, perdre ses promotions, voire être licencié) et un sens de la futilité (soit cette croyance que dire quelque chose ne va pas faire la différence, alors pourquoi s’en donner la peine ?). […] Un certain nombre d’études nous montrent que quand les employés peuvent librement exprimer leurs préoccupations, les entreprises observent une rétention accrue et de meilleures performances. Dans différentes entreprises de services financiers, par exemple, les unités d’exploitation où les employés sont réputés prendre davantage la parole ont significativement de meilleurs résultats financiers et opérationnels que les autres.[20]
On peut encore lire dans la revue Management et avenir que les « soft skills » (soit les compétences qui touchent au « savoir-être » et au « relationnel » des employés) sont devenues les éléments critiques de l’employabilité en France :
Leur étude […] montre que les jeunes diplômés de niveau Master sont d’autant mieux rémunérés qu’ils possèdent certaines compétences relationnelles et sociales, notamment la persévérance, l’estime de soi, la prise de risque et la communication. Ces compétences particulières influencent non seulement le niveau de rémunération mais aussi l’insertion des jeunes diplômés et leur satisfaction.[21]
Ces deux exemples font office de gouttes d’eau dans un océan de littérature dont l’objet est souvent (sinon systématiquement) de référer la gestion managériale des principales dimensions humaines à leur potentiel de contribution à la productivité générale de l’entreprise (aussi bien locale que globale) : en d’autres mots, il s’agit d’en penser la performance (potentielle) et les techniques permettant d’augmenter celle-ci. Cette opération détermine un présupposé largement dominant dans la « science » du management : que l’ « individu ordinaire » n’est pas, comme tel, digne de confiance mais qu’il doit être l’objet d’un calcul coût/bénéfice permanent, qu’on doit lui appliquer « le contrôle et le « pilotage à distance » des intérêts particuliers »[22], et qu’il faut à tout prix en transformer l’identité pour « rétablir la confiance » dans sa capacité d’adhésion au modèle visé par l’entreprise. De cette façon, le management contemporain développe toute une anthropométrie du « capital humain »[23] dont l’archétypal manager « anthropreneur »[24] devient la figure médiatrice centrale : il doit servir de support à la bonne gestion des ressources humaines ; gestion dont le postulat initial est que ce qui menace la performance de l’entreprise ne peut, quelle que soit la raison invoquée, venir que du salarié. On sait que, face à cette maxime du « risque humain », l’option taylorienne penchait pour une optimalisation quasi-déshumanisée du travail (hypercontrôle du temps, des méthodes et des expertises nécessaires à l’exécution du travail, autant que du personnel et de ses qualifications). Il semblerait que la société néolibérale, désormais « post-taylorienne » et managériale, mise précisément sur le contraire : il faut sauver les salariés d’eux-mêmes et de leurs « externalités négatives » en leur permettant de s’humaniser au travail et de participer activement aux processus qui le définissent. Ces éléments sont relativement connus et font aujourd’hui l’objet de nombreux développements et approfondissements : nous les rappelons ici pour qu’ils demeurent explicites à notre raisonnement.
L’impératif entrepreneurial et managérial décrit ci-dessus est, cela va de soi, le produit d’une histoire complexe : quel que soit le segment des évolutions considérées, il entraîne avec lui d’autres segments et les implique à différents degrés. Par exemple, comprendre l’évolution du statut de ce qui est reconnu comme compétence professionnelle suppose d’analyser l’évolution du cadre technologique qui accompagne les nouveaux modes de production, autant que le statut du savoir des « opérateurs » dans un contexte d’automation et de digitalisation des entreprises. Il est à ce titre difficile de circonscrire spécifiquement l’évolution du rôle de l’expression dans l’entreprise sans expliciter l’entièreté des composantes (parfois contradictoires) du paradigme qui l’induit. C’est pourquoi nous préférons nous concentrer sur un épisode qui a spécifiquement trait à la problématique de l’expression. Nous prendrons le cas de la promulgation, en France, des Lois Auroux en 1982 et de la constitution du « Droit d’expression directe et collective des salariés ». En effet, l’apparition de ce droit dans la juridiction de la cinquième république est venue acter une forme de rupture qui, à l’époque autant qu’aujourd’hui, avait de quoi surprendre : l’intégration salariale serait désormais aussi conditionnée par le droit à l’expression et à la participation des employés à la définition des normes d’organisation du travail. C’est d’ailleurs ce que décrivaient Danièle et Robert Linhart, en 1985 : « les employeurs savent que ce droit représente un dépôt séminal dans l’entreprise : après lui, rien ne sera totalement comme avant »[25].
En effet, cette loi stipule que
Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.[26]
L’expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.[27]
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.[28]
Le droit des salariés à l’expression directe et collective s’exerce sur les lieux et pendant le temps de travail.
Le temps consacré à l’expression est rémunéré comme temps de travail.[29]
Ces lignes juridiques formalisent très explicitement une nouvelle conception générale du travailleur qui se développe notamment en France (à l’époque sous régime socialiste mais néanmoins sous influence économique américaine[30]), et en Occident plus généralement : les qualités requises de l’employé sont l’autonomie et la capacité à participer, à négocier, à s’intégrer pleinement dans les normes collectives d’action et de décision. Comme le rappelle Valérie Brunel,
Cette condition implique une conception de l’action collective reposant d’abord sur une contractualisation choisie entre des individus autonomes, libres et égaux. Ceci suppose aussi une figure de l’individu doté de compétences relationnelles, responsable de lui-même, capable de s’autogouverner, de construire sa place, de faire valoir ses enjeux, besoins et contraintes dans la négociation avec autrui. Appel est fait à l’autonomie de l’acteur (pour définir son rôle au sein d’un réseau d’acteurs diversifiés, s’autoprescrire l’action juste, organiser son travail…) et à la construction de la confiance dans les relations de travail.[31]
La fin du modèle taylorien/fordiste, dont les lois Auroux sont une manifestation, fut aussi en ce sens celle d’une approche de la production pensée sur les registres de la permanence, de la sécurité et de la rationalité : la façon dont l’entreprise néolibérale affronte les caractéristiques de la postmodernité (impermanence, risque, flexibilité, imprévisibilité, complexité, polycentrisme, etc.) repose sur la capacité d’adaptation humaine au changement et sur la « créativité » de son capital humain, pour peu – d’évidence – que cette adaptation aille toujours dans le sens de l’entreprise, de sa performance et de son efficacité.
Le modèle du système auto-organisé semble le seul capable de gérer les contradictions tout en permettant l’adaptabilité et la réactivité. La doctrine managériale insiste sur le fait que l’organisation doit désormais reconnaître, gérer et tirer profit des dynamiques contradictoires en son sein, qu’elle doit admettre des possibilités de comportements différents, plus autonomes, plus variés, voire plus « déviants », comme réquisit de sa capacité d’adaptation, de créativité et d’innovation. Selon les théoriciens du management, ce résultat n’est possible que si les organisations sont conçues de façon non pas à mieux exercer le pouvoir et à mieux contrôler, mais à permettre l’intérêt et l’expression de chacun [nous soulignons].[32]
Les employés doivent donc pouvoir s’exprimer, droit qu’ils ont d’ailleurs gagné, parce que – à la lettre – l’expression n’entrave en rien la logique de l’entrepreneuriat qui sert d’idéal-type à la société néolibérale : au contraire, c’est la logique même de la gouvernance capitaliste contemporaine qui suppose que se gouverne d’autant mieux ce qui peut s’exprimer sur et participer à sa propre gouvernance. Savoir ce qu’ont à dire les employés est le meilleur moyen pour les employeurs de déterminer la manière d’influencer favorablement leur état d’esprit tout en désamorçant l’hostilité, les réticences entretenues par les subalternes envers leur hiérarchie : « dégonfler les réserves de contestation, installer la confiance, semer les germes de rapports plus consensuels »[33]. « S’il faut assurément être « ouvert », « synchrone », « positif », « empathique », « coopératif », ce n’est pas en vue du seul bonheur des individus, c’est d’abord et avant tout pour obtenir des « collaborateurs » la performance que l’on attend d’eux »[34].
Afin de pleinement saisir les ressorts de cette transformation post-tayloriste de la gouvernance de l’entreprise, il faut aussi se demander quelle forme d’expressivité ce nouveau contexte est venu remplacer. Les ouvriers manquaient-ils d’expression jusque-là et, si tel est le cas, de quelle conquête ce droit d’expression est-il le symptôme ? Si tel n’est pas le cas, quelle nouvelle dynamique vient-il imposer aux travailleurs ?
3. Expression rime avec intermédiation : faire évoluer les relations
Nous disions précédemment que les lois Auroux et les nouveaux droits qui les accompagnèrent constituaient un modèle clé de l’évolution des modalités postmodernes d’organisation du travail, notamment parce qu’ils exprimaient – à même l’ossature juridique enclosant le travail – un changement important dans les cadres qui régissent les relations entre les travailleurs et le patronat : d’une position antagoniste de défiance réciproque, dominée par le conflit social opposant des intérêts de classe divergents et faisant de l’entreprise un lieu de conflictualité sociale forte, on est progressivement arrivé à un idéal d’entente et d’alignement collaboratif où les distinctions hiérarchiques doivent s’effacer au profit d’un imaginaire commun de productivité, fondé sur la participation de tous et sur le dialogue entre parties prenantes. Ce changement ne relève donc pas seulement d’une réaction à des transformations technologiques et de la conjoncture socio-économique (qui imposent de faire face à des situations plus flexibles, imprévisibles, complexes, etc.), mais d’une nouvelle manière de gérer les conflictualités au sein des entreprises.
Deux aspects se côtoient à ce niveau. D’un côté on présente les entreprises comme des unités auxquelles tous les travailleurs participent, à l’image du rapport entre État et citoyens :
Il faut dire que la législation socialiste a largement contribué à alimenter ce discours humaniste de l’entreprise. Le rapport Auroux et les lois du même nom ont introduit l’idée que les entreprises étaient en mesure de devenir des lieux où la démocratie avait sa place, et où les individus restent des citoyens ; l’idée d’une réconciliation entre efficacité et valorisation du « potentiel humain ».[35]
Ce changement n’est, d’ailleurs, pas simplement une affaire de discours, mais tend à être incarné dans les pratiques concrètes des entreprises, ainsi qu’en témoignent les pratiques managériales précitées et la prolifération des groupes d’expression, des cercles de qualité, les projets collectifs d’entreprise, les dites « mises au vert » et autres récurrents « team buildings » où se rencontrent et dialoguent dirigeants et employés. Il y a là autant de témoignages d’une décontraction des relations et de l’autorité, le lieu de travail devenant un espace où l’on peut s’épanouir et exercer son engagement, sa créativité et sa liberté.
Mais, d’un autre côté, alors même que ces idéaux forment des références récurrentes de l’imaginaire néolibéral, ils accompagnent en réalité une individualisation massive du rapport au travail, conséquence directe d’un affaiblissement systémique des collectifs de travailleur·euse·s au profit d’un renforcement considérable de l’intermédiation entre les différents niveaux d’intervention : d’expérience potentiellement socialisatrice et génératrice de collectivité, le travail est devenu une épreuve plus individuelle, dont chaque « citoyen travailleur » est fait et rendu responsable. La centralité du rôle du manager exprime d’ailleurs cette mutation, puisque celui-ci
doit apprendre à vivre au sein d’une double hiérarchie, tout en représentant l’unité au sein du projet, travailler en coopération avec d’autres équipes, dans l’interdisciplinarité, en acceptant la remise en cause. En même temps, il reste le responsable d’une équipe dont il doit développer le potentiel, l’autonomie, les capacités de coopération et les capacités d’adaptation.[36]
Ce canon du manager-type montre combien l’intermédiation individuelle est devenue capitale pour ce nouvel agencement de la production où la performance de chacun est soumise à la qualité de l’individu intermédiaire qui en permettra l’expression adéquate. Il nous faut préciser cela davantage.
En effet, l’idée que doit exister un manager jouant le rôle d’intermédiaire, « responsable » de « l’équipe » de travailleurs, de son travail, de sa performance et même de son « bien-être » vient transformer une forme d’expérience du travail qui, semble-t-il, n’a plus aujourd’hui sa place dans l’entreprise néolibérale : celle, caricaturale au sein des usines tayloriennes, d’un collectif de travailleur·euse·s placé·e·s sous le patronage d’un contremaître souvent « honni, docile aux ordres patronaux, symbole de l’arbitraire industriel »[37], soit d’un antagonisme fondamental entre des travailleurs s’exprimant entre eux et devant éviter – leur liberté au travail en dépendant – le regard d’un contremaître risquant d’en référer au patron. Dès les années 1950, sous l’influence des modèles américains, se pose à ce propos la question suivante : « Comment recruter, former, contrôler le personnel d’encadrement pour qu’il soit à la fois « efficace » et toléré par la classe ouvrière ? »[38] Cette question ouvre les voies d’un managérialisme qui va progressivement se généraliser à la majorité des pays occidentaux. Cette nouvelle tendance a bien pour visée de produire une situation où l’expression des travailleurs et celle des patrons ne s’opposent plus, mais sont de fait en continuité (d’autant que chacun est pensé comme un manager de soi et des autres, mais à des degrés divers : individu, équipe, département, entreprise, consortiums, multinationales, etc.). Le management va donc orienter dans le « bon » sens l’idée, adéquatement formulée dans le Droit d’expression directe et collective des salariés, que « le temps consacré à l’expression [soit] rémunéré comme temps de travail »[39], avec toutes les ambivalences dont cette formulation est porteuse.
Cet ensemble de technologies sociales d’entreprise fut notamment importé au travers du Plan Marshall, soit dans un contexte d’après-guerre et de reconstruction où le modèle soviétique demeurait une référence centrale pour une part importante de la gauche européenne : l’ingénierie sociale américaine aura à s’imposer, non sans conflits, comme la voie royale de modernisation des entreprises européennes (françaises plus particulièrement), et ce par l’intervention d’un ensemble d’institutions et d’acteurs qui auront, en pleine guerre froide, pour objectif de transformer la société européenne dans son ensemble[40].
Rappelant que l’ « attitude constructive dont font preuve les ouvriers » aux USA dépend d’abord de l’ « attitude constructive de la direction », ils [les « experts » américains envoyés en France dans le cadre du Plan Marshall] reprochent, notamment, aux dirigeants français de « s’opposer à tout changement constructif », de ne « pas établir leurs plans en fonction de l’avenir », de « ne pas laisser une responsabilité et une autorité suffisantes à leurs subordonnés », de ne pas accorder « assez d’importance aux facteurs humains » et au « respect de la dignité des travailleurs » et les engagent à « adopter une attitude d’optimisme réaliste, d’enthousiasme et de confiance en eux-mêmes, en leurs subordonnés et en l’avenir de leur entreprise », à « faciliter la communication dans les deux sens entre la direction et la main d’œuvre », à « appliquer de saines méthodes en matière de rapports humains », afin de « donner aux travailleurs le sentiment qu’ils participent à l’entreprise » (ce qui n’exige pas – est-il précisé – « leur participation aux bénéfices ou à la direction de l’entreprise ») [Nous soulignons]. Il faut surtout, disent les « experts », doter les entreprises françaises de « collaborateurs intermédiaires » dévoués et efficaces et, d’abord, apprendre à les former […].[41]
La séduction des travailleur·euse·s (et en particulier des cadres) devient très vite la base de leur contrôle, suivant un modèle logique caractéristique de la postmodernité néolibérale : séduire pour contraindre. Et séduire, quand il s’agit d’une visée explicite/d’une activité performée, suppose de savoir ce que l’autre pense, que lui soit manifeste qu’il est entendu et écouté, qu’il exprime ce qu’il ressente, qu’il s’élabore en lui-même la conviction que ce qui lui est présenté est précisément ce qu’il veut.
Sur le socle d’une stratégie d’individualisation, les tentatives managériales de séduction se déploient donc. De façon participative, dans un premier temps, en vue de pacifier l’entreprise en instaurant le dialogue, en expérimentant des relations plus détendes au sein de différents types de groupes. Il s’agit de diffuser auprès des salariés les valeurs de l’entreprise, défendre sa cause, expliquer ses contraintes, légitimer ses choix organisationnels. Il s’agit de parler aux salariés, de leur faire passer des messages, mais aussi de les faire parler, de donner des signes d’écoute. […] Cela va prendre une extension très particulière dans les années 1980 où les notions d’entreprise citoyenne et de citoyenneté dans l’entreprise se diffusent grâce aux lois Auroux, où une sorte de réhabilitation des entreprises s’opère. Elles deviennent un lieu où les salariés ont droit à la parole […].[42]
Se dessinent ici les liens fondamentaux nécessaires pour comprendre en quoi l’intermédiation est pour nous l’âme du gouvernement par management néolibéral et, par suite, de sa production d’expression. La création renforcée du statut d’intermédiaire hiérarchique (le manager) ne vient pas inventer la fonction expressive en contexte d’entreprise, elle vient la corriger et la canaliser en en faisant la fonction d’autres opérations dont toute la nomenclature du pouvoir sociétal global va être flétrie et contagionnée : agir sur la mentalité, donner le sentiment d’être acteur et de participer, produire de nouvelles subjectivités et façonner les identités, faire adhérer, remplacer l’enrôlement des travailleurs par leur engagement, associer le fait de s’exprimer à l’acte de se définir, etc. Plus abstraitement, cette montée de l’intermédiation dont le « mouvement des « relations humaines » »[43] et le managérialisme furent et sont toujours les acteurs favorise, contribue, concourt à l’effacement progressif (et non pas à l’abolition) de la division de la société en classes, faisant naître ce singulier ordre social qui veut « dépasser » l’opposition entre prolétariat et patronat : « [opposition] dépassée à la fois par la dissolution de la propriété (les « dirigeants » sont des « salariés »), ce qui rend obsolète le critère fondamental auquel se réfèrent les marxistes, la « position dans les rapports de production », et par la disparition attendue, avec les progrès de l’ »automation », de l’opposition entre travail manuel et travail intellectuel »[44].
4. L’expression pour abolir les conflits
Ce que nous révèle ce « démaillage » du tissu socio-historique par le biais de l’expressivité montre certaines ficelles que le régime néolibéral exploite aux fins de son élagage systématique de la conflictualité sociale. Les nouvelles formes de management, et notamment l’usage de l’expression, visent donc à affaiblir et effacer les collectifs de travailleurs que la conflictualité générée par l’exploitation salariale ne cesse d’engendrer, et dont la forme syndicale demeure, aujourd’hui, la seule expression « légale ». D’ailleurs, comme acteurs principaux dans les luttes ouvrières, les syndicats ont suivi la voie imposée par les nouvelles organisations entrepreneuriales : de menace antagoniste, ils sont progressivement entrés dans une forme de complicité avec l’organisation capitaliste du travail, sous la forme de ce qu’on nomme traditionnellement la « concertation sociale »[45].
C’est dans le secteur privé que la concertation sociale a trouvé les voies de son institutionnalisation. Quand on parle d’institutionnalisation de la concertation sociale, on se réfère aux initiatives prises par les organisations syndicales et patronales et par les pouvoirs publics pour réguler les rapports entre employeurs et les travailleurs. […] Cette institutionnalisation a eu pour effet de diminuer le nombre et l’intensité des conflits du travail.[46]
Cette institutionnalisation syndicale dont le début de la seconde moitié du XXème siècle fut le théâtre est toute entière fondée sur l’idée que les syndicats (compris comme acteurs de médiation entre les travailleurs et le patronat) et le patronat sont les interlocuteurs sociaux d’une « conflictualité fonctionnelle »[47], c’est-à-dire d’une conflictualité convenable aux intérêts des deux parties en présence (et ce même au travers de conflits parfois très virulents).
Linhart expose cela assez bien en montrant que, jusqu’aux années 1970 (jusqu’à Mai 68, plus spécifiquement), les syndicats se concentraient sur la question de la rétribution salariale (contrat de travail, salaire, classification professionnelle, etc.), abandonnant entièrement aux dirigeants d’entreprise la problématique de l’organisation du travail, suivant un partage des rôles en réalité fort opportun pour la reproduction du modèle capitaliste dominant à l’époque, le fordisme : « aux syndicats la tâche de revendiquer des salaires de plus en plus élevés pour une classe ouvrière dont ils cherchent avant tout à préserver l’unité ; aux employeurs celle d’organiser la production pour extraire la productivité permettant de concéder ces augmentations constantes de salaire »[48]. On voit là une première forme d’articulation du « conflit encadré » dont les entreprises néolibérales feront un principe central d’organisation et de management. Il est, de même, intéressant de relever que les évolutions et changements paradigmatiques dont nous faisons ici – au prisme de la topique de l’expression des travailleur·euse·s – état ne sont pas fondamentalement ou seulement liés à des forces de droite ou foncièrement bourgeoises-libérales, mais plutôt aux acteurs de gauche qui ont dominé la reconstruction sociale, culturelle, économique et idéologique de l’après-guerre. Boltanski montre bien que les forces qui ont présidé à la naissance de la figure du « manager » rompu aux techniques de gouvernance relationnelle sont davantage à chercher du côté des hauts fonctionnaires catholiques et socialistes issus de la Résistance (ce qui, en Belgique, formait les rangs des plus grands piliers du mouvement social et ouvrier, notamment le MOC et le pilier socialiste dont l’Éducation permanente est l’un des produits directs).
Au service de l’État, attachés à la défense de la chose publique, hostiles au patronat et plus généralement au secteur privé toujours suspect d’individualisme et d’égoïsme, sensibles à la « misère ouvrière », à l’ « exploitation » et à la « pauvreté », ils sont les principaux artisans et les porte-parole de l’entreprise de « modernisation de l’économie ». […] La « modernisation de l’économie » et de la « société » est d’abord l’expression d’une volonté et d’une ligne politique qui réclame, pour s’accomplir, la liquidation ou la transformation des deux classes potentiellement dangereuses : la « rouge », la classe ouvrière ; la « noire », la petite bourgeoisie traditionnelle, où les différentes formes de fascisme ont trouvé leurs plus solides appuis.[49]
L’explosion que fut Mai 68 signera pourtant la fin du compromis sous cette forme, en particulier parce que la capacité syndicale à représenter les préoccupations réelles de leur base va entrer dans un déphasage très important : s’orientant de plus en plus vers un désir de nouveauté dans la façon dont le travail fonctionne, est organisé, use et est usé, les revendications populaires changeront progressivement de contenu, là où elle continueront à être majoritairement appréhendées syndicalement dans les rets de l’augmentation du pouvoir d’achat.
Cette rupture modifie profondément le pôle de gravité définissant la centralité politique du travail. À tel point d’ailleurs que lorsque la première grande grève ouvrière de 68 éclate (le 14 mai 68) à l’usine Sud-Aviation de Bouguenais-Nantes (France), les ouvriers séquestrent la direction dans l’usine, occupent l’espace et créent des espaces de débats et de discussion entre eux, les « occupants », alors même que la direction de la CGT (Georges Séguy, à l’époque) condamne fermement ces agissements.
L’occupation permet une circulation de la parole et des débats entre les occupants. À Peugeot-Sochaux pendant la grève de mai-juin, sous le contrôle du Comité de grève, l’assemblée générale quotidienne appelée « Forum » permet aux grévistes de débattre des questions proprement politiques, même si évidemment seuls les présents sont concernés et que leur nombre diminue du fait de la longueur du conflit […].[50]
Il est intéressant de relever qu’une forme très puissante d’expression des travailleurs – horizontale plutôt que verticale – émerge de ces luttes. Plus généralement, les « années 68 » (soit plus ou moins la période couvrant 1962 – 1981) verront se multiplier les nouvelles façons de court-circuiter l’organisation du travail, voyant de nouveaux acteurs apparaître (les femmes, les immigrés, etc.) avec des revendications d’un type nouveau, des formes de grèves sauvages et de nouvelles contestations des hiérarchies : de tous ces mouvements, les syndicats tendront à ne soutenir que ceux sur lesquels ils ont le plein contrôle[51].
Cette transformation du champ de la contestation contribuera de façon importante à transformer d’une part la forme du consensus syndicat-patronat au sein des entreprises et d’autre part la gouvernementalité patronale optée pour réguler cette forme sauvage de conflictualité. La transformation managériale de l’organisation du travail, avec son insistance sur l’expression des travailleurs (pour leurs managers et patrons), se révèle alors non pas comme une « innovation » mais comme une réaction face à la réorientation de la lutte ouvrière vers des questions touchant l’organisation du travail et le travail salarié tout court (plutôt que seulement vers la rétribution salariale), réorientation qui se soutient de l’expression de travailleurs (entre eux et non pas pour quelqu’un d’autre).
Dès mai 1971, des experts de l’OCDE s’étaient interrogés sur les conflits qui mettaient en cause la hiérarchie dans les entreprises des sociétés industrielles avec la contestation de la notion même de travail, l’absentéisme et le turn over, de même que le freinage ou les malfaçons, parallèlement à la baisse constatée des rendements et de la productivité. Cette situation précipite l’évolution et l’adaptation du capitalisme (Boltanski et Chiapello, 1999). Pour faire face aux contestations sociales, le patronat s’est organisé, a transformé son fonctionnement et ses dispositifs. Dans un premier temps, face aux revendications des salariés, patronat, syndicats et gouvernement négocient une série d’accords contractuels qui garantissent des augmentations de salaires (remises en cause par une forte inflation). Dans un second temps, après la récession de 1974-1975 et à la suite du premier choc pétrolier, une fraction du patronat s’appuie sur un nouveau management pour encadrer des collectifs de travail modifiés avec plus d’autonomie apparente dans leur organisation et leur production. À l’intérieur des entreprises, cette exigence d’autonomie est échangée contre la sécurité de l’emploi (au moins provisoire) et par une série de réformes qui instituent une flexibilité, elle-même favorisée par l’alternance politique de 1981. On est entré dans l’ère du post-fordisme et de la précarité.[52]
Dans ce contexte, si l’on revient à notre exemple et aux motifs qui ont pu présider, en France, au choix politique des lois Auroux et du Droit à l’expression de 1982, on verra qu’ils s’inscrivent pleinement dans cette logique d’adaptation du marché du travail à la transformation éparse et nébuleuse des tendances économico-sociales du capitalisme de l’époque, soit à la naissance de la capture progressive du compromis fordiste par le néolibéralisme. Le gouvernement socialiste de Mitterand se fera donc promoteur du droit à l’expression des travailleurs, précisément au même moment où, par un retour de balancier,
[d]ès le printemps 1982, la désindexation est devenue l’objectif central de la politique des revenus, afin de contenir la progression des salaires ; une note du secrétariat de l’Élysée (mars 1982) préconise sans ambages « la politique la plus restrictive possible » à l’égard des salaires, des prestations sociales et dépenses budgétaires courantes, pour préserver la priorité aux investissements. L’année 1982 est marquée par de nouveaux relèvements des cotisations et surtout par un durcissement des conditions d’indemnisation du chômage ; une note de l’été 1982 va jusqu’à préconiser de véritables opérations « coup de poing » pour démasquer les « faux chômeurs », au risque évident d’aggraver l’impopularité gouvernementale dont témoignent déjà les sondages.[53]
Même si notre thèse demanderait une démonstration plus étayée[54], il est évident que, émergeant comme fonction de régulation de la conflictualité sociale perpétuellement générée par la forme du capitalisme qu’est l’organisation fordiste-taylorienne du travail, la catégorie de l’expression devient, dans la deuxième moitié du XXème siècle, l’un des motifs majeurs du contrôle social des travailleurs, et par voie de fait et d’extension, l’une des références dominantes du tournant de la Nouvelle gestion publique, dont les associations sont – aujourd’hui encore – tributaires.
L’expression et sa nécessité vont donc, dans l’ouverture de l’ère néolibérale, clairement s’identifier comme des manœuvres de « compensation » et de régulation du champ social :
C’est au moment où les entreprises ont le moins de contreparties à proposer aux salariés qu’elles cherchent à établir un consensus. C’est au moment où les directions d’entreprise sont dos au mur, acculées par l’inadaptation de l’organisation sociale et technique du travail, qu’elles se tournent vers les salariés en leur demandant de coopérer, de participer, de s’intégrer à une nouvelle morale d’entreprise, tout en leur promettant moins, sur le plan des salaires notamment.[55]
C’est donc bien dans les fondements de l’entrepreunariat continu que s’impose l’expression comme « injonction néolibérale ». Nous voudrions, cette hypothèse de base connue et assimilée, en évaluer maintenant la portée pour analyser la transformation de cette logique en un outil de travail associatif et socioculturel.
CHAPITRE 2 – L’EXPRESSION DU PEUPLE
L’agencement politique de la mobilisation du peuple
Le salariat est le cœur de la société capitaliste, et – malgré la diversité des évolutions qui le concernent – il continue à incarner une tension fondamentale d’emblée relevée par Marx : celle d’un rapport social antagonique (le salariat) entre un individu libre (le travailleur) qui vend à une institution-acheteuse (l’entreprise) la marchandise qu’est sa force de travail, mais dans une organisation sociale telle que le vendeur supposé libre est intrinsèquement contraint de vendre cette marchandise particulière pour assurer sa survie (notamment, mais pas seulement, parce qu’il ne possède pas les moyens de production nécessaires à la réalisation de sa puissance de travail).
La transformation de l’argent en capital exige donc que le possesseur d’argent trouve sur le marché le travailleur libre, et libre à un double point de vue. Premièrement le travailleur doit être une personne libre, disposant à son gré de sa force de travail comme de sa marchandise à lui ; secondement, il doit n’avoir pas d’autre marchandise à vendre ; être, pour ainsi dire, libre de tout, complètement dépourvu des choses nécessaires à la réalisation de sa puissance travailleuse.[56]
Cette liberté contrainte peut être comprise comme l’un des fondements principaux de la société capitaliste, et ce dans l’ensemble de son déploiement historique. Alors que l’entreprise néolibérale du XXIème siècle a intégré dans ses modes de fonctionnement une forme singulière de liberté contrainte par la participation et l’expression des travailleurs (alors qu’auparavant la « liberté » des travailleurs s’arrêtait au moment où ils vendaient leur force de travail, aux portes de la fabrique), ses formes de gestion tendent aujourd’hui à se traduire dans les formes même de gouvernance démocratique du champ socio-politique dans sa globalité, soit de la gestion des individus libres qui constituent les sujets de l’État : le secteur public autant qu’associatif ont aujourd’hui à (se) gouverner suivant un modèle et des valeurs propres à l’entrepreneuriat. Et, si tant est que l’on se reconnaît appartenir à une société organiquement capitaliste, on peut, qui que l’on soit, supposer prendre, tant bien que mal, activement part à ce système d’institutions sociales dont l’objet est, notamment, d’assurer cette production d’individus libres contraints de vendre leur force de travail. C’est du moins dans cette perspective que peut être compris le rôle que la majorité des institutions civiles ont à jouer dans la cohésion sociale et organique des sociétés capitalistes.
L’histoire des politiques et des antagonismes sociaux qui répondent directement à ce système (par exemple ceux qui ont donné naissance à la sécurité sociale) s’inscrit elle-même dans cette tension posée par la nécessité d’organiser la contrainte des individus ; contrainte dont il est politiquement nécessaire, aujourd’hui plus que jamais, d’assouplir la violence sans l’éliminer (et même en la renforçant) pour pouvoir gouverner. En effet, la réduction – pour éviter l’insurrection – de la violence vécue du sujet dont on contraint la liberté est l’enjeu de toutes les formes de gouvernementalité capitaliste, en particulier dans des États se revendiquant de l’idéal démocratique. Pour une part importante de sa définition, le néolibéralisme se distingue lui aussi des formes précédentes de capitalisme par de nouvelles modalités d’assouplissement de la liberté contrainte dont nous avons, à l’occasion de notre premier chapitre, exposé différentes formes. Ce qui nous intéresse spécifiquement dans le présent chapitre est l’élargissement de ces modalités d’organisation de la liberté contrainte à la société tout entière. Suivant Lionel Jacquot,
le processus de néolibéralisation – aussi multiforme soit-il – a été accompagné d’une managérialisation de la société, c’est-à-dire d’une diffusion des méthodes de management issues de l’entreprise à travers toute la société, toutes les sphères sociales, érigeant un nouvel art managérial de gouverner les populations […]. Cette gouvernementalité managériale doit permettre la fabrication/rationalisation des normes de conduite, la construction d’un nouveau sujet acquis aux valeurs de l’entreprise orientées vers l’optimisation permanente des moyens en vue de la maximisation des fins.[57]
En d’autres termes, l’assouplissement néolibéral de la contrainte aboutit à l’extension et l’augmentation de toutes les techniques usant de la mobilisation de l’engagement chez les sujets de l’économie de marché : il s’agit de produire des individus qui désirent, voire qui militent pour l’état de chose néolibéral, et ce au nom de leur « liberté ». Ce fait de la « néolibéralisation » de la société dans son ensemble doit nous permettre d’envisager la problématique du transfert de la logique managériale à « toutes les sphères sociales », y compris au champ associatif socio-culturel en général, et à l’Éducation permanente en particulier, sous deux angles importants qu’il nous faudra développer : celui de l’enrôlement social du citoyen (1) et celui du problème de l’extériorité (2). Ces deux angles nous permettront d’évaluer comment la catégorie d’expression, envisagée cette fois dans toute l’extension sociétale de ses usages et non plus seulement sous le prisme de l’entreprise, est devenue – à travers le modèle entrepreneurial – l’une des composantes essentielles de la construction gouvernementale du « nouveau sujet acquis aux valeurs de l’entreprise », tout en alimentant souvent chez les acteurs des associations socioculturelles et autres collectifs militants la conviction d’être – parce qu’ils permettent aux citoyens de s’exprimer – en extériorité par rapport à cette néolibéralisation.
-
L’enrôlement des individus : du travailleur militant au citoyen engagé
Un problème posé à l’entièreté des acteurs du champ associatif « non-marchand » est celui de la fonction de ce dernier au sein de la société : il se résume à la question de savoir à quoi sert, socialement, le non-marchand[58]. Comme nous l’évoquions en introduction de notre étude, chaque association socioculturelle doit son financement à sa capacité à être reconnue, d’une façon différente que par le marché comme les entreprises, d’utilité publique. Et, dans une société majoritairement ordonnée à la généralisation des logiques de marché dans toutes les sphères sociales, la question de l’utilité publique du non-marchand est en effet, par elle-même, critique[59] (puisqu’elle interroge le sens de l’usage marchand de ce qui se développe hors du marché).
La généalogie des œuvres sociales dans l’État libéral fournit des indications précieuses pour saisir à quel souci « le social » répond. En effet, on peut remonter au XIXème siècle pour analyser, comme le montre l’extrait ci-dessous, combien l’inquiétude d’une « compression » (nous reviendrons sur ce concept) trop forte des populations pauvres fonde le social : les risques de révolte, l’immoralité et l’insalubrité étaient et, d’une certaine façon, sont toujours d’emblée les menaces dont le social est tenu de faire son objet.
Reconnaître d’utilité publique les logements sociaux, les écoles, les caisses d’épargne, les allocations familiales, tous ces équipements implantés par un patronat soucieux de contenir les populations pauvres, devient légitime, puisque ces instruments de moralisation sont aussi des conditions de salubrité. […] [C]ette rationalisation des produits de la philanthropie décharge l’activité productrice d’un secteur de gestion dont les variations, les inégalités d’approvisionnement nuisaient à sa bonne marche, comme elle déleste le patronat de cette image directement dominatrice qui résulte de ses modalités paternalistes d’implantation.[60]
On peut, à la lecture de cette caractérisation, identifier une homologie de fonction frappante entre les œuvres sociales reconnues d’utilité publique par l’État et le développement tendanciel du travail managérial dont notre premier chapitre a fait état, c’est-à-dire celle d’être un point médian dans la hiérarchie des structures fondamentales de gouvernement capitaliste, point médian visant à « décompresser » le mécontentement social de manière à garantir le maintien des structures de base du capitalisme. Bien entendu, nous sommes ici sur des échelles de temps différentes[61], mais l’homologie de fonction s’observe dans la continuité fondamentale des processus par lesquels le capitalisme produit l’enrôlement des individus (soit la captation de forces libres au sein d’activités productrices et/ou considérées comme « socialement utiles ») : il y a dans le social comme dans les entreprises managériales une certaine orthopédie des affects de la population enrôlée visant à en maximiser le potentiel d’intégration aux normes imposées de la société. Comme le dit Lionel Jacquot,
si le logos gestionnaire peut se lire dans la mise en place d’équipes projet dans une société de transport, la déclinaison du lean production en lean management dans une usine de production de moteurs, la restructuration en réseau des officines d’une pharmacie, l’adoption d’un système d’assurance-qualité ISO d’une entreprise textile […], c’est plus encore dans les organisations non marchandes où son importation, sa diffusion, sa traduction montrent de façon plus aiguë son effectivité, que ce logos apparaît comme la pierre angulaire du changement.[62]
Il y a donc là une forme d’éthique managériale dont l’effet ne serait pas directement prescrit par la nécessité de générer des profits monétaires internes à une organisation existante sur le marché concurrentiel (entreprise, commerce, institution financière, etc.), mais davantage par une certaine logique sociétale globale dont nous voyons qu’elle vise partout à tamiser la contrainte de la liberté par un puissant affect de consentement. Nous voudrions dans ce qui suit démontrer dans quelle mesure les associations socioculturelles risquent aujourd’hui d’être prises au piège de cette logique.
Il convient pourtant, cela va de soi, de ne pas réduire ces deux champs différents (marchand et non-marchand) aux traits fonctionnels qu’ils ont en commun, en réduisant le marchand et le non-marchand à deux flux différenciés mais complémentaires d’une seule et même structure du capitalisme. Comme nous l’inspire la démarche critique de Deleuze et Guattari[63], il appert que ce type d’approche fonctionnaliste conduirait à manquer différents aspects pourtant importants du problème. Par exemple, il est évident que ces fonctions structurelles du capitalisme ont des « lignes de fuites » multiples et imprévisibles, qui empêchent de les totaliser comme étant purement et exclusivement des fonctions du capital (pour le dire simplement, le marchand et le non-marchand ne sont pas réductibles aux comportements que supposent leur fonction au sein de la structure capitaliste). D’autre part, il faut bien voir combien de contingence ou d’aléatoire préside à la structuration même du capitalisme : rien ne rend « nécessaire » la conjonction entre un flux de travailleurs libres ayant à vendre leur force de travail et un flux d’argent décodé en capital (accumulé par des propriétaires) capable d’acheter cette force. Si bien que le capitalisme est aussi l’histoire d’une grande conjuration permanente de cette contingence, et cela précisément parce que « la rencontre aurait pu ne pas se faire, les travailleurs libres et le capital-argent existant « virtuellement » de part et d’autre »[64]. Or, les institutions du non-marchand ont justement à jouer un rôle dans la manière dont ces différents flux qui structurent la société capitaliste s’alignent, se rencontrent ou non : en d’autres termes, elles jouent un rôle clé dans la gestion de la fragilité du système lui-même (elles lui garantissent une stabilité, mais qui est elle-même perpétuellement menacée par les événements du champ social). Il est donc question ici d’évaluer où s’installe le travail d’expression mené dans le champ associatif quant à l’état de servitude dans lequel sont placées les populations enrôlées par le logos gestionnaire et managérial du néolibéralisme. Autrement dit, nous allons tenter de comprendre le rôle de médiation de l’expression populaire joué par les associations socio-culturelles dans la mobilisation salariale[65] structurelle du capitalisme, de manière à comprendre quelle politique d’expression globale s’y déploie.
Frédéric Lordon, notamment auteur du livre Capitalisme, désir et servitude[66], propose de relire la structure contemporaine du capitalisme à travers une approche hybride de Marx et Spinoza : cela revient à croiser la perspective marxienne de critique de l’économie politique du capitalisme avec une « anthropologie des passions »[67] propre à Spinoza, ce geste étant motivé par l’idée que si la critique structurale marxiste permet bien de « dégager les structures (de la mobilisation capitaliste des salariés) », elle ne nous dit pas « ce qui fait in concreto leur efficacité »[68], c’est-à-dire les affects, les forces de désir qui font se mouvoir les individus dans la structure capitaliste. En d’autres termes, à l’instar d’auteurs comme Deleuze et Guattari, Lordon propose de comprendre que, dès lors que la question politique de la « gouvernance » implique un travail sur le(s) désir(s) de la population gouvernée, elle ne peut être envisagée sur une base seulement locale (en se limitant, par exemple, au champ des entreprises capitalistes). Le désir est pour ces auteurs un problème d’emblée collectif : il concerne les agencements sociétaux qui motivent et mobilisent les individus à agir, à choisir telle option sociale plutôt que telle autre, à tolérer tel état de chose plutôt que tel autre, etc[69]. Il est donc question de penser cette force qui agit en chaque chose, ici comprise comme le désir, de façon à déplacer la question de savoir comment un patron mobilise ses salariés à l’intérieur d’une entreprise particulière au problème plus global d’une l’analyse de l’activation des êtres humains dans la poursuite de leurs objets de désir et de ce qui, sociétalement, les pousse à choisir telle orientation politique ou telle direction plutôt qu’une autre.
Sans entrer dans les infinies discussions et variations métaphysiques que soulève la pensée spinozienne, cette approche entre néanmoins en connexion avec la critique marxienne. En effet, dès lors qu’on envisage que le désir de faire propre aux individus qui « entreprennent » (par exemple, ceux qui entreprennent une activité économique se voulant rentable) peut impliquer que d’autres individus doivent être embarqués dans la réalisation de ce désir particulier, on peut envisager que le désir d’entreprendre (un certain affect humain) peut être intimement connecté à l’enrôlement salarial, soit à la contrainte de la liberté des individus : en d’autres termes, le problème politique nait quand le désir d’un individu évolue vers un « désir-maître » en devoir d’enrôler des individus qui, eux, sont soumis à l’impératif de s’aligner au désir d’un autre pour pouvoir survivre. Tel est le problème posé à Lordon par le salariat et sa mobilisation des travailleurs : dans toutes les situations où sont mobilisés des travailleurs s’imposent des patrons, définis par le philosophe comme les « captateurs de l’effort (conatus) de leurs subordonnés enrôlés au service d’un désir-maître »[70]. Rapportée à l’extrait du Capital de Marx cité précédemment, la figure du travailleur à la liberté contrainte n’est autre que celle du subordonné dont le désir est contraint (par la faim, le besoin d’argent, l’absence de moyen de production, etc.) de s’aligner au désir-maître de celui qui est en position de faire faire. On le voit, le problème n’est pas simplement qu’il existe un désir-maître ; le vrai problème est qu’il existe des êtres qui ne peuvent continuer à exister et à désirer qu’en alignant leur désir à celui d’un « maître ». En d’autres termes, le problème est celui des conditions qui produisent des individus dont le désir va être presque entièrement capté dans la forme d’une soumission à celui d’un autre plus puissant et, quant à lui, capable d’influencer des orientations très importantes de la société (c’est le cas, pour rester très concret, des grandes entreprises multinationales qui dominent le marché tel que nous le connaissons, et que les luttes sociales désignent souvent comme les « 1% » les plus riches de la société mondialisée).
Mais, s’il existe bien une connexion entre cette question d’une politique de mobilisation du désir de la population et celle du salariat telle que Marx la formulait, le contexte historique d’analyse a changé depuis Marx, et avec lui le régime de mobilisation dominant :
La configuration passionnelle de la mobilisation salariale, structuralement déterminée, est donc sujette à transformation historique […]. Ainsi le premier régime de mobilisation par « l’aiguillon de la faim », celui que Marx étudie et qui fait jouer « à l’os » le désir basal de la reproduction matérielle-biologique, a cédé la place au régime fordien de la mobilisation par l’aliénation marchande joyeuse et l’accès élargi à la consommation. Tout porte à croire que ce régime à son tour connaît une mutation profonde du fait du renouvellement des méthodes managériales de l’enrôlement et des susceptibilités affectives qu’elles sont capables d’exploiter.[71]
Le fordisme remplaçait l’aiguillon de la faim par le désir irrépressible de consommer et le néolibéralisme post-fordiste aurait approfondi par managérialisme cette orientation fondamentale du désir des citoyens, en y développant une besoin irrépressible et intériorisé de participer à la production. Comme nous l’avons vu, la mutation managériale a jeté un flou important sur la division habituelle du travail, distribuant autrement les rôles et les statuts sociaux, faisant fi des oppositions binaires chères à Marx et occultant la conflictualité sociale au profit d’une intermédiation généralisée des niveaux sociaux, des hiérarchies, des niveaux de pouvoirs.
Au fur et à mesure de l’approfondissement de la division du travail dans l’organisation, cette perturbation est devenue généralisée – il n’est pas jusqu’aux plus hauts dirigeants de l’entreprise qui ne soient… des salariés. La difficulté a été identifiée de longue date par la théorie marxiste, mais sans pour autant trouver de réponse vraiment satisfaisante, faute peut-être de reformuler la bonne question, à savoir comment certains salariés en viennent-ils à faire cause commune avec le capital, pourquoi marchent-ils avec lui ?[72]
Il faut donc trouver ce qui, dans notre société contemporaine, motive massivement cette orientation du citoyen (toujours décrite par les néolibéraux comme étant la « bonne orientation ») vers une marche commune avec les désirs des capitalistes. Doit donc être envisagé ce qui, in concreto, motive l’alignement des citoyens avec le projet sociétal global du néolibéralisme : celui d’une société ordonnée au désir des acteurs dominants du marché. D’une certaine façon, c’est ce que suppose toute démarche critique, et a fortiori celle que doit soutenir l’éducation permanente dans sa démarche politique. La question la plus générale de notre étude n’est autre que celle de déterminer si l’acte de « permettre aux gens de s’exprimer » s’intègre ou non dans cette tendance du capitalisme néolibéral qui tend à créer des structures collectives capables d’orienter le désir de la population dans ce que les capitalistes estiment être le « bon sens ». Notons par ailleurs que cette lecture n’empêche pas de penser que le champ social peut être traversé/constitué de plusieurs orientations différentes : la possibilité même d’un désalignement peut supposer qu’il existe des désir-maîtres qui vont dans un sens opposé à celui qu’impose la direction capitaliste de mobilisation du désir (une tendance communiste, par exemple).
Comme on peut s’y attendre, Lordon se concentre sur l’importance de ce qui, dans cette configuration particulière et contingente de la société, y autorise une résistance permanente et effective des individus à leur enrôlement intégral et ce, précisément, dans un rapport de force où « réduire la dérive, parfaire l’alignement [du désir des citoyens, ndr], voilà a contrario l’idée fixe patronale »[73]. Mais le plus intéressant pour nous dans tout ce détour repose dans le pivot analytique qui lui fait suite. En effet, comme nous l’avons déjà montré précédemment, ce ne sont donc plus seulement les motifs de la survie basale, ni même la seule motivation financière du salaire (et les possibilités de consommation qui l’accompagnent) qui constituent aujourd’hui le support de la captation néolibérale des individus. Cette transformation du capitalisme est rapportée à deux facteurs essentiels pour Lordon. Le premier est la transformation financière du capitalisme (pouvoir actionnarial et dérégulation financière), qui comme telle impacte fortement le travail associatif, mais demeure hors de son agencement propre. Le second, en revanche, le concerne directement puisqu’il s’agit de
la transformation des tâches productives, où entrent aussi bien les exigences de l’économie de services, notamment relationnelles et dispositionnelles, que les formes de « créativité » requises par des rythmes d’innovation soutenus dont les stratégies de compétitivité font leur arme principale.[74]
C’est à ce niveau qu’on peut identifier le lieu de la transition du management d’entreprise néolibéral vers un régime sociétal global d’adhésion des citoyens à la gouvernance néolibérale. Ce régime sociétal passe en effet par l’intégration de tout ce qui suscite des affects joyeux et libérateurs dans la promotion de la productivité des individus mobilisés : leur créativité, leur expressivité, leur production de récits, leur participation à la collectivité et ce jusqu’à la poursuite de leur projet d’existence ; tous ces éléments devront concourir à produire cet idéale vocation totale des individus.
Pour les enrôlés […], il s’agit donc de convertir des contraintes extérieures, celles de l’entreprise et de ses objectifs particuliers, en affects joyeux et en désir propre, un désir dont l’individu, idéalement, pourra dire qu’il est bien le sien.[75]
Si l’on peut accepter que l’éducation permanente elle-même, et le secteur associatif en général, ont – quoi qu’il s’y déploie de contre-conduites – un rôle d’intégration démocratique, qu’ils prennent (parce qu’ils le doivent) fait et cause pour aligner les conflits sociaux avec une forme de paix sociale idéalement visée, de même qu’ils sont eux-mêmes soumis au régime de la compétitivité entre acteurs, nous allons voir que la centralité de la catégorie d’expression se trouve significativement liée au problème de l’enrôlement tel que nous venons de l’exposer. Il nous reste donc à interroger dans quelle mesure le travail associatif participe à une mobilisation d’affects et activités joyeux que les capitalistes peuvent aisément aligner à leurs désirs propres.
2.La transvaluation du travail social et de l’action culturelle des citoyens
Comme nous l’avons déjà signifié ici, les secteurs associatif, socio-culturel, syndical actifs en Belgique appartiennent aujourd’hui, structurellement et presque systématiquement, au gouvernement du corps social : ils y jouent, par-delà la multiplicité des lignes de fuite qui s’y rendent possibles, un rôle de régulation, de compensation et d’intégration à la société et à sa dynamique. Notre perspective ne consiste pas à envisager comment les différentes associations actives dans ces différents secteurs d’activités sociales pensent et formulent les lignes directrices de leur travail, ce qui nous empêcherait de nous maintenir au niveau de la critique de la gouvernementalité néolibérale où les potentialités de résistance s’organisent et prennent place, comme nous y reviendrons. Pour l’instant, il s’agit plutôt pour nous de voir, au prisme des différents concepts clés relevés dans notre premier chapitre (expression, intermédiation, mobilisation patronale, production de la confiance et déconflictualisation du social), l’appropriation dont ce même travail social est l’objet. En effet, à l’instar de ce que le secteur marchand a connu sous le nom de « modernisation » et dont nous avons fait état dans notre premier chapitre, une certaine modernisation des institutions, du financement et de la reconnaissance étatique des missions du non-marchand s’est développée en parallèle[76]. Dans ce cadre, nombreux sont les secteurs socioculturels belges qui ont dans leurs missions prioritaires un axe consacré à l’expression citoyenne et populaire comprise au sens large (expression artistique et culturelle, expression de revendication sociales, représentation et expression identitaires et communautaires, etc.) Cet axe se retrouve par exemple dans l’éducation permanente, la cohésion sociale, les centres d’expression et de créativité. Bien que notre analyse se concentre majoritairement sur l’éducation permanente, nous invitons le lecteur à faire l’exercice critique ici suggéré pour chaque secteur concerné, tant il nous semble que ce que nous allons décrire relève d’une dynamique globale non restreinte à un seul secteur d’activité.
Il est alors possible de soutenir, à la suite de Boltanski et Chiapello, que c’est dans le secteur social que la reconfiguration de la société dans le cadre du nouvel esprit du capitalisme s’est rendue la plus manifeste et effective. S’y observe la plus vive intériorisation de ce que les deux sociologues ont nommé la « critique artiste »[77] du capitalisme :
Dans les années 90, la relance de la critique a été surtout manifeste sur le terrain social où la dégradation des modes de vie associée au développement d’un capitalisme libéré de nombreuses contraintes avait été patente. C’est essentiellement dans ce domaine que, pour faire front à un égoïsme et à une misère grandissants, des palliatifs ont été explorés au cours des années récentes […] comme s’il suffisait de limiter l’insécurité économique des plus démunis pour offrir au membre des pays développés et, particulièrement, aux jeunes, des formes de vie « stimulantes » dans une société devenue « ouverte », « créative » et « tolérante ».[78]
Force est de constater que la « grammaire de l’authenticité »[79] caractéristique de la critique artiste (droit d’être soi-même, dans son identité singulière, droit d’être reconnu·e dans sa créativité, ou, pour reprendre les exemples cités par les auteurs, à « s’épanouir dans son travail », à « faire quelque chose d’intéressant », à « s’exprimer », etc.[80]) a trouvé dans les pratiques associatives une excellente chambre d’écho. L’injonction à l’expression et à la participation va, sur cette base, se distribuer comme priorité explicite du travail de médiation politique confié par l’État aux associations (en Belgique, particulièrement) et cela parce qu’elles constituent déjà, par elles-mêmes, d’excellents relais d’une mentalité participative caractéristique des idéaux de libération et d’autonomie des années 1960 et 70. Or, la thèse centrale de Boltanski et Chiapello est précisément que la transformation néolibérale du capitalisme se fonde sur le réalignement à ses intérêts propres de la critique artiste.
Mais pour évaluer de quelles fonctions gouvernementales l’État néolibéral charge les acteurs du socioculturel, il est nécessaire de nous concentrer sur les déclarations (semi-)officielles qui thématisent explicitement ce qui doit unir le système politique à ces derniers. Le risque de recouvrement de l’émancipation (objectif déclaré du travail associatif) par l’intermédiation politique de la conflictualité sociale (objectif visé par les politiques gouvernementales en charge du secteur associatif) devient, à notre sens, ce sur quoi doit impérativement se centrer la démarche critique des acteurs de ce même champ. Or, l’expression et la participation populaires tendent à être conçues du point de vue des politiques gouvernementales comme méthodes de gouvernance managériale et néolibérale : en un sens, elles sont les pierres angulaires d’un agencement politique collectif où le désir des individus est mobilisé et stimulé dans le sens d’une « meilleure » gestion du social. Il y a donc une tendance explicite à ce que la fonction expressive du champ associatif rejoigne la fonction politique que lui assigne l’État. Deux documents nous intéressent particulièrement de ce point de vue. Le premier concerne le champ associatif dans son ensemble, puisqu’il s’agit de la Charte associative approuvée en 2009 par les trois gouvernements compétents en Belgique francophone, complétée par son « Livre vert » (le document de travail préparatoire à la rédaction de la charte). Le second concerne, quant à lui, exclusivement l’éducation permanente : il s’agit de l’Exposé des motifs du projet de décret de 2003 pour l’éducation permanente, reprenant les intentions politiques présidant à la réforme des référentiels légaux de cette action associative particulière. L’un comme l’autre détaillent explicitement ce qui est attendu de la coopération entre société civile et État dans l’action socioculturelle. Notre méthode sera ici de commenter un certain nombre des déclarations et propositions contenues dans ces documents, en les considérant du point de vue de l’incorporation sociétale de l’injonction à l’expression.
Il est important, préalablement, de préciser que la lecture que nous allons proposer ici ne prétend bien entendu pas épuiser les sens possibles de ces textes. Les différents référentiels et les valeurs qui y sont rendus disponibles sont et resteront intrinsèquement ambivalents et notre approche se veut entièrement ordonnée à la grille de lecture que nous avons élaborée dans notre premier chapitre : celle d’une analyse des enjeux sociaux et politiques charriés par la montée en puissance de la logique managériale dans le capitalisme contemporain. L’hypothèse qui guide donc notre critique est celle de l’impossible extériorité du champ associatif quant à cette dynamique sociétale globale qu’est le néolibéralisme managérial, et dont les pouvoirs publics sont – souvent consciemment, parfois inconsciemment – des agents de premier plan. En ce sens, nous pensons qu’il est utile, pertinent voire nécessaire de s’exercer à repérer dans le contenu manifeste et apparent des textes dont nous faisons ici mention les éléments dans lesquels cette logique pourrait se manifester. Si l’on ne peut donc réduire le sens des énoncés contenus dans ces documents – qui sont toujours le résultat de rapports de force et de compromis – à une tendance néolibérale et managériale, la « subjectivité » de notre approche permet de prendre conscience des tendances plus vastes qui peuvent s’y exprimer. Cette approche permet alors – c’est notre objectif – de penser à nouveaux frais les marges de manœuvre et de liberté dont disposent les acteurs associatifs pour réaliser leur projet émancipatoire dans notre société. L’interprétation critique que nous développerons dans la suite vise donc aussi à identifier, dans le champ d’action encadré par les énoncés que nous allons commenter, les pistes qui permettraient au travail associatif de ne pas s’aligner avec les tendances sociales qui s’y expriment aussi. C’est en effet en assumant de la manière la plus lucide l’impossible extériorité par rapport aux dynamiques sociales dominantes qu’il sera possible d’envisager comment s’en départir.
a. La charte associative : collaboration, participation et médiation civile
Nous ne nous attarderons pas ici sur le long processus qui a mené à la production de cette charte. Nous nous contenterons seulement d’indiquer que le projet naquit en 2003 pour aboutir, après de longues péripéties, au texte définitif ratifié en 2009[81]. L’objectif de ce texte était d’établir et de clarifier, à la demande des associations elles-mêmes, la nature et les modalités du « dialogue » entre pouvoirs publics et associations non-marchandes dans l’horizon sociopolitique francophone en Belgique, et sa vocation n’est autre que de sceller officiellement la nature des engagements réciproques de chaque partie envers l’autre. À ce titre, le document constitue une ressource inespérée pour observer comment ces deux champs de la société belge conçoivent une « bonne entente » dans une relation qui, intrinsèquement autant qu’historiquement, est fondée sur une fondamentale conflictualité. Dans la mesure où le texte est le produit de consultations et de nombreux travaux préparatoires, on peut légitimement considérer qu’il reflète un certain consensus, même partiel, sur l’état de la question. Si l’on veut être plus prudent, on peut au moins supposer qu’il exprime des conceptions et des engagements qui sont fortement prégnants dans l’état des choses actuel. Nous ferons ici référence à la Charte associative, le texte produit par les trois instances gouvernementales que sont la Communauté Française, la Région Wallonne et la Cocof, et à son Livret Vert, qui est le document de travail préparatoire à la charte, présenté comme tel : « C’est une synthèse, la plus systématique possible, des réflexions conduites par la société civile et le monde politique francophone belge sur l’idée de Pacte associatif »[82].
Dès le préambule du texte, le ton est donné :
Alors que l’intérêt général est menacé par la montée de l’individualisme et que la logique marchande convoite chaque espace de l’action collective, les pouvoir publics signataires veulent renforcer leur engagement au service du bien public et sceller alliance avec le monde associatif pour défendre ensemble, dans une perspective de développement durable, les valeurs d’émancipation sociale, d’égalité, de solidarité et de liberté ainsi que les services d’intérêt général.
[…] La réalité associative est une composante importante de la société belge. C’est donc tout naturellement que les pouvoirs publics travaillent régulièrement avec les associations à la réalisation de leurs missions. [83]
Il est intéressant de relever que dès les premières lignes de la charte le pouvoir public inscrit la nécessité de « sceller une alliance » avec les associations pour « défendre » les valeurs de l’émancipation, c’est-à-dire résister à la progression de l’hégémonie marchande et de l’individualisme (soit deux des caractéristiques reconnues comme essentielles à la néolibéralisation du monde). Or, on peut voir là une position d’ambivalence très serrée puisque ce sont les mêmes pouvoirs publics qui, alors qu’ils concourent quotidiennement à l’installation de cette même hégémonie libérale[84], entendent fournir en même temps une reconnaissance forte de la nécessité d’une opposition concrète à cette progression : cet engagement et cette reconnaissance devront se faire « dans un souci de complémentarité »[85], est-il d’ailleurs précisé. C’est le sens de cette complémentarité qu’il s’agit d’élucider. Le « Livre vert » de la charte, qui en expose les éléments préparatoires, va plus loin en étant beaucoup plus explicite encore dans son intention :
L’opinion exprime souvent aujourd’hui une relative perte de confiance entre les citoyens et les élus. L’ultralibéralisme, la montée des individualismes et celle des extrémismes, l’extension du modèle consumériste, le risque d’uniformisation des cultures, les inégalités croissantes… peuvent expliquer cette perte de confiance. Une manière de restaurer cette confiance est d’impliquer les citoyens dans la gestion de la « chose publique » au travers des actions associatives auxquelles ils acceptent volontairement d’adhérer.[86]
Les actions associatives sont ici déclarées utiles pour « restaurer la confiance » perdue des citoyens envers leurs élus ; confiance déclarée fragilisée ou perdue par le développement de l’ultralibéralisme et des inégalités qui lui sont intrinsèques. Il n’est pas question de toucher aux causes de l’ultralibéralisme – y compris l’engagement systématique des pouvoirs publics dans l’imposition des logiques de marché comme le meilleur mode de régulation des affaires humaines ; il s’agit plutôt de rétablir une confiance, de faire en sorte que les citoyens croient encore à leurs élus. Notons que cet objectif de restauration de la confiance est pensé dans la perspective d’une implication ou d’une participation citoyenne à la gestion publique qui seraient rendues possibles parce que fondées sur une adhésion volontaire des individus au projet. Dans la mesure où l’implication dans la gestion est pensée comme moyen pour restaurer la confiance entre élus et citoyens, il est, à notre sens, possible de reconnaître là une logique et des finalités caractéristiques d’une orientation managériale qui devrait, désormais, nous être familière. La suite du texte de la Charte fournit des éléments complémentaires qui parachèvent cette évocation.
L’État, par ailleurs factuellement complice de l’institutionnalisation du capitalisme néolibéral, déclare reconnaître comme « essentielle » la contribution du champ associatif à la « richesse » de sa société.
Dans une société en constante évolution, l’engagement de citoyens au sein d’associations et le rôle de celles-ci n’ont jamais été aussi essentiels. Les associations sont une richesse créatrice de richesses. En effet :
-
-
-
-
- En renforçant l’esprit critique, en favorisant l’émergence d’identités et de revendications collectives, en servant de lien et de relais entre les citoyens et les pouvoirs publics, les associations contribuent au renforcement de la démocratie ;
- en détectant des besoins nouveaux à tous les niveaux, ou encore en offrant des services fondamentaux aux personnes, les associations participent au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité ;
- enfin, par leurs ressources propres, par l’intermédiaire des emplois qu’elles créent – notamment avec l’aide des pouvoirs publics – et par l’esprit d’initiative qu’elles développent, elles constituent des agents économiques importants, créateurs d’emplois.[87]
-
-
-
Cet extrait nous donne à nouveau des informations très précieuses sur le statut et le rôle du non-marchand dans l’organicité sociale du capitalisme contemporain en Belgique. D’abord, les associations sont comprises comme des accompagnatrices (sinon comme des facilitatrices) de « l’évolution » de la société (évolution qui, par ailleurs, n’est jamais détaillée comme telle) en y étant une « richesse créatrice de richesses » (là même où elles sont supposées, suivant ce qui précède, résister à la progression du tout marchand)[88]. Cette richesse est donc détaillée dans trois perspectives : renforcer la démocratie en servant de relais intermédiaire entre citoyens et pouvoirs publics (1) ; renforcer la cohésion sociale et la solidarité par la détection (nous soulignons) des « besoins nouveaux » de la population (2) ; contribuer à l’économie nationale en continuant à être un secteur « créateur d’emplois », producteur de richesses (3). Suivant la clé de lecture que nous proposons ici, ces trois points pourraient être résumés par trois concepts : (1) intermédiation, (2) contrôle anticipatif et (3) contribution à la productivité globale. Ces trois fonctions essentielles, qui doivent permettre aux services publics de « gagn[er] en efficacité et en légitimité »[89] et aux pouvoirs publics « de développer de nouveaux modes d’interventions qui [les] plongent au cœur de la société »[90], sont déclarées devoir s’ordonner à l’objectif le plus général de ce partenariat : « renforcer la démocratie participative [nous soulignons] » pour « encourager le citoyen à se réapproprier un projet de société et lui (re)donner des raisons de s’impliquer activement dans la dimension collective »[91]. Il est tout à fait possible de lire derrière ces lignes – notamment dans l’idée vague de réappropriation d’un projet de société – la tendance néolibérale qui a accompagné l’émergence et la généralisation du modèle participatif : inclure l’individu à la gouvernance de la société de manière à ce qu’il puisse y adhérer volontairement, ou, pour paraphraser le experts du Plan Marshall cités dans notre première partie, pour donner aux citoyens le sentiment qu’ils participent à la gestion de la chose publique. En d’autres termes, il s’agit de réduire l’écart entre le désir citoyen et sa forme exigée par le bon fonctionnement de la société, écart dont le pouvoir public admet que l’ultralibéralisme pourrait avoir, contre son gré, agrandi l’amplitude (le peuple aurait « perdu confiance ») : l’associatif pourrait/devrait alors servir à permettre leur réalignement. La particularité étant qu’ici, l’alignement est produit en inscrivant la résistance qu’expriment les individus face à leur enrôlement dans le processus qui, à terme, va ou est supposé produire l’alignement des désirs du peuple sur les logiques de la société de marché.
Un autre ensemble d’extraits soulève ce qui nous paraît être une dimension encore plus fondamentale de la fonction associative telle que nous l’entrapercevons ici. En effet, la Charte déclare que les associations, avec lesquelles l’État doit entretenir un « dialogue permanent »[92],
fondent leur légitimité sur la participation libre, active, bénévole et/ou militante de citoyens à un projet collectif, sur leur capacité à défendre des droits, à révéler des aspirations et des besoins de citoyens, et à y apporter des réponses.[93]
Partout dans la charte est précisé combien il est fondamental, dans cette perspective de légitimité, que soient préservées, maintenues et encouragées trois libertés fondamentales des associations : la liberté d’association elle-même (1), d’autonomie (2) et d’expression (3). Les acteurs associatifs ont bien entendu raison de se revendiquer et de défendre ces libertés. Toutefois, si la première est évidente, les deux suivantes sont plus complexes et sont, toutes les deux, connectées à la valeur systématiquement accordée à la portée « critique » des démarches associatives. La complexité vient du fait qu’il faut tenir ensemble les engagements pris par le pouvoir public sur ces libertés et le discours sur la « complémentarité » des fonctions dont on vient d’identifier les dangers. Ainsi, soit on postule la possibilité d’une discordance radicale, c’est-à-dire d’une absence de complémentarité ; soit on doit admettre que l’autonomie et l’expression jouent un rôle dans la production de cette complémentarité et qu’il faut donc tenir ces deux perspectives de la charte comme cohérentes et comme se supportant l’une et l’autre. Tout le problème de l’ambivalence qu’expriment les énoncés de ces textes vient ici mettre en évidence la forme de l’impact du néolibéralisme sur les déterminations fondamentales du travail associatif et sur la fonction qu’y joue la catégorie d’expression.
Prenons d’abord les quelques extraits de la Charte qui, sur cette problématique, nous semblent déterminants :
Ils [les pouvoirs publics, ndr] s’engagent à respecter la liberté d’expression des associations et à l’encourager, ce qui implique notamment la reconnaissance de la valeur de l’expression critique des associations (y compris vis-à-vis des pouvoirs publics eux-mêmes), le respect de leur choix du mode d’expression adéquat en fonction de leur message, et l’interdiction de toute interférence dans ces choix et de toute corrélation directe ou indirecte entre ces choix et le soutien qu’ils accordent aux associations.[94]
Au même propos, le Livret vert fournit à nouveau des éléments plus précis. Nous en reproduisons un passage qui exprime mieux les intentions de l’extrait, au contenu apparemment irréprochable, cité ci-dessus :
Le secteur associatif joue un rôle considérable dans la formation à la citoyenneté. Il permet aux citoyens de structurer et d’exprimer leurs besoins et revendications à l’égard de ceux qui sont chargés de donner des orientations aux politiques et de prendre des décisions. Il effectue un travail de médiation entre l’intérêt individuel et l’intérêt collectif. Le Pacte associatif doit reconnaître clairement cette capacité critique de l’associatif et donc sa fonction de dynamisation de la démocratie.[95]
À nouveau, un tel passage risque fort de réduire la fonction critique du secteur associatif à un travail de contrôle anticipatif (identification de besoins) et d’intermédiation (transmission d’informations auprès des politiques ou de ceux qui sont chargés de leur donner des orientations), en excluant toute possibilité de discordance radicale par rapport aux objectifs des pouvoirs publics.
Revenons donc à notre question : à partir de quelles coordonnées sociales et politiques la catégorie d’expression (comprise au sens large) est-elle devenue coextensive de l’idée d’émancipation du peuple, et par suite, en fonction de quelles orientations idéologiques ce lien s’est-il renforcé ? Ce que l’on peut tirer à ce propos des extraits précités est l’exposition très nette d’un agencement double de la fonction politique de l’« expression ». En effet, nous pensons que c’est justement ici que l’homologie de rapports et de fonctions entre la structure entrepreneuriale (patronat – manager intermédiaire – forces productives managées/« ressources humaines ») et la construction néolibérale du « social » (État – associations et services publics intermédiaires – population productive/peuple) s’expose, suivant notre interprétation, remarquablement.
On voit en effet qu’à un premier niveau doit être absolument maintenue et reconnue une forme d’autonomie forte des associations car c’est à ce prix que s’y déploie l’expression la plus directe des besoins, des motifs d’action, des désirs qui animent la population. Sur ce premier niveau doit donc être garanti le respect de la dimension critique et de la liberté d’expression des revendications populaires, dès lors bien encadrées par les associations : l’expression doit donc y servir et y être comprise comme support à des motifs d’émancipation individuelle et sociale, de liberté, de non-discrimination, de développement collectif. Dans une large mesure, ce niveau est celui où s’élabore toute la dynamique associative et collective dans sa concrétude quotidienne : les travailleurs-militants y ont leur marge de manœuvre et d’autonomie, ils travaillent directement avec les populations qui « adhèrent volontairement » à leurs démarches, ils se conçoivent comme des forces d’opposition et de transformation de la société, etc. Et, d’une certaine manière, il est très important de saisir ici combien la cible de notre analyse n’est pas le travail (souvent honnête, parfois radical, parfois complaisant) mené par les travailleurs, les militants et les gens qui réalisent et incarnent les conditions de possibilité de cette expression du peuple. Ce travail n’est certainement pas négatif par lui-même et c’est à ce titre qu’il doit être confronté aux rapports de forces qui le structurent. Il faut en ce sens comprendre que l’inscription du travail mené à ce premier niveau dans une logique plus globale de gouvernementalité néolibérale entre souvent en contradiction ou en discordance radicale avec le sens que les individus qui l’exécutent au quotidien lui attribuent, provoquant d’ailleurs souvent des formes de souffrance qui – parce qu’ils ou elles ne sont pas dupes des paradoxes qui les traversent – viennent miner l’effet subversif qu’ils/elles tentent de mettre en place. Cela s’explique quand on considère que l’élaboration du travail associatif ne s’arrête pas à ce stade d’autonomie relative concédée aux secteurs socioculturels. Il est, de même, très important de comprendre que la condition de possibilité de l’exploitation néolibérale des affects joyeux associés et rendus possibles par cette autonomie repose expressément sur le fait que cette autonomie soit réelle et non contrainte. Il faut donc que l’encadrement s’opère sur une autre échelle.
Il existe, de fait, un second niveau de l’agencement où l’on voit combien ce qui autorise une reconnaissance forte de ces démarches repose d’une part sur la médiation que vont assurer les associations et, d’autre part, sur l’adhésion, la confiance et l’alignement potentiel à « la société démocratique et ses élus » que ce travail va/est supposé permettre. Si bien que, sans exagération, dès lors que ces deux niveaux d’agencement sont considérés dans leur intrication, les associations se trouvent à assumer – du point de vue de la gouvernance globale de notre société – une fonction et un rôle de « manager de la population ». Il s’agit d’un type très singulier de management qui, à l’instant même où il fait émerger les problématiques sociales qui grondent dans la population et qu’il y « détecte les besoins nouveaux », est supposé amenuiser et pacifier cette conflictualité sociale en rétablissant la confiance, en donnant le sentiment de participer aux décisions et de réintroduire de l’humain dans la froideur bureaucratique, en portant et en servant de relais à cette « parole d’en bas » qu’auraient désabusé l’« ultralibéralisme » et la « montée des inégalités ». Dans cette perspective, les deux niveaux s’assemblent remarquablement puisque la liberté critique y est maintenue et encouragée, mais à condition bien sûr qu’elle soit médiée, que les associations y servent de relais, d’amortisseur ou de « sas » entre cette expression « brute » des populations et la formulation des réponses politiques adaptées à une « démocratie renforcée ». Il devient alors naturel qu’expression et émancipation soient intrinsèquement associées l’une à l’autre dans la sphère autonome du travail associatif : cette autonomie étant à terme, quoi qu’il arrive, convertie en saine pression, informant utilement le pouvoir public des nécessités d’adaptation qui s’imposent à lui et qui lui assurent, par ailleurs, toute la puissance symbolique d’une démocratie concertée, efficace, pleine de « richesse créatrice de richesses ».
b. La singularité de l’éducation permanente : la centralité de l’expression
L’éducation permanente fait office de figure centrale de l’action socio-culturelle en Belgique et son histoire est aussi riche que la diversité des définitions et compréhensions du sens de cette pratique. Elle garde aujourd’hui cette centralité que lui assure son héritage de l’historique pilarisation politique de la société civile et des mouvements ouvriers belges. Pour une bonne part, l’évolution des décrets qui structurent l’éducation permanente témoigne indéniablement de sa dépilarisation progressive (et de celle de l’associatif en général), ce qui signifie une certaine forme de dépolitisation associée à ce que nous proposerons de comprendre comme une étatisation plus forte des missions qui incombaient à la société pilarisée (dont les trois piliers – le social-chrétien, le socialiste et le libéral – continuent pourtant aujourd’hui à servir de référence à la division politique de la Belgique). Le décret de 2003, venu remplacer le cadre légal régissant l’éducation permanente depuis 1976, répondait justement de cette évolution sociétale où, face au recul de la structuration par piliers, les acteurs associatifs craignaient de perdre leur rôle de force sociale majeure. Le Livre vert de la charte contient à ce propos un passage très intéressant :
En Belgique, les piliers sont une des formes d’organisation de la société civile : ils ont servi de cadre à ses expressions organisées. Parmi ses aspects positifs, le système des piliers apportait à la société civile organisée une cohérence et une efficacité qu’il tirait notamment de ses prolongements alignés sur la scène politique. La pilarisation a créé en Belgique des systèmes d’organisations extrêmement performants. Le citoyen trouvait ainsi, pour tous les domaines de l’existence, les associations qui pouvaient servir d’intermédiaires entre lui et l’État. Elle a engendré un foisonnement associatif et a alimenté un tissu social particulièrement précieux pour contrecarrer les excès de l’individualisme inhérent au système socio-économique contemporain. Grâce à la médiation des groupements intermédiaires, la plupart des demandes sociales ont pu recevoir un moyen d’expression et de communication à l’adresse des autres groupements et des gouvernants en des termes recevables et négociables.[96]
En plus de confirmer l’hypothèse de notre précédent point[97], cet extrait présente une genèse du tissu associatif qui – étant entendu que l’éducation permanente est le produit paradigmatique de cette société civile pilarisée – doit nous permettre de mieux saisir l’enjeu de l’étatisation conséquente à la dépilarisation. On peut en effet lire à la suite que
Une société politiquement mature doit pouvoir prendre la responsabilité de subventionner des associations sans les assujettir. Les deniers publics servent également au subventionnement de forces et d’associations potentiellement contestataires ou critiques. C’est dans cet esprit que s’est par exemple développée l’éducation permanente.[98]
On doit donc comprendre la perpétuation de l’éducation permanente dans la continuité de cette « maturité politique » que veut conserver une société qui est par ailleurs en proie à une pulsion d’un type relativement différent mais qui lui est complémentaire : celle de la « modernisation » marchande et du développement de l’État social actif[99]. En même temps, si la pilarisation dans laquelle s’inscrivait l’éducation permanente dans sa version de 1976 témoignait déjà d’une imprégnation forte du souci d’orientation du conflit social, elle semblait exprimer une forme de médiation plus politique, davantage inscrite dans un antagonisme entre des intérêts de classe divergents (à l’époque encore tributaire des logiques du compromis fordiste). Si le détachement du travail associatif des piliers (et donc des partis) est certes à saluer, nous pensons que l’idée d’une dépolitisation peut donner lieu à un affermissement tendanciel de l’appropriation managériale de cet encadrement du conflit social (ce que nous nommons étatisation).
L’Exposé des motifs[100] du projet de décret de 2003 est un témoignage direct de ces équivoques.
C’est grâce à l’engagement associatif que l’on parvient à compléter, à améliorer le fonctionnement de notre démocratie. C’est également souvent dans le monde associatif que de nouvelles formes d’organisation, d’apprentissage, de service, de revendications et de résistance s’inventent. Il remplit donc aussi une fonction d’anticipation sociale et d’émancipation du citoyen. Le monde associatif joue un rôle de médiation entre les citoyens et le politique afin que puissent s’exercer l’expression et la critique. Les associations relevant du secteur de l’Éducation permanente tiennent une place centrale dans ces domaines.[101]
On retrouve là les mêmes éléments de langage qui établissent le statut de l’acteur associatif comme étant ce que nous avons appelé un « manager de la population », mais en y intégrant l’éducation permanente comme étant absolument centrale ! Mais on remarque surtout que la catégorie d’expression y gagne une place prépondérante, aussi importante que celle de la critique. La perspective d’émancipation des publics cibles (les publics dits « populaires » ou, suivant les mots du législateur Demotte, « défavorisés, par leur niveau de formation ou leurs conditions de vie »[102]) visée par l’action culturelle en éducation permanente devra se réaliser, désormais, comme l’indique le Décret de 2003, « en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression culturelle [nous soulignons] »[103].
Ainsi que nous l’avons souligné dans de précédents travaux[104], il est légitime de dire que par-delà les adaptations produites en fonction des demandes formulées par les acteurs associatifs eux-mêmes, l’évolution décrétale de l’éducation permanente (1976 – 2003, et désormais 2018) est aussi lisible comme symptomatique de la néolibéralisation progressive de la société et, dans le cadre de la problématique qui nous occupe, de sa manifeste managérialisation. Il est assez évident, à la lecture des deux décrets historiques de 1976 et 2003, que le premier répondait à un cadre sociétal davantage polarisé par une conception fordiste/taylorienne du travail et de ses conditions (la société salariale post 40-45), dont nous avons vu précédemment comment s’y est développée l’impulsion managériale et son renforcement progressif dans la société. Le décret de 2003, augmenté de l’exposé par le législateur des motifs de sa promotion, présente – sur de nombreux détails – des signes d’imprégnation par le logos gestionnaire et managérial. Nous venons de voir que, à ce titre, l’émancipation des travailleurs (devenue dans l’entre-deux celle des « milieux populaires ») est désormais rapportée à deux méthodes, ou deux stratégies primordiales : la participation et l’expression. Or, le rôle d’anticipation sociale que ces opérations sont censées remplir risque, étant données les logiques sociales globales dans lesquelles il s’inscrit, d’être réduit au même type de médiation identifié plus haut. Si tel était le cas, l’« émancipation » deviendrait une manière de lier à l’ordre social les individus aliénés en renforçant leur confiance dans la possibilité de dépasser cette aliénation au sein de l’ordre social donné, ce qu’on pourrait décrire aussi comme une division du désir populaire au profit de son alignement à la collectivité idéale définie par l’État, lui-même « en dialogue permanent » avec la société civile.
Cette émancipation par l’expression et la participation pourrait être décrite à travers le concept, forgé par Lordon, d’autoaffection médiate de la population : l’autoaffection (soit comment les individus se rapportent à ce qu’ils vivent) y est déclarée médiate parce que, comme son nom l’indique, « [elle passe] par un intermédiaire, et [est] donc l’objet, de fait ou d’intention, d’une capture »[105]. Il n’y pas lieu de croire qu’une « autoaffection immédiate » existerait au sein du peuple, et qu’il s’agirait simplement de rendre à nouveau possible son déploiement spontané : cette illusion, caractéristique de la critique artiste du capitalisme, manquerait forcément le fait que notre existence sociale est intrinsèquement le produit d’une pluralité de médiations (sociales, politiques, culturelles, etc.) et que, de ce fait, toute pensée de l’émancipation est nécessairement une pensée de la médiation. En effet, c’est nécessairement que la potentielle immédiateté de l’autoaffection des individus se voit, par l’existence sociale, sans cesse clivée et orientée par différentes directions qui polarisent la société (elles s’exercent partout, depuis le noyau familial jusqu’aux différentes institutions qui encadrent l’existence des êtres humains, en passant par toutes les « segmentarités » – scolaires, médicales, culturelles, etc. – qui rythment le devenir des individus). Le problème politique majeur est plutôt celui de savoir quel est le rapport de forces qui doit dominer les médiations qui tissent le champ social. À la lumière des tendances sociales globales, l’émancipation visée par l’éducation permanente peut prendre la forme d’un affect individuel médié par l’intervention d’autres individus qui viennent en cliver l’autodétermination (par exemple, quand on est supposé travailler à « permettre à des gens de s’exprimer », et ce auprès de gens qui ne cessent par ailleurs de s’exprimer, à ceci près qu’ils le font sans médiation, sans « relais ») en l’ordonnant à une soumission à des intérêts qui sont, en fait, prédéterminés par ceux du marché.
Lordon dira que, dans ce cas, l’autoaffection médiate est ce qui vient permettre au pouvoir de gouverner les gens de s’organiser sur cette fracture de la puissance des individus ; fracture dont une part (la part productive pour les logiques sociales dominantes) y sera, grâce aux institutions intermédiaires du pouvoir lui-même, capturée :
Dans l’autoaffection médiate, le captateur, stratégiquement inséré dans la circulation de la potentia multitudinis [puissance de la multitude], s’interpose entre la multitude et la multitude – et l’empêche un peu plus de se reconnaître elle-même dans ses propres productions.[106]
Il y a là, donc, l’idée d’une conversion de la puissance de la multitude des individus en un pouvoir de gouvernance exerçable sur ces mêmes individus. Cette conception se synthétise admirablement dans la formule d’Alexandre Matheron : « Le pouvoir politique est la confiscation par les dirigeants de la puissance collective de leurs sujets »[107]. Sans pouvoir l’y réduire, notre hypothèse est que l’idéologie ayant présidé à la liaison systémique entre expression et émancipation n’est autre que celle-là : la confiscation bienveillante, managériale, médiatrice de la puissance collective des sujets du pouvoir. Notre travail aura permis, nous l’espérons, de montrer que – loin de permettre aux associations d’être en position d’extériorité par rapport au néolibéralisme – la politique de l’expression que promeut l’État dans ses œuvres sociales est intérieure et intrinsèque à la façon dont se construit son pouvoir. Elle se synthétise en une formule de cinq agentivités verbales à travers lesquels s’exerce tout management : pour gouverner, il faut des sujets émancipés de ce qui les rend rétifs à participer, ils doivent donc toujours pouvoir s’exprimer, sans ne jamais pouvoir rien décider.
CONCLUSION
Notre investigation risque fort de nous pousser à des constats à la fois tragiques, cruels et navrants : notre étude conduit en effet à assumer que sous le prisme de la managérialisation et de la néolibéralisation, la valeur émancipatoire de l’expression populaire et de la participation citoyenne s’effondre à n’être, à terme, que le moyen tactique d’une dépolitisation et d’une déconflictualisation radicale et sournoise du champ social. Pire, il semblerait que l’homologie (d’échelle sociétale) du travail associatif avec le travail managérial confirme que, dans l’inconscient sociologique des pratiques instituées par l’État, y compris à l’intérieur des secteurs critiques comme celui de l’éducation permanente, l’entreprise produisant des sujets-militants alignés au désir des acteurs dominant du marché capitaliste est bien devenue un modèle dominant. Ce que nous avons relevé à partir de la Charte associative sur la fonction d’intermédiation politique et de création de confiance en un système pourtant violemment inégalitaire n’est pas seulement assumé par les pouvoirs publics, mais nous rencontrons tous les jours des travailleurs associatifs qui en revendiquent la logique, sans nécessairement être interpellés par le caractère produit de leurs réflexes. Il s’agit d’un attribut symbolique intrinsèque à toutes les formes de violences et de dominations que d’organiser le plus systématiquement possible leur propre méconnaissance pour ceux qui y sont soumis. Et la critique n’a, à notre sens, pas d’autre fonction que de rendre manifeste au nom de quelle méconnaissance une domination, une illusion, une aliénation s’exercent ou risquent de s’exercer. Comme nous l’avons mis en évidence, les travailleurs·euses et les militant·e·s, n’étant en général pas dupes des ambivalences touchant à leur rôle au sein de la société, ils/elles sont souvent en butte à des formes paradoxales d’engagement et à des souffrances proprement liées à cette violence symbolique qu’impose le managérialisme néolibéral : il est, nous le savons, très difficile de résister quotidiennement aux pressions souvent insidieuses qui sont exercées pour orienter, dans le « bon sens », la motivation et la mobilisation des gens ayant le désir de transformer la société.
Cette tâche critique est donc d’autant plus urgente que, à l’instar des pratiques de storytelling managériales analysées par Christian Salmon[108] où histoires et récits sont sans cesse mobilisés pour déconflictualiser la violence des pratiques de domination quotidienne dans l’entreprise, les acteurs associatifs sont en proie à des réflexes parfois similaires : le risque n’est pas faible d’aller tenir avec les publics cibles des activités le grand récit d’une émancipation à venir s’ils sont prêts à s’investir dans les animations conçues par l’asbl. Encourageant les individus à s’exprimer, à formuler les besoins qui les traversent, à investir la violence de leurs vécus ou leur désir tel qu’il se détermine présentement, à s’investir dans des créations où leur est suggéré que leur voix est entendue, assumée et répercutée, il est rare que soit dit dans le même temps combien ces précieuses informations vont, par le prisme de l’intermédiaire associatif, n’être envisagées que du point de vue des solutions de détail que pourraient produire les pouvoirs publics, ou encore du point de vue des financements qu’elles rendent possibles, sans jamais (ou si peu) être pensées comme les symptômes d’un conflit radical avec le capitalisme dominant dont il serait plus qu’urgent de forcer le gouvernement à se départir. En plus, le plaisir que ces pratiques créatives et joyeuses apportent à leurs participant.e.s risque de contribuer à les détourner eux-mêmes du constat de l’incompatibilité entre le désir qui s’exprime dans ces pratiques et l’état actuel du monde.
C’est en même temps précisément à ce niveau-là que la logique du capitalisme néolibéral, n’étant pas intégrale, autorise des marges de manœuvres – des lignes de fuite – dont peuvent se saisir ses opposant·e·s, en ce compris ceux et celles qui ont titre à travailler à l’émancipation populaire comme les associations d’éducation permanente. Et puisque notre étude, dans la conscience du fait que ces marges de manœuvres sont aussi ce qui fonde la grande puissance de cette forme de gouvernementalité, se donne pour objectif de formuler des indications pour une politique de l’expression, nous aimerions offrir une conclusion qui dégage des pistes de travail et des voies de lutte.
D’abord, partons de la piste la plus évidente, soit celle du managérialisme associatif. En effet, nous avons montré qu’il y a une appropriation (sous la forme d’une injonction) de l’expression dans la gouvernementalité néolibérale contemporaine et que les associations se trouvent à y servir aussi de relais. Il est entendu que la perspective peut radicalement se transformer dès lors qu’on se place du point de vue de ceux qui, au quotidien, négocient avec cette forme d’instrumentalisation de leur travail. Et, pour une part non négligeable, la dynamique qui prévaut dans de nombreuses associations est d’assumer d’avoir à pervertir le système dans lequel ils sont pris et par lequel, comme n’importe qui, ils s’assurent de pouvoir tirer leurs moyens de subsistance. La question, de notre point de vue, peut donc être : comment pervertir la fonction managériale du travail associatif de l’expression pour qu’il serve une émancipation conflictuelle et même insurrectionnelle ? En effet, comme le concédait un chercheur (nous devrions dire « idéologue ») en management, il est possible d’être « en situation de management et ne pas manager »[109] (ce qui, du point de vue entrepreneurial, représente une catastrophe pour la productivité, enjoignant le même auteur à déclarer que la seule vraie question est « Comment faire en sorte qu’une personne en situation de management devienne manager ? »[110]). Par suite, l’enjeu d’une politique associative de l’expression est donc celui de ne pas devenir ce manager de la population, malgré la position de management qui tend à lui être attribuée. Si le détail tactique précis d’un tel enjeu mériterait une étude complète, nous pouvons évoquer des éléments qui suffiront à renverser ce qui doit, à notre avis, l’être.
D’abord, il s’agit d’inverser la fonction confiée aux associations d’intermédiaire producteur de confiance. Si en effet la fonction critique est « essentielle » à la vie et à la dynamique émancipatoire du champ associatif, elle l’est pour nous dans la stricte mesure de la méfiance fondamentale qu’elle est susceptible de pouvoir insinuer dans la population, et ce autant par rapport aux lois et aux normes qui régissent la structure globale de la société que par rapport aux mobilisations associatives elles-mêmes. Le management se définit minimalement comme ce qui vise à « faire faire » pour transformer le travail en performance et, à partir de notre analyse, il appert que le champ associatif est supposé jouer un rôle similaire de concours à la performance sociale globale de la société. Du point de vue d’une émancipation subversive et anticapitaliste, la fonction d’intermédiation associative devrait donc être repensée dans la perspective d’une diminution tendancielle de la performance sociale globale : il s’agit moins d’agir à la « facilitation » de l’imposition des lois et stratégies d’actions publiques (les fameuses « solutions » aux problèmes soulevés par « le travail de terrain ») que de renforcer une conflictualité oppositionnelle, radicale et non encadrée, à un système qui quotidiennement concourt à produire inégalités, violence symbolique et exploitation. Comment une telle diminution pourrait se produire ? Il nous est apparu que la stratégie étatique du capitalisme néolibéral était d’instrumentaliser l’effort d’autonomie populaire par son encadrement « non-marchand » (l’émancipation est déclarée importante pour autant qu’elle ne soit un enjeu que dans le secteur non-marchand), ce qui aboutit à renforcer l’alignement des individus avec les intérêts du secteur marchand qui serait, lui, seul capable de pourvoir à la reproduction de la vie de la population elle-même (c’est d’ailleurs, dans cette perspective, que les dispositifs non-marchands de reproduction tels que la sécurité sociale et l’assistance sociale sont et doivent, désormais, être arrimés à la logique marchande de l’accès au salaire). Nous pensons que, par la perversion de cette logique imposée par l’État, il s’agit bien – pour les associations – de pouvoir concourir au redéploiement d’une conflictualité au sein du secteur marchand lui-même, dont l’État « pourvoyeur de fond » doit être considéré comme un pôle central. Dans cette perspective, si les activités et les initiatives proposées par les associations œuvraient à soutenir et à supporter (par toutes les méthodes qui trouvent une place dans l’action socioculturelle) le redéploiement d’une conflictualité beaucoup plus franche à l’intérieur des entreprises et des services publics, elles permettraient à l’expression de garder un rôle émancipatoire face à l’emprise des injonctions du marché dominant.
Ensuite, il nous semble que c’est au travers d’une pratique de la « feinte » ou de l’« esquive » que cette lutte pourrait être menée : soit, d’une part, par la concertation avec les publics visés sur ce qui doit être remonté ou non aux pouvoirs publics, sur le contenu et la formulation des « rapports d’activités » et des « problématiques sociales » dont l’association est porteuse et, d’autre part, par une analyse collective, avec la population concernée, des stratégies formulées par les pouvoirs publics (ateliers d’analyse collective des appels à projets, des décrets, des législations et des projets d’États visant la « gestion » de la population, etc.) En peu de mots, ne pas manager alors que l’on est en position de management reviendrait ici à parfaire le parasitage de l’intermédiation attendue, et il appartient à chaque acteur d’envisager les dispositions particulières qui reviennent à l’exercice de cette perversion au sein de leur contexte de travail et d’expérience.
Notre introduction évoquait le fait qu’il n’y a pas un manque d’expression à pallier mais seulement des variations de la valeur de l’expression au sein de la gouvernance sociétale globale : en ce sens, dans la perspective de la gouvernance de l’État capitaliste, les classes populaires et/ou travailleuses n’ont pas besoin de s’exprimer davantage, il est simplement important que cette expression trouve sa juste place dans le travail d’alignement de leurs intérêts avec ceux des capitalistes. Nous évoquions également, avec Donzelot, combien « le social » avait toujours eu, lorsqu’il est envisagé du point de vue de son instrumentalisation par l’État, pour objet prioritaire la lutte contre la « compression » des pauvres, c’est-à-dire contre leur promiscuité susceptible de produire trois types de risques sociaux : risques sanitaires (l’insalubrité), risques moraux (l’immoralité non-bourgeoise, l’indiscipline) et risques insurrectionnels (la révolte populaire). Il se fait que, dans une large mesure, certains de ces risques n’ont été nulle part conjurés : l’existence de ceux qui sont pris dans le spectre de la précarité reste aujourd’hui exposée à de graves difficultés sanitaires et la distinction morale de classe (celle qui permet, précisément, d’identifier qui appartient aux classes sociales supérieures et qui devra négocier avec toutes les vulnérabilités imposées par la précarité sociale) reste une réalité aux conséquences délétères et palpable pour tous. En revanche, l’encadrement du risque insurrectionnel a, dans nos sociétés du contrôle, gagné sociétalement une importance dont l’élaboration des stratégies managériales analysées dans notre étude fournit le témoignage direct. Et, nous l’avons vu, l’expression et la participation sont, à ce titre, les outils d’une dé-compression globale des classes laborieuses ayant précisément pour fonction d’éliminer ce risque. Nous avions montré à l’occasion d’une précédente étude combien la dé-pression (y compris au sens clinique) des classes laborieuses constituait une méthode de contrôle social des corps essentielle du néolibéralisme[111]. Notre présente étude postule que cette analyse doit être étendue à la décompression de la conflictualité sociale que rend possible l’injonction à l’expression des classes laborieuses.
Si bien que, du point de vue de cette perversion stratégique que nous évoquions, il nous semble que le champ associatif a une position absolument maîtresse pour transformer l’injonction à l’expression en une véritable politique de l’expression, et ce précisément parce qu’il y est placé dans un rôle d’intermédiaire relativement autonome. Il nous semble alors que revient aux militants des associations, ceux qui désirent davantage désaligner le désir populaire du désir patronal et néolibéral, de travailler à la re-compression des opprimés par l’approfondissement du silence populaire. Évitons toute mécompréhension. Le silence n’est pas une forme d’expression moins puissante que la parole et, surtout, ne manque absolument pas de sens. Notamment dans une situation où domine l’injonction à l’expression, le silence se dessine comme une résistance, une contre-conduite face à cet « ordre muet » des choses dont parlait Michel Foucault. Ce dernier disait en effet qu’entre les codes fondamentaux d’une culture (son langage, ses hiérarchies, ses schémas perceptifs, ses valeurs, ses formes d’échanges, etc.) et les théories scientifiques et les interprétations philosophiques qui expliquent pourquoi il existe, là, un ordre (et quelles sont les lois qui le régissent), règne un domaine intermédiaire fondamental :
C’est là qu’une culture, se décalant insensiblement des ordres empiriques qui lui sont prescrits par ses codes primaires, instaurant une première distance par rapport à eux, leur fait perdre leur transparence initiale, cesse de se laisser passivement traverser par eux, se déprend de leurs pouvoirs immédiats et invisibles, se libère assez pour constater que ces ordres ne sont peut-être pas les seuls possibles ni les meilleurs ; de sorte qu’elle se trouve devant le fait brut qu’il y a, au-dessous de ses ordres spontanés, des choses qui sont en elles-mêmes ordonnables, qui appartiennent à un certain ordre muet [nous soulignons], bref qu’il y a de l’ordre.[112]
Cet « ordre muet » qui ramène, tous les jours, chacun au constat et à l’expérience d’un ordre des choses imposé par la structuration fondamentale de la culture globale à laquelle nous appartenons se nourrit, nous avons voulu le mettre évidence ici, de la capture de l’expression de la population. Face à cela, la lisibilité et la transparence des mouvements populaires que rend possible le travail associatif auprès des pouvoirs publics lui ordonnant (grâce à la menace de l’accès aux financements) ses missions peut être contrecarré par cet exercice de mise en œuvre et de préservation du silence populaire, soit de la non-médiation des sources du conflit social. Bien entendu, nous ne parlons pas du silence au sens littéral et nous ne prônons pas de « faire taire le peuple » ; nous soutenons plutôt une interruption dans la circulation de l’expression. Il s’agit de comprendre qu’une véritable expression politique populaire correspond à celle qui circule sans médiations externes à l’intérieur du peuple, de manière à ce que s’y déploie le désir de faire valoir ses exigences contre ceux qui s’emploient à le dominer. Œuvrer au silence populaire, ce n’est donc pas empêcher son expression. Au contraire, il s’agit de produire – dans une société qui s’applique à transformer toutes les formes d’expressions en information valorisable, exploitable et utile au contrôle de la population – une couche silencieuse qui brouille la lisibilité du social, qui rend à la parole populaire son autonomie, qui empêche littéralement au pouvoir de s’emparer de la puissance de ses sujets. Le travail associatif doit donc, en un sens, renverser sa duplicité au profit de la non-lisibilité des comportements de la population : c’est envers les pouvoirs publics qu’il faut « faire croire » que les recommandations sont entendues par la population, que « les gens ont confiance ». Et, tandis que cette médiation inversée jouera son rôle de pacification, pourra proliférer – en silence – le désordre muet de l’insurrection. Du moins, dans une perspective moins messianique et plus réaliste, cela rendrait possible un travail où les publics populaires s’expriment non pas vis-à-vis du pouvoir, mais entre eux, jusqu’au point où ils parviendront à imposer, par le conflit, la transformation de l’ordre social.
- Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education permanente, 2003, art.1. ↑
- DONZELOT, J., La police des familles, Paris, Minuit (coll. « Reprise », 12), 1977/2005, p.18. ↑
- Ce que Foucault et Agamben ont thématisé sous le concept de biopolitique, et que Donzelot renvoie au sens sociologique élargi de la fonction de police, soit à « toutes les méthodes de développement de la qualité de la population et de la puissance de la nation » (DONZELOT, J., Op.Cit., p.12.) ↑
- DELEUZE, G., « Postface. L’ascension du social », dans DONZELOT, J., Op.Cit., p.214. ↑
- Nous renvoyons ici à l’étude de l’ARC publiée en 2018 : MARION, N., « Du corps au contrôle. Enjeux de la corporéité dans le capitalisme contemporain », Publication ARC, 2018 [En ligne]. URL : https://arc-culture.be/blog/publications/du-corps-au-controle-enjeux-de-la-corporeite-dans-le-capitalisme-contemporain/ ↑
- Pour le dire ici de façon très résumée, on peut considérer qu’il s’agit du passage historique d’un principe industriel de rendement maximal de la production (fordisme taylorien) à un principe serviciel d’ajustement permanent à la demande. Pour une introduction à cette transformation, voir « Préface à l’édition de 2008 » dans BRUNEL, V., Les managers de l’âme. Le développement personnel en entreprise, nouvelle pratique de pouvoir, Paris, La découverte, 2004/2008, pp.5-18. Voir aussi MARAZZI, C., La place des chaussettes. Le tournant linguistique de l’économie et ses conséquences politiques, Paris, L’Éclat, 1997. ↑
- BOUTET, J., HELLER, M., « Vers de nouvelles formes de pouvoir langagier ? Langue(s) et identité dans la nouvelle économie », dans Langage et société, 2006|4, n°118, p.5. ↑
- Voir à ce propos le numéro : « Maîtrise de la langue et intégration », Journal de l’Alpha, 1er trimestre 2015, n°196, Lire et Écrire ASBL. ↑
- DARDOT, P., LAVAL, C., La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris, 2009, 2010, p.371. ↑
- Voir MARAZZI, C., La place des chaussettes. Le tournant linguistique de l’économie et ses conséquences politiques, Paris, L’Éclat, 1997. ↑
- LYOTARD, J-F., La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p.7. ↑
- Ibid., pp.10-12. ↑
- Ibid., p.12. ↑
- BAUDRILLARD, J., Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard, 1972, p.178. ↑
- LYOTARD, J-F., La condition postmoderne, Paris, Minuit, 1979, p.13. ↑
- LINHART, D. & R., « La participation des travailleurs : cote difficile à tailler », in Le Monde Diplomatique, juillet 1985, p.7. [En ligne]. URL : https://www.monde-diplomatique.fr/1985/07/LINHART/38660 ↑
- Ibid. ↑
- BRUNEL, V., Op.Cit., p.29. ↑
- LE TEXIER, T., « Foucault, le pouvoir et l’entreprise : pour une théorie de la gouvernmentalité managériale », dans Revue de philosophie économique, 2011|2, vol.12, p.56. ↑
- BURRIS, E., DETERT, J., « Can your employees really speak freely ? », in Harvard Business Review, Jan-Feb 2016, [En ligne] (notre traduction). URL : https://hbr.org/2016/01/can-your-employees-really-speak-freely ↑
- BARTH, I., THEURELLE-STEIN, D., « Les Soft Skills au cœur du portefeuille de compétences des managers de demain », dans Management et avenir, 2017|5, n°95, p.131. ↑
- DARDOT, P., LAVAL, C., Op.Cit., p.400. ↑
- La critique du concept de « capital humain » serait ici d’une grande utilité, mais nous en ferons – par manque d’espace – l’économie. Nous renvoyons à GUILLARD, A., ROUSSEL, J., « Le capital humain en gestion des ressources humaines : éclairages sur le succès d’un concept », dans Management et avenir, 2010|1, n°31, pp.160-181. ↑
- Nous reprenons l’expression à Danièle Linhart. Voir LINHART, D., La comédie humaine du travail. De la déshumanisation taylorienne à la sur-humanisation managériale, Toulouse, Éditions Érès, 2019, pp.15-60. ↑
- LINHART, D. & R., « La participation des travailleurs : cote difficile à tailler », Loc.Cit. ↑
- Article L2281-1 du Code du travail français. ↑
- Article L2281-2. ↑
- Article L2281-3. ↑
- Article L2281-4. ↑
- Voir à ce propos BOLTANSKI, L., « America, America… Le plan marshall et l’importation du management », in Actes de la recherche en sciences sociales, Vol. 38, mai 1981, pp. 19-41. ↑
- BRUNEL, V., Les managers de l’âme, Op.Cit., p.13. ↑
- Ibid., p.27. Nous soulignons. ↑
- LINHART, D., Le torticolis de l’autruche L’éternelle modernisation des entreprises françaises, Paris, Seuil, 1991, p.234. ↑
- DARDOT, P., LAVAL, C., Op.Cit., p.424. ↑
- LINHART, D., « À propos du post-taylorisme », dans Sociologie du travail, 1993, 35-1, p.68. ↑
- BRUNEL, V., Op.Cit., p.30. ↑
- CHALMIN, C., JARRIGE, F., « L’émergence du contremaître. L’ambivalence d’une autorité en construction dans l’industrie textile française », dans Le mouvement social, 2008|3, n°224, p.47. ↑
- BOLTANSKI, L., « America, America… », Loc. Cit., p.19. ↑
- Article L2281-4 du Code du travail français ↑
- Lire à ce propos la totalité de BOLTANSKI, L., « America, America… », Loc. Cit., qui en détaille de façon très exhaustive l’historique. ↑
- BOLTANSKI, L., « America, America… », Loc. Cit., p.21. Nous soulignons. ↑
- LINHART, D., La comédie humaine du travail, Op.Cit., pp.111-112. ↑
- BOLTANSKI, L., « America, America… », Loc. Cit., p.33. ↑
- Ibid., p.29. ↑
- Voir à ce propos, ARCQ, E., « La concertation sociale », Dossiers du CRISP, n°70, décembre 2008, Bruxelles. ↑
- Ibid., p.11. ↑
- LINHART, D., Le torticolis de l’autruche, Op.Cit., p.20. ↑
- Ibid., p.30. ↑
- BOLTANSKI, L., Loc.Cit., p.25. ↑
- ZANCARINI-FOURNEL, M., « Les formes de contestation du travail dans les années 1968 », in Travailler, 2016|2, n°36, p.110. ↑
- Ibid., p.113. ↑
- Ibid., p.115. ↑
- ASSELAIN, J., « L’incartade socialiste de 1981 », dans Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 138, no. 2, 2018, p.22. ↑
- Pour une analyse de la néolibéralisation en Belgique, sur certains aspects différentes du contexte français, voir MAISSIN, G., « La Belgique sur le sentier du néolibéralisme. Profil d’une politique économique », in Econosphère [En ligne], publié le 26/06/2012. URL : http://www.econospheres.be/La-Belgique-sur-le-sentier-du ↑
- LINHART, D. & R., « La participation des travailleurs : cote difficile à tailler », Loc.Cit. ↑
- MARX, K., Le Capital. Livre I, section I à IV, Paris, Flammarion, 1985, p.194. ↑
- JACQUOT, L., Travail, gouvernementalité managériale et néolibéralisme, Paris, L’Harmattan, 2016, pp.20-21. ↑
- Le non-marchand peut être minimalement défini comme : « Branche d’activité dont les organisations fournissent des biens et services à la collectivité sans but de lucre et sont financées principalement par des subsides publics, de dons, de cotisations de membres ou du bénévolat ». » (AR du 14 février 2008). Voir à ce propos la note du CRISP en ligne. URL : http://www.vocabulairepolitique.be/secteur-non-marchand/ ↑
- Nous renvoyons, pour une analyse plus détaillée de l’hybridation marchande du non-marchand, à notre analyse MARION, N., « La chalandisation du non-marchand », Publication ARC, 2017, [En ligne]. URL : https://arc-culture.be/blog/publications/la-chalandisation-du-non-marchand-une-convergence-des-luttes-entre-les-associations-et-leurs-publics/ ↑
- DONZELOT, J., Op.Cit., p.85. ↑
- Nous savons, bien évidemment, combien la société du XIXème siècle analysée par Donzelot est différente de la société managériale née dans la seconde moitié du XXème siècle. ↑
- JACQUOT, L., Op.Cit., p.98. ↑
- Nous renvoyons ici aux thèses développées par les auteurs dans les deux volumes de Capitalisme et Schizophrénie (L’anti-Œdipe et Mille Plateaux), et plus particulièrement au troisième chapitre de L’anti-Œdipe, « Sauvages, Barbares, Civilisés » : DELEUZE, G., GUATTARI, F., L’anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, pp.167-329. ↑
- DELEUZE, G., GUATTARI, F., L’Anti-Œdipe, Paris, Minuit, 1972, p.270. ↑
- Rappelons que nous considérons comme faisant partie du salariat toute personne forcée de vendre, contre rémunération, sa force de travail. Ainsi, les travailleurs « auto-entrepreneurs » comme ceux d’Uber ou Deliveroo sont tout autant des salariés que ne le sont les employés classiques : ils sont simplement exclus des droits associés au salariat juridiquement encadré. ↑
- LORDON, F., Capitalisme, désir et servitude. Marx et Spinoza, Paris, La Fabrique, 2010. ↑
- Ibid., p.10. ↑
- Ibid. ↑
- Cette approche conduit Lordon à massivement recourir au concept spinozien de conatus, ce qui lui permet d’envisager les individus du point de vue de leur « mise en mouvement », c’est-à-dire du point de vue de ce qui les pousse concrètement à agir. Spinoza définissait en effet le conatus, dans son œuvre majeure qu’est l’Ethique, à travers l’affirmation suivante : « chaque chose autant qu’il [le conatus] est en elle s’efforce de persévérer dans son être » (SPINOZA, Ethique, III, 6). Le conatus qualifie donc à la fois la puissance de conservation/préservation qui anime toute chose et sa tendance immanente à l’accroissement, à l’expansion sans limites ↑
- LORDON, F., Op.Cit., 2010, p.20. ↑
- Ibid., p.53. ↑
- Ibid., pp.53-54. ↑
- Ibid., p.56. ↑
- Ibid., p.58. ↑
- Ibid., p.128. ↑
- Voir à ce propos BLAIRON, J., « Le « monde » associatif, pris dans une utopie à l’envers ? », dans Intermag, RTA asbl, 2014, [En ligne]. URL : https://www.intermag.be/images/stories/pdf/rta2014mias.pdf ↑
- Voir BOLTANSKI, L., CHIAPELLO, E., Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999. En synthétisant fortement la critique menée par les auteurs, on peut comprendre la « critique artiste » du capitalisme comme le résultat de la transformation critique que fut Mai 68. Elle remplace la critique sociale marxiste classique (qui pense davantage en termes de conflits de classes et de production capitaliste d’inégalités et de misère sociales) par une approche critique centrée sur deux thèmes nouveaux que sont (1) la critique du désenchantement et de l’inauthenticité capitaliste (le capitalisme est une aliénation du sens, du rapport au beau et au vrai, conduisant les populations à la déperdition dans l’inauthenticité) et (2) l’idée du capitalisme comme source d’oppression de la liberté, de la créativité, de l’expression et de l’autonomie des individus (le capitalisme empêche les individus d’être ce qu’ils sont vraiment, et opprime le véritable déploiement des capacités humaines fondamentales). Pour une bonne part, Boltanski et Chiapello analysent le devenir néolibéral du capitalisme comme tributaire d’une intégration/intériorisation des éléments de cette critique artiste au fonctionnement des structures du capitalisme et de sa production. ↑
- BOLTANSKI, L., CHIAPELLO, E., Op.Cit., p.555. ↑
- L’expression est de Boltanski et Chiapello. ↑
- Ibid., p.557. ↑
- Nous renvoyons pour plus de détails à l’article du CBCS sur la question : WILLAERT, A., « Charte associative : un très très long parcours », Publication CBCS, 15/07/2019, [En ligne]. URL : https://www.cbcs.be/Charte-associative-un-tres-tres ↑
- Livre vert. Document de travail préalable à la consultation devant conduire à la conclusion d’un Pacte associatif, p.36. Disponible en ligne. URL : http://www.associations.be/livrevert.pdf ↑
- Charte associative. Projet de protocole d’accord entre la CF, la RW et la Cocof relatif aux engagements à l’égard des acteurs associatifs, 2009, p.1. Disponible en ligne. URL : http://www.associations.be/ ↑
- Voir à ce propos PIRON, D., « La reconfiguration néolibérale déchiffrée par les finances publiques », dans La Revue nouvelle, 2019|n°3, pp.84-91. ↑
- Charte associative, p.1. ↑
- Livre vert,p.7. ↑
- Charte associative, p. 1. ↑
- Notons ici le passage, sur le mot « richesse », du singulier au pluriel : au singulier, « être une richesse » peut être assimilé à une valeur symbolique, au fait d’être une « ressource utile ». Au pluriel, être « créateur de richesses » prend, nous semble-t-il, un sens plus monétaro-économique, davantage lié à des valeurs capitalisables dans le circuit économique. On peut donc lire la formule, sans doute naïve, d’une façon alternative : les associations sont une force symbolique forte utile à la production du capital. Bien entendu, cela n’épuise pas ce que tente de signifier ici le législateur, mais ce sens est néanmoins contenu dans la formulation. ↑
- Livre vert., Loc.Cit., p.12. ↑
- Ibid. ↑
- Ibid., p.8. ↑
- Charte associative, p.2. ↑
- Ibid. ↑
- Ibid., p.6. Ce n’est pas nous qui soulignons. ↑
- Livret vert, Loc.Cit., p.8. ↑
- Livret vert, Loc.Cit., pp.10-11. ↑
- Comme on le voit dans l’idée selon laquelle les demandes sociales, grâce à la médiation « de groupements intermédiaires », gagnent un « moyen d’expression et de communication », de manière à être reçues par les gouvernants « en des termes recevables et négociables ». ↑
- Ibid., p.12. ↑
- Voir, par aller plus loin sur cet aspect des choses : MARION, N., « La chalandisation du non-marchand », Loc.Cit, et BLAIRON, J., « Le « monde » associatif, pris dans une utopie à l’envers ? », Loc.Cit.. et TVERDOTA, G., « L’État social actif est ses pauvres », Publication ARC, Etude 2017, [En ligne]. URL : https://arc-culture.be/blog/publications/letat-social-actif-et-ses-pauvres-reflexions-sur-la-dimension-culturelle-des-politiques-dactivation/ ↑
- Nous faisons référence ici au document « 432 (2002-2003) — No 1 » du Parlement de la Communauté Française, datant du 27 juin 2003. Les mots sont donc ceux de Rudy Demotte, à l’époque ministre de la culture en charge de l’Éducation permanente. Nous le citerons à travers l’abréviation EDM (2003). ↑
- EDM (2003), p. (2). ↑
- Ibid., p. (4). ↑
- Décret relatif au soutien de l’action associative dans le champ de l’Education permanente (2003), article 1. ↑
- Voir MARION, N., « Du corps au contrôle. Enjeux de la corporéité dans le capitalisme contemporain », publication ARC, étude 2018, [En ligne]. URL : https://arc-culture.be/blog/publications/du-corps-au-controle-enjeux-de-la-corporeite-dans-le-capitalisme-contemporain/ ↑
- LORDON, F., Imperium. Structures et affects des corps politiques, Paris, La Fabrique, 2015, pp.110-111. ↑
- Ibid., p.111. ↑
- MATHERON, A., Individu et communauté chez Spinoza, cité par LORDON, F., Imperium, Op.Cit., p.111. ↑
- Voir SALMON, C., Storytelling. La machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Paris, La découverte, 2008. ↑
- DELAVALLÉE, E. « Il ne suffit pas d’être manager pour manager », dans L’Expansion Management Review, vol. 123, no. 4, 2006, p.12. ↑
- Ibid. ↑
- MARION, N., « Du corps au contrôle. Enjeux de la corporéité dans le capitalisme contemporain », Loc.Cit. ↑
- FOUCAULT, M., Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p.12. ↑