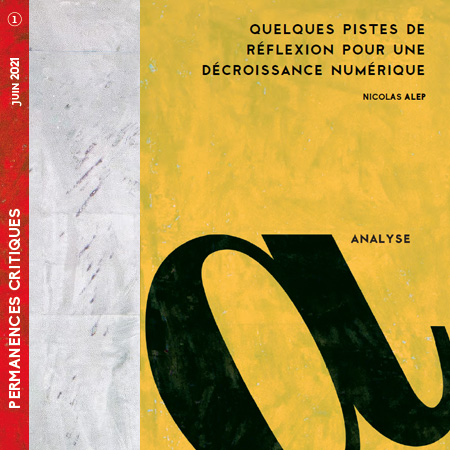Dans notre petit essai corrosif Contre l’Alternumérisme[1], écrit avec Julia Laïnae, nous nous sommes employés à exposer les désaccords de fond qui nous séparent des courants prônant la maîtrise du numérique et à promouvoir l’idée d’une « désescalade technologique ». Le reproche principal qui nous a été adressé est que livre n’ouvre aucune perspective d’action, n’est pas un programme politique et encore moins un guide pour « mieux vivre avec le numérique ». Frustrant ? Pour nombre de lecteurs, visiblement oui. Mais en l’état, et pour de nombreuses raisons, il serait malhonnête de prétendre être en mesure de produire le mode d’emploi d’une sortie du numérique.
Tout d’abord, nous ne mesurons que trop bien l’aspect inoffensif de notre critique. Deux militants bricolant durant leur temps libre un texte politique, qui ne sera jamais lu que par les « gens qui lisent des livres », n’ont aucun pouvoir de changer quoi que ce soit par la force de leurs injonctions. Ce ne sera donc pas sous le commandement de Laïnae et Alep que sera menée la grande offensive néo-luddite qui abattra le « monde sans contact ». Et il y a aussi fort à parier que si Mark Zuckerberg savait lire, Contre l’Alternumérisme ne le convaincrait pas de fermer facebook et d’entamer une reconversion vers un métier socialement utile. Dans tous les cas, tout comme personne ne demande notre bénédiction avant de brûler une antenne 5G, boycotter les cours en « distanciel » ou refuser la biométrie, nous espérons bien que ce débat pourra se poursuivre sans nous. Nous versons au pot commun des éléments de réflexion, mais une fois rentrés à la maison, chacun de nous doit aussi se débattre dans ses contradictions : être critique des technologies, mais vivre dans une société technologique.
Car voilà bien un élément central de notre réflexion : regarder le numérique sous son aspect systémique et non comme la somme des pratiques individuelles. À bien des égards, il est devenu le système nerveux du capitalisme mondialisé et la nouvelle idole à vénérer pour les zélotes de la religion du Progrès. C’est aussi en lui que les gourous de la croissance, qu’ils soient néoclassiques ou keynésiens attardés, placent leurs espoirs pour un nouveau cycle d’expansion. Le refus individuel, même massif, de l’informatique n’ébranlerait nullement son règne. Notre modeste ambition, si elle devait être résumée, était d’ouvrir le débat en dynamitant quelques lieux communs qui le restreignent. Il s’agissait pour nous de prôner la sortie d’une vision moraliste où les problèmes induits par les technologies numériques proviendraient des mauvaises intentions de leurs concepteurs, de leurs utilisateurs ou de la concentration du capital qui les engendre. D’Hannah Arendt et sa banalité du mal à Jacques Ellul et son Système technicien, les exemples fourmillent pour démontrer qu’un employé zélé, effectuant son travail avec soin et application, peut produire les effets les plus abominables. Le développeur de logiciels libres le mieux intentionné n’échappe pas à la règle.
Toutefois, s’il serait malhonnête de vouloir produire le mode d’emploi d’une sortie du numérique, il est possible d’identifier quelques formes de pensée et quelques pistes d’action nous permettant, au moins, d’envisager une telle sortie. Il faut, pour commencer, s’autoriser à l’envisager. Les divers échanges et débats générés par la sortie du livre l’auront illustré : la décrue numérique est, pour beaucoup, inenvisageable. Osons reprendre la formule de Serge Latouche et décolonisons nos imaginaires. Pourquoi sommes-nous capables d’envisager une sortie du capitalisme alors qu’aucun de nous n’a connu le « monde d’avant », mais pas d’imaginer se passer d’internet mobile, technologie adoptée il y a moins de 10 ans ? Quel phénomène de refoulement collectif fait qu’un militant anticapitaliste passe pour plus mesuré et pragmatique qu’un technocritique refusant la 5G ? Rassurez-vous, on se porte très bien lorsqu’on ose remettre en cause les technologies et leur place socio-historique. On se fâche avec quelques amis marxistes, on apprend à se défendre des accusations de vouloir « revenir à la bougie », mais le changement est plutôt agréable.
Une fois que l’on s’autorise à penser la technologie, ses logiques et ses effets, sa non-neutralité[2], son auto-accroissement, son autonomie, on perçoit mieux qu’elle s’insère dans une continuité historique. L’informatique s’est échappée des labos de recherche depuis plus de 50 ans et exerce ses effets sur la société, absolument partout. Bien sûr, cette affirmation mérite des nuances. Tous les secteurs n’ont pas été informatisés à la même époque, ni avec la même intensité. Et les degrés d’acceptation, de méfiance, de compromission ou de refus sont aussi très contrastés. Mais désormais, rien ni personne n’y échappe. Il n’y a pas non plus de grand plan secret, ourdi par les cybernéticiens des années 50, mais des effets de système, dans le prolongement de ceux que l’on observe depuis le début de la (première!) révolution industrielle. Replacer les technologies numériques dans leur trajectoire historique, c’est donc comprendre l’inéluctable progression de leur déploiement. Loin des rhétoriques de « rupture » et « d’innovation » qui présentent les évolutions de technologies antérieures comme l’avènement de nouveaux paradigmes, occultant de fait l’infrastructure technique préexistante dont elles découlent et à laquelle elles se surajoutent.
Il s’agit aussi de cesser d’observer le numérique de façon trop sectorielle. Il est présent partout, au point qu’il devient compliqué d’en faire un panorama complet. Le métier « d’informaticien » n’existe pas, ce terme fourre-tout regroupe une grande quantité de réalités très différentes, dans un domaine où la division et l’hyper-spécialisation du travail atteignent des sommets. Les critiques les plus virulentes qui nous ont été faites proviennent toutes de développeurs, qui, malgré leurs dénégations, semblent incapables d’embrasser une vision plus large que celle de leurs lignes de code et persistent dans une approche solutionniste, occultant au passage toute dimension matérielle ou politique.
Puisque le problème n’était pas politique, c’est qu’il était technique. Puisqu’il y avait des solutions, c’est qu’il n’y avait pas de vrai problème.[3]
Des mines de Coltan en République Démocratique du Congo jusqu’aux usines de semi-conducteurs en Asie, des laboratoires de recherche universitaires à ceux du complexe militaro-industriel étasunien, des navires câbliers aux « petites mains » des opérateurs de télécommunications européens, des anciens comptables reconvertis dans la mise en place d’ERP[4] aux « travailleurs du clic » ou de plateformes d’appel, le sujet est bien trop vaste pour n’être résumé qu’à des questions de vertu individuelle. À l’heure où le numérique devient le front « le plus chaud » dans les affrontements géopolitiques entre superpuissances, où il ne sera bientôt plus possible d’observer les étoiles[5] et où les réponses technologiques à la pandémie de Covid-19 conduisent à une pandémie de dépressions, s’obstiner à analyser la situation par « le petit bout de la lorgnette », et essayer de verdir ses pratiques professionnelles, sans rien remettre en question de structurel, sans se donner les moyens de choisir, collectivement et « en connaissance de cause », relève soit de la naïveté, soit de la pure mauvaise foi.
Il faut enfin se méfier aussi des approches verticales et autoritaires promues par des « experts » bien intentionnés, telle celle du cabinet de conseil en greenwashing préféré de l’industrie nucléaire : le Shift project[6]. Sur la base d’un diagnostic exclusivement basé sur les émissions de gaz à effet de serre et en ignorant ouvertement tout autre problème (pollutions, disponibilité des ressources, impacts sociaux…), ils nous promettent de perpétuer le modèle mortifère actuel avec moins de carbone. Décarboner le transport aérien par un surcroît de technologie et des agro-carburants leur semble souhaitable. Et sur le numérique, la proposition consiste surtout à aligner les oxymores-durables. Pour « Déployer une politique numérique durable » il faut « Élaborer et lancer une stratégie informatique durable », « S’engager avec les clients, les fournisseurs, les partenaires, les institutions vers des solutions et services durables », « Fabriquer un Système d’Information durable », « Développer une culture numérique durable » et « Gouverner la transition vers un Système d’information durable ». Sans oublier de « Mesurer l’impact environnemental du Système d’Information de bout en bout ». Avec des critères exclusivement basés sur le CO2, l’illusion d’un numérique « durable » devient possible. S’il ne s’agit plus que d’en limiter les émissions, alors, les datacenters implantés au-delà du cercle arctique[7], les serveurs immergés en mer[8] ou plongés dans un liquide de refroidissement[9] deviennent des « innovations » souhaitables.
L’impact du numérique sur la planète et la société est loin de se limiter à une question énergétique, et faire décroître l’emprise qu’il exerce relève certainement plus de questions politiques et culturelles que d’ingénierie. Certains, comme l’inénarrable Gilles Babinet, serial-entrepreneur de la tech, digital champion français auprès de la Commission européenne et coprésident du Conseil National du Numérique, s’approprient l’expression « Décroissance Numérique ». Le terme n’est envisagé que sous le prisme économiciste du produit intérieur brut, travestissant au passage toute la richesse d’une pensée qui, de Nicholas Georgescu-Roegen à André Gorz, de Serge Latouche à Paul Ariès et jusqu’au pape François, esquisse un projet de société allant bien au-delà de simples considérations comptables. La confusion est telle qu’il lui devient possible d’écrire « un des futurs possibles que pourrait dessiner la big data semble très proche du projet politique des “décroissants” »[10].
Le Shift nous propose un modèle de société où la décroissance numérique serait le fait de gouvernants éclairés par les rapports d’experts bien intentionnés. Une sorte de projet « à la chinoise » où un État fort s’occupe de rationaliser les usages en s’appuyant sur une technocratie avide de chiffres. Gilles Babinet, lui, nous propose un projet où ce sont les algorithmes qui remplissent cette fonction, une société d’optimisation plutôt que d’autolimitation. Et dans tous les cas, la perpétuation du modèle actuel, en corrigeant quelques-uns de ses travers par des méthodes autoritaires. Les arguments ne manquent pourtant pas pour illustrer l’incompatibilité ontologique entre décroissance et société numérique, comme nous le donne à voir Emmanuelle Caccamo[11].
Dans Contre l’Alternumérisme, nous ne parlons pas de décroissance, mais de « désescalade technologique », empruntant au champ lexical des conflits armés plutôt qu’à celui de l’économie. À bien des égards le numérique peut être vu comme le champ de bataille de la guerre que mène la technocratie contre la planète, les peuples et la démocratie. Mais néanmoins les deux concepts peuvent être facilement rapprochés, à la condition de définir « décroissance », selon les termes de ceux qui l’ont pensée, comme un mot-obus, inscrit dans la critique du développement :
Nous ne devons pas craindre de réaffirmer sans cesse que la décroissance ce n’est pas la décroissance de tout ni pour tous. Elle s’applique aux « surdéveloppés », à l’«ex-croissance», à des sociétés et des classes sociales dont l’obésité et la boulimie sont des conséquences de la captation de richesses des plus faibles, en même temps qu’un processus d’auto-destruction. La question du partage, donc de la démocratie, précède celle de l’économique.<[12]
Le numérique, dans la lignée de la mécanisation et de l’automatisation, a engendré depuis plus de 50 ans des bouleversements massifs dans le système productif. Dans les pays développés, après l’élimination d’une grande proportion des paysans dès les premières vagues de bouleversements technoscientifiques, puis des ouvriers par l’automatisation et le transport international, et ensuite des employés de bureau par l’informatisation, on nous promet cette fois-ci la destruction des professions intellectuelles et leur remplacement par des algorithmes et l’intelligence artificielle. La démocratie, déjà bien mal en point, pourrait ne pas y survivre. C’est le règne des experts, des ingénieurs et des scientifiques qui nous est annoncé comme inéluctable. « On n’arrête pas le Progrès », et celui-ci nous cantonne toujours plus au rôle d’objet et nie notre statut de sujet. Nous sommes réduits à n’être qu’une itération de base de données pour les États, un profil de consommateur pour les GAFAM et les supplétifs de la machine pour nos employeurs.
Dans ces conditions, une décrue de l’emprise technologique est impossible à moyens humains et financiers constants. Remettre de l’humain partout, des guichets dans les administrations, des artisans à la place des usines automatisées, des paysans plutôt que des tracteurs guidés par GPS et des enseignants dans les salles de classe, ne se fera pas sans heurts. L’exemple du Bhoutan et de son « indicateur de bonheur national brut » est souvent cité, mais une « bhoutanisation » d’un pays développé, si elle était souhaitable, est impensable sans changer de règle du jeu. Faire décroître le numérique unilatéralement, dans un contexte de libre-échange généralisé et de gouvernance supranationale, corsetée dans de multiples traités internationaux, ne pourrait mener qu’à la ruine. Les gains de productivité ont été tels que revenir en arrière sans s’extraire de la compétition mondiale du « moins disant social et environnemental » serait synonyme de récession subie plutôt que de décroissance choisie. Une décroissance numérique n’est donc envisageable que dans un contexte de « décroissance tout court », où la transformation sociale est totale et ne concerne pas que l’aspect informatique.
Il faut aussi prendre en compte que si tant d’aspects de notre société peuvent être informatisés, c’est que tout un ensemble de mécanismes y préparent le terrain. En amont de l’algorithme, il y a l’organisation « scientifique » du travail. Lorsqu’un emploi est détruit et remplacé par un programme, c’est que celui-ci avait déjà été dégradé, normalisé, rationalisé. L’ouvrier contraint d’effectuer sans cesse le même geste a facilement pu être remplacé par la machine. Il en va de même pour l’employé de bureau dont la fonction consiste à répéter inlassablement les mêmes opérations : une fois atteinte cette situation, son remplacement par un algorithme devient réalisable. S’il est possible de remplacer des journalistes par une intelligence artificielle[13], ce n’est pas seulement le fait de l’évolution technologique, c’est aussi que les conditions d’exercice de ce métier, réécriture de dépêches prémâchées par des agences de presse, obsession du flux et de l’instantanéité, l’ont dégradé jusqu’à créer les conditions de son automatisation. La désescalade numérique, ce n’est pas simplement supprimer l’ordinateur, c’est organiser différemment toute la société pour pouvoir s’en passer.
Pour qu’un tel changement de paradigme, une bifurcation sociale et culturelle d’une telle ampleur puisse advenir, la conjonction de trois facteurs est indispensable :
Les mouvements sociaux victorieux ces deux derniers siècles montrent qu’une transformation sociale ne peut résulter que de la conjugaison de trois efforts : le rapport de force, la présence d’alternatives et l’éducation populaire. […] Ces trois efforts, qui sont rarement menés conjointement par les mêmes acteurs, s’opposent en partie dans l’esprit de beaucoup. Or, précisément, ils sont tous trois indispensables et devraient être menés de front, quitte à ce que chacun accepte de ne pas pouvoir tout faire tout le temps, en même temps[14].
En matière de numérique, le rapport de force commence à être esquissé par le mouvement anti-5G. S’opposer à un nouveau « franchissement de seuil » dans les infrastructures de télécommunications qui conditionnent le déploiement d’un nouveau surcroît de technologies, en faire une grande lutte populaire contre la numérisation du monde. Déployer nos efforts partout, dans l’opposition à la numérisation de l’école, contre la massification du télétravail, pour la sauvegarde des guichets dans les administrations ; contre la smart city et l’agriculture connectée ; contre les GAFAM et contre l’État technicien. Mais aussi, exposer et confronter les think tanks et autres « comités Théodule », les prophètes vert-pâle ainsi que la recherche publique et son rôle déterminant dans la poursuite du modèle actuel.
Construire des alternatives, ce n’est pas remplacer l’existant par son équivalent « libre », Zoom par BigBlueButton, Twitter par Mastodon et Schneider Electric par Arduino. C’est recréer tous ces métiers que la numérisation a détruits. Installer des millions de paysans en agroécologie ou recommencer à produire à une échelle artisanale ne sera pas simple, les savoirs et savoir-faire ont souvent disparu et les conditions économiques et réglementaires condamnent leurs promoteurs aux marchés de niche ou à la « réserve d’Indiens ». Une société en décroissance numérique réclame des tourneurs-fraiseurs, des forgerons, des menuisiers, des paysans, des enseignants… Des humains plutôt que des machines, des cerveaux plutôt que des serveurs !
Dernier pilier indispensable, l’éducation populaire. Il ne s’agit bien sûr pas d’éduquer le peuple, mais plutôt d’ouvrir partout et tout le temps des espaces d’éducation mutuelle entre pairs. Remettre de la démocratie partout où règne la technocratie. Pouvoir discuter et rediscuter chaque choix technique, faire de la technologie un sujet politique et ne plus laisser le capital, la raison d’État et les intérêts particuliers confisquer la possibilité même qu’il y ait débat. Refaire société et retrouver notre autonomie. Pas l’autonomie individuelle comme la conçoit le libéralisme, mais plutôt le fait de se donner à soi‑même sa loi, d’élaborer ensemble les règles de vie communes et de décider collectivement de notre autolimitation[15].
Voilà donc quelques pistes de sortie de la société du tout-numérique. Ne nous racontons pas d’histoires : si celui-ci est le système nerveux de notre société, il ne pourra pas en être extirpé chirurgicalement, sans un bouleversement complet de son fonctionnement. La rupture nécessaire, politique, productive et culturelle est immense et cela ne se fera pas sans douleur, ni sans une résistance acharnée à tous les niveaux. Le pays qui choisira le premier cette bifurcation s’exposera obligatoirement à une concurrence déloyale de tous les autres et devra faire le nécessaire pour s’en protéger. Mais si nous parvenons à décoloniser nos imaginaires, à réapprendre à faire sans la béquille technologique et à décider collectivement comment nous souhaitons produire et vivre, alors nos émissions de CO2 baisseront et les ressources seront plus équitablement et durablement réparties, sans besoin d’État autoritaire, d’experts bien intentionnés ou de rationalité algorithmique.
Nicolas Alep est informaticien en rupture de ban, militant technocritique et notoirement sous-diplômé. Du Sud de la France, il s’excuse auprès des lecteurs pour le caractère très franco-français de son propos.
Ce texte n’engage pas Julia Laïnae, « décâblée » au moment de sa rédaction.
- [1] Laïnae Julia & Alep Nicolas, Contre l’Alternumérisme, Saint-Michel-de-Vax, La Lenteur, 2020.
- [2] Voir la synthèse qu’en fait Almazán Gómez Adrián, « La non-neutralité de la technologie. Une ontologie sociohistorique du phénomène technique », Revue Ecologie et Politique, n°61, 2020.
- [3] L’Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines, Paris, Seuil, 2021. p142
- [4] Enterprise Resource Planning, Progiciel de gestion intégré, au cœur du fonctionnement de toute entreprise.
- [5] Lawler Samantha, « Les satellites Starlink nous empêcheront bientôt d’observer les étoiles », The Conversation, 17 novembre 2020, URL : https://theconversation.com/les-satellites-starlink-nous-empecheront-bientot-dobserver-les-etoiles-150410, consulté le 12 avril 2021.
- [6] Toutes les informations proviennent du site web : https://theshiftproject.org.
- [7] Garin Virginie, « L’Arctique va accueillir le plus grand datacenter au monde », RTL, 31 août 2017, URL : https://www.rtl.fr/actu/sciences-tech/l-arctique-va-accueillir-le-plus-grand-datacenter-au-monde-7789901458, consulté le 12 avril 2021.
- [8] Comme par exemple le « Projet Natick » de Microsoft et Naval Group, URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_Natick
- [9] Touchard Manon, « Pour mieux refroidir ses serveurs, Microsoft les plonge dans un liquide bouillant », L’Usine Digitale, 8 avril 2021, URL : https://www.usine-digitale.fr/article/pour-mieux-refroidir-ses-serveurs-microsoft-les-plonge-dans-un-liquide-bouillant.N1079744, consulté le 12 avril 2021.
- [10] Babinet Gilles, « Devenir décroissants à l’Ere numérique? Hypothèse », Digitalis Purpurea, 6 juillet 2014, URL : http://www.gillesbabinet.com/devenir-decroissants-lere-numerique-hypothese/, consulté le 12 avril 2021.
- [11] Caccamo Emmanuelle, « Critique de la “numérisation” croissante de la société. Vers une trajectoire alterna-tive et décroissante », dans E. Caccamo, J. Walzberg, T. Reigeluth et N. Merveille (dir.), De la ville intelli-gente à la ville intelligible, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2019.
- [12] Ariès Paul, « La décroissance, un mot-obus », La Décroissance, n°26, avril 2005.
- [13] Claudel Maxime, « Microsoft remplace les journalistes qui éditent ses portails d’info par des algorithmes », Numerama, 1er juin 2020, URL : https://www.numerama.com/tech/627618-microsoft-remplace-les-journalistes-qui-editent-ses-portails-dinfo-par-des-algorithmes.html, consulté le 12 avril 2021.
- [14] L’Atelier Paysan, op. cit.
- [15] Voir le travail de définition et d’explication de Cornélius Castoriadis à ce propos dans son article « Socialisme et société autonome » de 1979, republié dans Écrits politiques (1945-1997). Quelle démocratie ?, tome II, Paris, Éditions du Sandre, 2013.