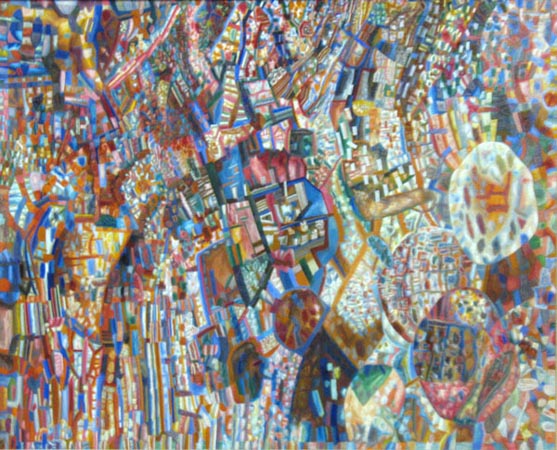Introduction
Le discours sur le populisme constitue aujourd’hui l’un des hauts lieux de l’exercice du mépris, voire du racisme, de classe. Ce discours vise à expliquer les succès électoraux des partis d’extrême droite, en en faisant des partis « des classes populaires », voire « de la classe ouvrière », à travers la mise en vis-à-vis des idées proclamées par ces partis, notamment leur rejet de l’étranger, et des penchants supposément « naturels » des milieux populaires vers la xénophobie. En affirmant leur incompétence politique, laquelle renverrait à leur ignorance ou inintelligence, le discours sur le populisme est tel que « les groupes populaires se voient alors dépossédés du rôle actif qu’ils ont pu jouer dans l’histoire de la démocratie, jusqu’à perdre le sens des causes qu’ils ont plaidées et réussi à faire entendre »[1]. Ce discours aboutit ainsi à l’oubli du fait qu’« il a pu exister une prétention à la compétence politique semblable à celle prônée par les intellectuels politiques d’aujourd’hui, mais portée par les groupes populaires et avec un projet très différent du leur : non pas contrer la démocratie représentative, mais la réaliser le plus complètement possible »[2]. Dans cette analyse, nous allons questionner ce qui aujourd’hui, sous couvert de l’attribution d’ignorance et d’inintelligence aux groupes populaires, empêche une telle compétence politique de s’exprimer et les conditions pour le développement d’une nouvelle pratique politique à même de lever cet empêchement.
Le discours sur le populisme comme rêve d’une démocratie dépeuplée
Commençons en soulignant le caractère objectivement douteux des interprétations des statistiques sur lesquelles repose l’idée du tournant vers l’extrême droite des classes populaires. Il est trop facile d’utiliser les sondages d’opinion et les résultats électoraux pour « faire parler » ceux dont la prise de parole est systématiquement déjouée par ces mêmes dispositifs. Prenons le cas du « vote FN », auquel Annie Collovald a consacré une étude minutieuse : alors que les « électoralistes » se concentrent sur la correspondance entre vote FN et faible niveau scolaire, ce qui les conduit à associer le FN et les « classes populaires », une analyse plus précise des données montre que ce qui permet de regrouper les électeurs du FN avec un faible niveau scolaire c’est, plus que le pôle culturel en lui-même, le pôle économique :
Si l’on se reporte à la composition sociale des électeurs FN que les sondages présentent, le lien entre vote FN et faible niveau d’études masque, en fait, la prédominance du pôle économique : agriculteurs, petits commerçants et artisans, petits patrons, professions libérales et plutôt les ouvriers et employés artisanaux (dans des petites entreprises). (…) Cette primauté du pôle économique rapproche la clientèle frontiste des clientèles de la droite classique et suggère plutôt, contre la thèse du “gaucho-lepénisme”, une radicalisation des électeurs de droite[3].
Par ailleurs, s’il existe un « parti de la classe ouvrière » aujourd’hui, il s’agit avant tout du parti de l’abstention : « [Les] préférences [des ouvriers] ne vont pas au FN à l’inverse de ce que les commentaires électoraux ne cessent de répéter : elles vont à l’abstention, qui est le “premier parti ouvrier” désormais et à la gauche même si l’écart se réduit »[4]. Il faut, enfin, noter que, s’il est vrai que certains électeurs des milieux populaires se sont déplacés vers la droite, une des causes de ce déplacement est bien entendu le déplacement d’une partie de la gauche elle-même vers le néolibéralisme, déplacement assorti d’un très fort mépris de classe[5].
Ce qui nous intéresse toutefois plus directement est d’identifier la fonction du mépris de classe que l’élite politico-intellectuelle exprime à travers le discours sur le populisme. D’un côté, ce discours entérine l’image du « peuple » que se donnent les dirigeants des partis d’extrême droite, qui supposent que les « gens du peuple » votent pour eux parce qu’ils sont vraiment convaincus par leurs idées, qu’ils les choisissent parce qu’ils représentent vraiment leurs valeurs, de sorte que ces partis sont bien heureux d’endosser le « stigmate » qu’on leur adresse, en le transformant en une qualité positive et en déclarant : « nous sommes du peuple » (alors même qu’une étude de l’extraction sociale des principaux dirigeants de ces partis infirmerait immédiatement une telle affirmation)[6]. D’un autre côté, le discours sur le populisme attribue le « vote populiste » à la supposition que les ressortissants des classes populaires sont ignorants ou, plus simplement, stupides. La question semble donc se poser de savoir si les « gens du peuple » votent comme des « grands », c’est-à-dire en évaluant et choisissant rationnellement le programme qui rencontre le mieux leurs idées et leurs valeurs, ou bien comme des « enfants », en répondant spontanément à ceux qui interpellent leur « ventre ». Les deux options se rencontrent toutefois dans l’idée que les gens ont des mauvaises idées parce qu’ils sont stupides. La solution au problème est alors trouvée toute prête : il faut éduquer les groupes populaires, pour que leurs membres deviennent des « bons citoyens », certains allant jusqu’à dire qu’il faudrait rendre le droit de vote dépendant d’un « test de citoyenneté »[7] – ce qui est finalement une conséquence assez logique de l’idée selon laquelle la capacité politique dépend de l’éducation.[8]
L’hypothèse que nous proposerons dans cette analyse est que le discours sur le populisme occupe la place (« l’idéologie a horreur du vide », disait Althusser) du questionnement véritablement pertinent, qui concerne le rapport des classes populaires avec la politique instituée, dont on peut dire, de manière provisoire, qu’il est un rapport qui les met dans une position d’inclusion excluante dans le champ politique, position qui favorise à son tour des formes d’auto-exclusion, dont le vote pour l’extrême droite est aujourd’hui, autant que l’abstention, une manifestation : « Sous cet angle, il n’est pas sûr que le vote FN ne soit pas, pour certains des électeurs populaires, qu’une autre figure de l’abstention ou mieux encore une abstention “active”, seule solution laissée par l’offre politique, pour manifester à la fois un sentiment de relégation sociale et une croyance maintenue dans l’efficacité du jeu politique »[9]. Le problème essentiel n’est donc ni celui des valeurs, ni celui de l’intelligence, mais celui de la dépossession ou de l’impuissance : « on comprendrait mieux “l’intérêt” ou “l’indifférence pour la politique” si l’on savait voir que la propension à user d’un “pouvoir” politique (le pouvoir de voter, de “parler politique” ou de “faire de la politique”) est à la mesure de la réalité de ce pouvoir ou, si l’on préfère, que l’indifférence n’est qu’une manifestation de l’impuissance »[10].
En occupant la place du questionnement de l’impuissance, le discours sur le populisme n’a pas une fonction « descriptive », mais sert aux élites politico-intellectuelles à s’attribuer une nouvelle légitimité en reformulant leur mission comme une expertise sur la bonne gouvernance démocratique, sur les limites à imposer à la démocratie pour qu’elle fonctionne comme il faut (à leurs yeux), c’est-à-dire pour que le peuple ne la « perturbe » pas, ce qui ne peut qu’aboutir à un renforcement des logiques d’inclusion excluante du champ politique[11]. Le peuple est alors envisagé exclusivement sous l’angle du « problème à résoudre », comme image-repoussoir permettant de justifier les modes de gouvernance néolibéraux :
Avec le populisme, il est bien question du peuple, mais d’un peuple réduit au statut de problème et refait par les préjugés d’une élite sociale et pour les besoins de la cause néolibérale qui projette la construction d’un avenir radieux, conduit par la mondialisation des logiques financières, contrôlé par des experts et défini par une bureaucratie enchantée de trouver dans le néolibéralisme les moyens d’un pouvoir réaffirmé. Le peuple stigmatisé, non seulement pauvre économiquement et intellectuellement mais pauvre moralement tant il est prompt à se rallier à tous les slogans simplistes et xénophobes serinés par un chef à poigne, vulgaire et démagogue, est ainsi la condition nécessaire à la réussite de l’emprise néolibérale. Le peuple doit être méprisé et méprisable pour que se réalise l’utopie conservatrice du néolibéralisme rêvant d’une démocratie dépeuplée[12].
En ce qui concerne les fonctions du discours sur le FN comme parti des classes populaires, il faut également souligner qu’il correspond à un dédouanement des groupes privilégiés :
Il occulte tout un pan du monde social, et notamment celui de l’élite sociale. En effet l’interprétation renvoie dans l’invisible les groupes appartenant aux fractions sociales supérieures qui votent pour le FN (…) (patrons, cadres supérieurs du privé, professions intellectuelles). En quelque sorte, l’élite sociale (plus diplômée et donc plus « instruite ») se trouve d’emblée exonérée de tout penchant « xénophobe » ou « autoritaire »[13].
Plus encore, la transformation de l’image du peuple impliquée par le discours sur le populisme permet de « situe[r] la cause du phénomène abhorré hors du cercle des initiés à la politique »[14]. Que l’on pense par exemple au fait que l’explication du vote FN par la xénophobie supposément constitutive des classes populaires en vient à oblitérer le rôle central des élites politiques et médiatiques dans le processus par lequel « “l’immigration” est passée d’enjeu émergent en thème central des débats publics après avoir subi une reformulation dans un sens de plus en plus sécuritaire ». Il faut également souligner que, lorsque dans des sondages les travailleurs répondent à des questions sur les « immigrés », ce qui oriente leurs réponses n’est pas tant la question sécuritaire que celle de leurs propres conditions de vie, de plus en plus difficiles. Toutefois, cette nuance est le plus souvent effacée par l’attribution de ces réponses à une xénophobie constitutive. On peut alors poser la question : « Est-ce alors d’intolérance dont il faut parler lorsque des personnes opinent à des questions portant sur les immigrés, ou de sensibilité aux discours médiatiques ou encore de réponses “à côté” de la question posée ? »[15]
En rattachant, à l’encontre du discours sur le populisme, le vote des classes populaires à la dépossession et à l’impuissance qui caractérise leur rapport à la politique instituée, nous nous demanderons s’il est possible de penser une transformation de la forme même de la politique, c’est-à-dire la mise en place d’une nouvelle pratique de la politique, qui rompe avec les formes d’inclusion excluante qui caractérisent le champ politique. Dans la mesure où la politique instituée fait dépendre la capacité politique d’une éducation préalable, permettant d’acquérir des compétences spécifiquement politiques, l’éducation permanente peut occuper un place centrale dans la nouvelle pratique de la politique, en raison de l’idée dont elle est porteuse selon laquelle l’éducation doit prendre place au sein même du processus d’émancipation, cette dernière devenant impossible dès qu’on prétend la faire précéder par l’éducation. Il s’agira donc de transformer parallèlement notre idée de politique et d’éducation, pour cesser de les penser séparément (la deuxième comme condition de la première) et commencer à les penser comme constituant, prises ensemble, le cœur même de tout processus d’émancipation.
Pour ce faire, nous allons reprendre les analyses du fonctionnement du « champ politique » et de son rapport avec le « champ social » (c’est-à-dire le champ des rapports entre classes sociales) formulées autour des années 1970 et 1980 par Pierre Bourdieu. Si Bourdieu parvient bien à identifier la manière dont la politique classique produit une forme d’inclusion excluante des groupes populaires, son discours repose sur un présupposé qui l’empêche de se donner les moyens pour penser la politique autrement. Ainsi, notre objectif sera de démontrer que la perspective de l’EP permet, en modifiant ce présupposé, de « faire le pas » que Bourdieu lui-même n’a pas accompli.
Prise de parole, universalisation d’intérêts particuliers, sortie de l’isolement. Trois fonctions du champ politique
Le principe de l’analyse bourdieusienne est que la participation au champ politique suppose la maîtrise de certaines compétences techniques, notamment des compétences permettant d’énoncer des « opinions » de manière universelle, c’est-à-dire en faisant abstraction d’une expérience vécue particulière, afin de mobiliser un groupe assez consistant d’individus. Bourdieu reconnait que la maîtrise d’une compétence technique ne dépend pas de l’« intelligence », mais de ce qu’il appelle une « compétence sociale », qui dépend elle-même du statut social de la personne concernée (c’est pourquoi il parle parfois de « compétence statutaire » : « la compétence “technique” dépend fondamentalement de la compétence sociale et du sentiment corrélatif d’être statutairement fondé et appelé à exercer cette capacité spécifique, donc à la détenir, cela par la propension à l’acquérir qui est fonction de la capacité et de la nécessité socialement reconnues de l’acquérir »[16]). Ainsi, les membres des classes populaires ne possèdent pas la compétence technique nécessaire à s’inscrire dans le champ politique parce que, par leur statut, ils ne sont jamais appelés à l’exercer et n’ont pas le sentiment d’être censés s’occuper de politique. En plus, cette non-possession ne fait en retour que renforcer leur disqualification. La dépossession se base donc sur des « mécanismes qui portent ceux que la sélection technocratique exclurait en tout cas à s’exclure “librement” du jeu démocratique »[17].
On voit donc que, selon Bourdieu, la participation au champ politique requiert la maitrise d’une compétence permettant de (1) prendre la parole, (2) formuler des positions universalisables, c’est-à-dire pouvant être détachées d’une expérience vécue particulière, (3) sortir de l’isolement. Le problème posé par la détention de cette compétence est encore renforcé par le fait que le lieu clé de cette sortie de l’isolement est, dans la politique instituée, l’isoloir[18], ce qui réduit pour la plupart des citoyens la pratique politique à l’adhésion isolée ou au refus isolé des « opinions politiques » produites par ceux qui se situent véritablement dans le champ politique. La politique devient donc une sorte de marché avec des producteurs d’opinions (exerçant un monopole plus ou moins grand) et des consommateurs d’opinions (plus ou moins avertis)[19].
Le champ (de production) politique est le lieu, inaccessible en fait aux profanes, où se fabriquent, dans la concurrence entre professionnels qui s’y trouvent engagés, des formes de perception et d’expression politiquement agissantes et légitimes, qui sont offertes aux citoyens ordinaires, réduits au statut de « consommateurs ». Ceux-ci sont d’autant plus complètement voués à la délégation inconditionnelle à leurs représentants qu’ils sont dépourvus de compétence sociale pour la politique et d’instruments de production propres de discours ou d’actes politiques [20].
Il y a donc deux problèmes concomitants : la détention d’une compétence sociale et la structure même du champ politique – la deuxième requérant la première comme sa condition d’accès, et la première restreignant par conséquent l’accès à la deuxième.
Bourdieu identifie trois rapports possibles à un champ politique ainsi structuré : la rapport « personnaliste » ou « intimiste », propre aux classes moyennes et supérieures, qui, possédant une compétence sociale et par conséquent technique à l’égard de la politique, revendiquent leur droit à « se faire une opinion politique » sur n’importe quel sujet, en appliquant à tous les sujets les principes abstraits de formation de positions politiques universalisables (par exemple le principe de la division entre gauche et droite). Affirmer que les classes populaires sont « de droite » signifie alors attribuer aux classes populaires un rapport à la politique qui est celui des classes moyennes et supérieures. En réalité, dit Bourdieu, les classes populaires entretiennent deux autres rapports avec le champ politique : « contre la foi naïve dans l’égalité formelle devant la politique, la vision populaire est réaliste qui ne voit pas d’autre choix, pour les plus démunis, que la démission pure et simple, reconnaissance résignée de l’incompétence statutaire, ou la délégation totale, remise de soi sans réserve que désigne manifestement la notion théologique de fides implicita, confiance tacite, adhésion silencieuse, qui choisit sa parole en choisissant ses porte-parole »[21]. Ce choix repose en dernière instance sur la perception (plus ou moins correcte) d’un « ethos » commun entre représentés et représentants, c’est-à-dire d’une communauté de manières de faire, de parler, de se présenter, etc. Il va de soi que, dans la mesure où cette délégation, en plus de faire exister le représentant, fait exister les représentés comme groupe, en les faisant sortir de l’isolement, elle est exposée à tous les dangers de l’usurpation de la parole qu’elle est censée représenter. « Les individus à l’état isolé, silencieux, sans parole, n’ayant ni la capacité ni le pouvoir de se faire écouter, de se faire entendre, sont placés devant l’alternative de se taire ou d’être parlés »[22]. De son côté, la « démission pure et simple » peut toujours prendre la forme de l’abstentionnisme, mais aussi d’« un anti-parlementarisme qui peut être détourné vers toutes les formes de “populisme” autoritaire ». Ce dernier étant donc en dernière instance lui aussi « une contestation du monopole des politiciens »[23]. Il y a donc un rapport de proportion inverse entre détention de la compétence politique d’un côté et inconditionnalité de la délégation ou ampleur de la démission (c’est-à-dire exclusion du champ politique) de l’autre.
Il s’ensuit que la situation la meilleure que le champ politique puisse offrir « aux plus démunis » est, selon Bourdieu, de faire en sorte qu’ils « puissent eux-mêmes critiquer les positions tenues en leur nom ». Ainsi, « l’usurpation ne peut être combattue que par la diffusion d’instruments de pensée politique ». Cette idée implique que, bien qu’il s’agisse de rendre aux plus démunis une certaine puissance politique, « la lutte contre la monopolisation va pourtant être présentée comme l’une des tâches cruciales qui incombent aux intellectuels », en reproduisant un schéma pédagogique assez classique[24]. En effet, même « les mouvements nés de la révolte contre le monopole des politiciens sont toujours instables et fragiles », parce qu’ils « ne disposent pas de la théorie qui leur permettrait de se comprendre et de s’organiser conformément à leur vocation profonde ». D’où l’appel de Bourdieu à « l’instauration d’une nouvelle collaboration entre les intellectuels critiques – non pas seulement de l’ordre social, mais d’eux-mêmes et de tous ceux qui prétendent transformer l’ordre social – et les mouvements qui (…) entendent changer le monde social et les manières de penser et de changer le monde social »[25]. C’est une telle collaboration qui pourra entretenir le « rêve » d’un auto-dépérissement des porte-parole : « donner à chacun les moyens de fonder sa propre rhétorique (…) cela devrait être l’ambition de tous les porte-parole, qui seraient sans doute bien autre chose que ce qu’ils sont s’ils se donnaient le projet de travailler à leur propre dépérissement »[26].
Vers une nouvelle pratique de la politique
Il faut reconnaître que, pour pertinentes qu’elles soient en tant qu’analyses du champ politique institué et du rapport que les groupes populaires entretiennent avec lui, les thèses de Bourdieu reposent sur un présupposé qui l’empêche d’entrevoir la possibilité d’une autre pratique de la politique permettant aux « gens du peuple » de retrouver sous d’autres formes la compétence politique qu’ils avaient, dans d’autres conjonctures politiques, manifestée. Aux yeux de Bourdieu, les dominés ne connaîtraient en effet pas « la mise en suspens et en sursis de la nécessité économique et (…) la distance objective et subjective à l’urgence pratique » qui constitue « le principe de l’expérience bourgeoise du monde »[27]. Ce manque de distance serait ce qui les empêche de sortir de la particularité de leur expérience vécue pour produire un discours universalisable. « Le problème n’est pas simplement qu[e le discours populaire] ne soit pas légitime socialement, et donc audible dans le champ politique, il est bien plutôt de savoir quelle mobilisation peut s’opérer sur la base d’un discours qui n’est capable d’exprimer qu’une expérience unique, tendanciellement incommunicable, et à qui l’universalisation est en tout cas interdite »[28]. Pour le dire avec Bourdieu, « les plus démunis » ne pourraient pas convertir leur « plainte, entendue comme simple expression de la douleur, de l’insatisfaction ou du mécontentement, en plainte au sens juridique, en énonciation d’un tort ou d’une injustice (…) ou en revendication universelle »[29]. Une telle impossibilité d’universalisation est d’autant plus grave pour les dominés, dont la seule force réside justement dans la possibilité de se mobiliser collectivement :
On pourrait, pour simplifier, dire que les dominants existent toujours, tandis que les dominés n’existent que s’ils se mobilisent ou se dotent d’instruments de représentation. (…) [C’est pourquoi] les dominants ont intérêt au laisser-faire, aux stratégies indépendantes et isolées d’agents à qui il suffit d’être raisonnables pour être rationnels et reproduire l’ordre établi[30].
En ce sens, les dominés seraient destinés, pour exister politiquement, c’est-à-dire collectivement, à se soumettre à « l’alternative de se taire ou d’être parlés ».
Charlotte Nordmann a donc raison de poser la question suivante : « le problème ne vient-il pas de ce qu’il semble inconcevable à Bourdieu que les dominés eux-mêmes puissent parler, de sorte que ne peuvent émaner du “corps social” que des plaintes, des geignements ou grognements inarticulés, qui ne prennent sens que lorsqu’ils sont interprétés par d’autres ? »[31]. On peut en effet tout d’abord remettre en question l’idée selon laquelle la pression de la nécessité interdit toute réflexion. Bien au contraire, l’urgence est parfois le moteur puissant d’une distanciation qui n’est autre que la lutte larvée ou ouverte pour transformer la nécessité, alors même que ceux qui en sont moins affectés ont sans doute moins de raison de s’en distancier. Ce qui implique qu’« au sein même de la pratique se développent des formes de réflexivité qui n’ont rien à envier à la “réflexivité théorique” »[32]. Bourdieu lui-même le reconnaît ailleurs :
Il est des situations qui, parce qu’elles sont habités par de très fortes contradictions, imposent pour être comprises qu’on s’interroge à fond. (…) Le mode d’interrogation qui s’impose en ce cas confine à la recherche de la vérité sociologique ; sauf que la compréhension, apparemment gratuite, qu’on se donne alors de la situation a pour effet de permettre une relative maîtrise de cette situation et constitue alors comme la condition de la survie[33].
En plus, même si l’on accepte l’idée que les classes populaires ne détiennent pas la compétence permettant d’employer des principes abstraits pour universaliser des intérêts particuliers, il faut se rendre compte que la « valeur » de cette compétence dépend entièrement du « marché » où elle « circule », c’est-à-dire du champ politique institué, ce qui implique qu’il peut y en avoir d’autres, pour autant que l’on parvienne à repenser la structure même du champ politique. Ainsi, lorsque « à d’autres moments, [Bourdieu] dénonce l’irréalité du langage “proprement politique”, lorsqu’il revendique que puisse se faire entendre dans l’espace public le “franc-parler” des dominés », il semble « que l’universalité du langage politique ne soit plus la condition nécessaire de l’élaboration d’un langage politique, mais plutôt une limitation de ce langage, qu’il importerait de dépasser »[34].
Il faut donc reconnaître que la politique n’est pas une et que d’autres formes de politique sont possibles, bien qu’il y ait une « définition légitime, c’est-à-dire dominante et méconnue comme telle, de l’action politique » et que « la domination politique s’exerce, pour une part essentielle, par l’imposition, capitale pour les dominants, de cette définition (…), c’est-à-dire d’une “règle du jeu” favorable aux dominants »[35]. Si cette définition dominante n’envisage la sortie de l’isolement que par le biais de la production et l’adhésion à des discours universalisables, ce qui requiert certaines compétences statutaires reléguant ceux qui ne les détiennent pas soit dans la démission soit dans une délégation toujours en passe de se transformer en usurpation, on peut se demander s’il ne serait pas possible d’identifier d’autres pratiques politiques déjà à l’œuvre comme reposant non pas sur l’universalisation d’intérêts particuliers mais sur la perception de l’universalité d’une condition particulière. C’est qu’en effet il n’y a pas de symétrie entre les classes : les classes dominantes doivent universaliser leurs intérêts particuliers précisément parce que leurs intérêts sont particuliers et qu’il faut les faire accepter à ceux et celles qui ne s’y « intéressent » pas ; les classes dominées peuvent par contre construire une politique sur la base de l’appréhension de la particularité d’une condition comme étant commune. C’est ce que Bourdieu semble finalement lui-même laisser entendre :
Si l’attention à la situation particulière est indispensable pour donner crédit, le dépassement du cas particulier qui enferme dans la particularité, donc isole, ne s’impose pas moins puisqu’il est la condition de la mobilisation collective autour de problèmes communs. Cette dialectique du général et du particulier est au cœur de la politique et notamment de l’entreprise de politisation, avec la nécessité pour les uns, qui ont partie liée avec l’ordre établi, d’universaliser leurs intérêts particuliers et pour les autres, d’appréhender dans son universalité la particularité de leur condition »[36].
L’idée d’une appréhension de la particularité d’une condition comme étant commune n’implique d’ailleurs pas l’effacement de la différence entre formes de domination. Bien au contraire, elle ouvre, sur la base du partage d’une condition commune, un espace de singularisation des luttes contre les différentes formes de domination, c’est-à-dire aussi un espace d’alliances possibles en fonction des rapports de force spécifiques des différentes conjonctures[37].
Conclusion
Au terme de ce parcours, nous voudrions poser la question de savoir si la forme d’apprentissage promue par l’éducation permanente ne peut pas être élucidée par cette idée de politisation comme appréhension de la particularité d’une condition dans son universalité, comme une condition commune. En partant des besoins concrets de ses publics, de leurs vécus de souffrance, de discrimination, de précarité, l’éducation permanente ne vise pas à imposer sur ces vécus une représentation prédéterminée à prétention universelle de la société et de la manière de la transformer. Il s’agit plutôt d’établir avec les publics un lien entre, d’un côté, leurs vécus et besoins et, de l’autre, le caractère problématique de la situation à laquelle ils s’affrontent, comme étant une situation partagée, qui relève de dynamiques sociales déterminées, et non de leur responsabilité. Ce premier moment critique ouvre l’espace pour la construction d’un savoir collectif face à la situation problématique qui déplace les savoirs existants et suspend l’effet de dépossession produit par les compétences qu’ils supposent. Finalement, cela conduit à la construction collective de solutions, qui peut à son tour se poursuivre dans des processus d’action collective visant une transformation sociale. En d’autres termes, en tant que laboratoire d’expérimentalisme social, l’éducation permanente ne fait pas de l’émancipation un objectif à atteindre par une transformation sociale aux étapes prédéterminées, mais la condition d’une transformation sociale dont les étapes sont à déterminer collectivement. L’éducation permanente œuvre à la constitution d’un espace émancipé, au sein duquel et à partir duquel peut se développer la conscience du partage de l’universalité d’une condition et de l’universalité des capacités de la transformer – ce qu’on peut bien appeler égalité. C’est cela que nous appelons une nouvelle pratique de la politique.
C’est pour cette raison que les limites de l’approche bourdieusienne de la nouvelle pratique de la politique pourraient être dépassés par la proposition de Jacques Rancière de faire de l’égalité des capacités non pas le but à atteindre par la politique, mais une condition universelle à mettre en œuvre :
Le processus de l’émancipation est la vérification de l’égalité de n’importe quel être parlant avec n’importe quel autre. Il est toujours mis en œuvre au nom d’une catégorie à laquelle on dénie le principe de cette égalité ou sa conséquence – travailleurs, femmes, Noirs ou autres. Mais la mise en œuvre de l’égalité n’est pas pour autant la manifestation du propre ou des attributs de la catégorie en question. Le nom d’une catégorie victime d’un tort et invoquant ses droits est toujours le nom de l’anonyme, le nom de n’importe qui. (…) L’égalité existe et fait effet d’universalité pour autant qu’elle est mise en acte. Elle n’est pas une valeur que l’on invoque mais un universel qui doit être présupposé, vérifié et démontré dans chaque cas[38].
En ce sens, la forme d’apprentissage promue par l’éducation permanente bouleverse en profondeur le rapport classique entre éducation et politique d’émancipation (où la première est considérée comme une condition de la deuxième, comme ce qui permet d’acquérir les capacités pour pratiquer la deuxième). La forme d’apprentissage promue par l’éducation permanente met en avant un processus d’émancipation qui inclut une forme d’autocapacitation (et en ce sens d’éducation), ce qui suppose justement la présupposition de l’égalité ou de l’universalité des capacités.
Il serait donc intéressant de retracer les séquences émancipatrices où le rapport classique entre éducation et politique a été renversé, c’est-à-dire, pour faire court, où, en faisant de la politique, les gens se sont éduqués. Un cas typique est celui de la manière dont le « peuple » a appris le français « commun » en participant à la vie politique pendant la Révolution française :
Dans le cours de la révolution démocratique bourgeoise, les individus (…) deviennent citoyens avant de devenir élèves et de parler français. Ou plutôt, en apprenant à parler français dans l’armée, dans les organisations démocratiques, ils deviennent à eux-mêmes, au sein des masses, leurs propres « maîtres » dans une institution non scolaire[39].
Balibar et Macherey relèvent alors que, face à cette expérience, la bourgeoisie française a tiré une leçon qui a depuis lors affecté la constitution du champ politique comme dépendant de la maîtrise d’une compétence préalable : il ne faut pas que les gens s’éduquent au sein de processus politiques d’émancipation ; il faut d’abord les éduquer et, seulement ensuite, certains d’entre eux pourront faire de la politique – d’où découle la centralité de l’éducation scolaire comme seule forme d’apprentissage acceptable.
Tout se passe donc comme si, de cette expérience forcée, la bourgeoisie française avait, au cours du XIXe siècle, progressivement tiré une « leçon » (…) : il faut renverser l’ordre de dépendance matérielle entre la pratique politique (dans l’appareil idéologique d’Etat politique des partis, des assemblées, des élections) et la formation scolaire (dans l’appareil idéologique d’Etat scolaire, par la scolarisation généralisée). Il faut mettre l’école, pour chaque individu, qu’il soit bourgeois ou prolétaire, ou même paysan, avant la politique, à sa base ; faire de tous les Français des élèves de l’école primaire (et, pour certains d’entre eux seulement, du lycée et de l’université), avant d’en faire des citoyens et des électeurs (et, pour certains d’entre eux seulement, des députés, des fonctionnaires, des gouvernants)[40].
Il importe alors, pour tous ceux qui tiennent à la singularité de l’éducation permanente, de repenser et réinventer ces pratiques d’émancipation où politique et éducation ne faisaient qu’un.
- [1] COLLOVALD, A., Le « Populisme du FN ». Un dangereux contresens, Paris, Ed. du Croquant, 2004, p. 79.
- [2] Ibid., p. 93.
- [3] Ibid., p. 138.
- [4] Ibid., p. 143.
- [5] Cf. en ce sens l’ahurissant projet du think-tank « Terra Nova », proche du PS français, intitulé « Gauche : quelle majorité électorale pour 2012 ? », qui en vient pour l’essentiel à affirmer que, comme les milieux populaires ont développé des mauvaises « valeurs », il faut se donner un nouvel électorat. « Selon Terra Nova, “l’électorat ouvrier a basculé vers la droite” et (…) “partageant les idées culturelles du FN, sans voter pour lui du fait de son extrémisme”, il va enfin pouvoir le faire grâce à “la républicanisation du FN entamée par Marine le Pen”, faisant alors du FN “le parti des ouvriers et, plus globalement, le parti des classes populaires travailleuses” ». Le PS devrait alors construire « une nouvelle coalition “plus jeune, plus diverse, plus féminisée, plus diplômée, urbaine et moins catholique”, supposée “progressiste au plan culturel” et composée d’“outsiders au plan socioéconomique” [l’opposition outsider–insider constitue ce qui remplace aux yeux du PS la lutte des classes – ce qui revient à opposer travailleurs jeunes et travailleurs plus âgés, travailleurs stables et travailleurs précaires, travailleurs et retraités, au lieu d’opposer travail et capital] (…) qui constituerait “le nouvel électorat naturel de la gauche” ». Et Gérard Mauger de commenter : « Ainsi s’achève le cycle des métamorphoses de “la gauche” (celle qu’incarne le PS) : porte-parole historique des “valeurs de la classe ouvrière”, “de ses revendications sociales et de sa vision de l’économie”, elle se veut aujourd’hui celui des fractions “éclairées” (“cool ”) des classes dominantes ». Il faut alors reconnaître que, si les classes populaires s’éloignent du PS, « c’est beaucoup plus vraisemblablement, non pas tant à cause d’un “conflit de valeurs” supposé entre le PS et les classes populaires, qu’à cause du changement attesté d’orientation politique du PS. Au regard des profanes, son “virage à droite” (sans doute moins contestable que celui attribué aux classes populaires) le rend à peu près indiscernable de l’UMP qu’il prétend remplacer. (…) L’indifférenciation de “la droite” et de “la gauche” atteste que “les peuples, bien qu’ignorants, sont capables de vérité” (Machiavel) » (Mauger G., « Racisme de classe », Savoir/Agir, 2011/3, n° 17, pp. 101-105).
- [6] COLLOVALD, A., Le « Populisme du FN », op. cit., pp. 204sqq.
- [7] Ainsi par exemple un maire du Parti démocratique italien après le vote à la faveur du Brexit : https://www.ecodibergamo.it/stories/bergamo-citta/gori-contro-chi-ha-votato-la-brexitchi-e-disinformato-produce-disastri_1189429_11/
- [8] Il faut noter que cette idée est par ailleurs inscrite dans le principe même de l’âge de la majorité comme seuil pour l’exercice de la citoyenneté politique – l’idée étant justement qu’il faut être éduqué pour pouvoir faire de la politique (ne serait-ce que pour voter).
- [9] COLLOVALD, A., Le « Populisme du FN », op. cit., p. 160.
- [10] BOURDIEU P., La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979, p. 473.
- [11] Sur cette question, voir RANCIERE, J., La haine de la démocratie, Paris, La Fabrique, 2005. Il faut rappeler la théorie économique, aussi répandue qu’elle est ahurissante, du common pool, selon laquelle les finances publiques constitueraient un fond commun dont l’usage en régime démocratique les met au risque d’être excessivement exploitées par les citoyens. C’est ainsi qu’on prétend expliquer l’augmentation des dettes publiques, alors que, comme n’importe quelle étude empirique des revenus le montrerait, depuis les années 1980, les seules à s’être enrichis à travers l’augmentation de la dette publique ce sont les détenteurs de grandes fortunes. Cf. STREECK, W., Du temps acheté. La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Paris, Gallimard, 2014, Ch. II
- [12] COLLOVALD, A., Le « Populisme du FN », op. cit., p. 234.
- [13] Ibid., p. 159.
- [14] Ibid., p. 73.
- [15] Ibid., p. 146.
- [16] BOURDIEU, P., La distinction, op. cit., p. 478.
- [17] Ibid., p. 472.
- [18] Sur « l’anti-politique de l’isoloir », voir la note de LORDON, F., « “Les abstentionnistes laissent les autres faire le sale boulot”, ou l’anti-politique de l’isoloir », blog : La pompe à phynance, https://blog.mondediplo.net/2017-05-03-De-la-prise-d-otages.
- [19] Qui plus est, tout porte à croire que le champ politique est un marché où s’applique la loi « économique » (qui est en fait une imposture lorsqu’elle est appliquée au marché proprement économique) selon laquelle l’offre (d’opinions politiques) crée sa propre demande.
- [20] BOURDIEU, P., Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p. 213.
- [21] BOURDIEU, P., La distinction, op. cit., p. 489.
- [22] BOURDIEU, P., Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 263.
- [23] Ibid., p. 217.
- [24] NORDMANN, C., Bourdieu / Rancière. La politique entre philosophie et sociologie, Paris, Ed. Amsterdam, 2006, p. 72.
- [25] BOURDIEU, P., Propos sur le champ politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000, pp. 102-103.
- [26] BOURDIEU, P., Questions de sociologie (1979), cité dans NORDMANN, C., Bourdieu / Rancière, op. cit., p. 84
- [27] BOURDIEU, P., La distinction, op. cit., pp. 56-57.
- [28] NORDMANN, C., Bourdieu / Rancière, op. cit., p. 63
- [29] BOURDIEU, P., Méditations pascaliennes (1997), cité dans NORDMANN, C., Bourdieu / Rancière, op. cit., p. 99.
- [30] BOURDIEU, P., Langage et pouvoir symbolique, op. cit., p. 261.
- [31] NORDMANN, C., Bourdieu / Rancière, op. cit., p. 94.
- [32] Ibid., p. 98.
- [33] BOURDIEU, P., Misère, pp. 1325-1326.
- [34] NORDMANN, C., Bourdieu / Rancière, op. cit., pp. 101-102.
- [35] BOURDIEU, P. « Questions de politique », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 16, septembre 1977, p. 87.
- [36] BOURDIEU, P., La distinction, op. cit., p. 509.
- [37] L’ARC s’est intéressé à la question de la « convergence des luttes » : cf. BRUSCHI, F., « Pour une contre-convergence des luttes face au fémonationalisme », Analyse de l’ARC, 2018, URL : https://arc-culture.be/blog/publications/pour-une-contre-convergence-des-luttes-face-au-femonationalisme/; MATTHYS, J., « De la convergence des luttes à la lutte des convergences. Réflexions sur l’intersectionnalité et l’autonomie des luttes », Analyse de l’ARC, 2018 : https://arc-culture.be/blog/publications/de-la-convergence-des-luttes-a-la-lutte-des-convergences-reflexions-sur-lintersectionnalite-et-lautonomie-des-luttes/.
- [38] RANCIERE, J., Aux bords du politique, Paris, Gallimard, 2004, pp. 115-116.
- [39] BALIBAR, E., MACHEREY, P. « Présentation », in R. Balibar, D. Laporte, Le français national, Politique et pratique de la langue nationale sous la révolution française, Paris, Hachette, 1974, p. 28-29.
- [40] Idem.