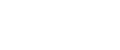Introduction
Face à la « crise écologique », les réponses se multiplient. Par-delà leur multitude on pourrait identifier deux tendances se déployant sur deux échelles différentes. La première est la tendance catastrophiste, dont les ouvrages de « collapsologie » constituent le versant à prétention scientifique et les discours Greta Thunberg le versant à visée populaire. Cette perspective consiste à faire appel aux élites économiques et politiques pour que, face à la perspective de la catastrophe, elles fassent le choix rationnel, qui rencontre l’intérêt de tous et toutes, de préserver l’environnement[1]. « Je veux que vous paniquiez », lançait Greta lors du forum de Davos ; « politicians talk, leaders act » [« les politiciens parlent, les leaders agissent »], énonçait une banderole de Greenpeace fort adroitement posée sous la statue de Léopold II près du Palais Royal lors d’une des manifestations pour le climat du printemps 2019. La deuxième tendance peut se résumer dans la devise (ou injonction) « Do-It-Yourself » (acronyme : « DIY »). Dans ce cas-ci, une évaluation rationnelle devrait conduire chaque individu à comprendre qu’il est dans son intérêt d’opérer une transformation de ses comportements dans le sens d’une auto-soustraction des logiques consuméristes peu respectueuses de l’environnement[2]. Entre les deux tendances, qui sont bien entendu loin de se contredire, se déploie tout le spectre des initiatives individuelles ou collectives visant, à des échelles plus ou moins vastes, à promouvoir l’écoresponsabilité.
Nous soutiendrons que toute pratique visant à affronter la crise écologique n’aura de portée égalitaire (et ne sera, même en termes purement écologiques, efficace) que si elle parvient à se dégager de l’anthropologie qui sous-tend l’économie dominante et selon laquelle les humains sont des sujets égoïstes maximisateurs rationnels de leur intérêt. Cette analyse se donne donc trois objectifs : 1) élucider l’anthropologie qui fonde l’économie dominante à partir de son ancrage dans les théories modernes de l’opposition entre état de nature et état de société ; 2) à partir des études de désastres qui, en raison de l’effondrement de l’ordre social qui les a caractérisés, auraient dû aboutir à quelque chose de similaire à l’état de nature, remettre en question l’anthropologie qui soutient l’économie dominante, et montrer qu’empiriquement, c’est plutôt une autre anthropologie – de type communiste – qu’il faudrait défendre ; 3) montrer qu’en dernière instance l’affaire n’est même pas d’ordre anthropologique mais relève des structures sociales capables de soutenir le développement de certaines formes d’individualité et certains rapports entre individus plutôt que d’autres (et donc d’une certaine économie plutôt que d’autres). Ce qui compte est alors la stratégie de lutte que l’on se donne pour reproduire ou faire advenir certaines structures sociales plutôt que d’autres.
Ainsi, si nous considérons que la perspective du désastre est bien pertinente pour penser la crise écologique, nous soutenons qu’il faut partir du présupposé que le désastre a déjà eu lieu [3]. Ce renversement nous conduira à identifier une anthropologie, et une stratégie permettant de l’entretenir, que l’on pourra caractériser comme communistes. Cela nous conduira en même temps à adopter par rapport aux pratiques visant à affronter la crise écologique un point de vue qui soit capable de se nourrir de l’expérience des opprimés qui ont été les plus affectés par les désastres passés[4].
1. Économie
Comme toute discipline à prétention scientifique, l’économie ne peut connaître son objet qu’en l’ayant préalablement défini. Un des critères essentiels qui définit l’objet de l’économie est que tout fait économique doit être mesurable. Comment l’économie assure-t-elle la mesurabilité de ses objets ? En découpant le réel de telle manière que l’un de ses morceaux (le champ économique) se sépare du tout de telle sorte que ses objets (les faits économiques) se donnent comme commensurables – les prix constituant le lieu où s’exprime la commensurabilité des objets de cette sphère. Souvent, ce découpage n’est pas assumé comme tel, car il repose sur une anthropologie selon laquelle la base de tous les faits économiques est l’homo œconomicus, c’est-à-dire le sujet économique maximisateur rationnel de son intérêt. Les prix sont en effet censés être le résultat de la composition des préférences hiérarchisées de l’ensemble des sujets en fonction des ressources disponibles (tout en fournissant en même temps au sujets l’information nécessaire à ce qu’ils puissent opérer des choix rationnels). Or, la définition du champ de l’économie politique par l’idée des êtres humains comme maximisateurs rationnels de leur intérêt rend possible l’universalisation de ce champ, comme s’il n’avait pas préalablement été découpé du réel, comme s’il était « trouvé » comme une évidence au lieu d’être « donné » par une anthropologie sous-jacente[5].
L’anthropologie fonde l’économie à partir de son ancrage dans les théories modernes de l’opposition entre état de nature et état de société. Les théories de l’état de nature constituent le fondement mythologico-philosophique de la doctrine du droit naturel, doctrine qui prétend énoncer des normes en fonction des caractéristiques de l’être humain, indépendamment des normes en vigueur dans telle ou telle société humaine particulière. C’est pourquoi cette doctrine doit se munir du mythe d’un état de nature – dont la plupart des penseurs admettent qu’il n’a en fait jamais existé –, permettant d’identifier des caractéristiques humaines « pré-sociales » et des normes censées leur répondre. Peu importe le contenu que chaque penseur attribue à l’état de nature, ce à quoi toutes ces doctrines aboutissent est l’idée que les humains possèdent quelque chose – par exemple la vie ou la liberté – qu’ils perdraient s’ils demeuraient dans l’état de nature (et dans l’état de guerre qui en découle plus ou moins directement) ; en plus, ces doctrines posent que les humains sont des êtres rationnels qui maximisent leur intérêt, ce qui les conduit à comprendre que c’est dans leur intérêt individuel de passer un contrat qui institue un pouvoir social, qui peut prendre une forme plus ou moins libérale selon les cas, leur assurant qu’ils ne perdront pas cette chose qui les définit comme humains.
L’économie libérale s’oppose à l’idée d’un état de société purement institué par contrat volontaire. Mieux, elle considère que l’état de société le plus souhaitable est lui-même le résultat de la constitution d’un ordre spontané dont le marché constitue la figure la plus aboutie. Le père du néolibéralisme, Friedrich Hayek, distingue par exemple entre « ordré spontané » et « ordre fabriqué », en estimant que « si des réformateurs indignés déplorent encore le chaos des activités économiques, c’est en partie parce qu’ils sont incapables de concevoir un ordre qui ne soit pas fabriqué délibérément, et en partie parce qu’à leurs yeux un ordre veut dire quelque chose qui vise des objectifs concrets, ce qui (…) est précisément ce qu’un ordre spontané ne peut faire »[6]. En particulier, le marché ne vise pas à atteindre un objectif déterminé (ce qui supposerait une instance sociale qui le détermine délibérément), mais vise à « augmente[r] les occasions ou les chances de tout un chacun d’avoir à sa disposition une gamme de biens divers (biens matériels ou services) plus étendue que nous ne pourrions en avoir d’aucune autre manière »[7]. Pour ce faire, il faut empêcher toute intervention d’un « commandement », d’un pouvoir social, au sein de cet ordre, ou limiter cette intervention à ce qui rétablit ou garantit le fonctionnement de cet ordre. Néanmoins, l’idée des êtres humains comme maximisateurs de leur intérêt demeure centrale : « Chaque individu appartenant à un groupe social prend part à de multiples échanges et fait usage d’une information foncièrement incertaine et incomplète avec le dessein de s’assurer le meilleur sort possible »[8]. La conception anthropologique fondamentale ne change donc pas par rapport aux théories de l’état de nature, sauf pour la manière foncièrement positive de comprendre le résultat du choc « spontané » des intérêts individuels.
Or, on peut se demander si, en passant du mythe à la réalité, cette vision se trouve confirmée. Ici réside l’intérêt de travaux qui se sont penchés sur les réactions des populations lors de catastrophes qui ont suspendu, pendant une période plus ou moins longue, l’ordre social – spontané ou fabriqué – habituel et qui peuvent donc être comparées à un retour à l’« état de nature ».
2. Anthropologie
Dans Paradise Built in Hell [Un paradis construit en enfer], Rebecca Solnit analyse les réactions de la population à la suite de catastrophes comme les tremblements de terre de San Francisco de 1906 et de Mexico City de 1985, l’ouragan Katrina à New Orleans en 2005, les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Ses analyses révèlent combien est infondée la croyance courante selon laquelle les désastres révèlent le pire dans la nature humaine – un égoïsme calculateur amplifié par l’effondrement de l’ordre social. « Horrible en soi, le désastre est parfois une porte vers le paradis, du moins un paradis dans lequel on est ce qu’on espère être, faire le travail qu’on désire, et chacun et chacune est le protecteur et la protectrice des autres. (…) Dans le désastre les gens font front commun, et bien que certains craignent ces rassemblements comme une horde, de très nombreuses personnes les chérissent comme une expérience de la société civile qui se rapproche assez du paradis »[9].
Comme le souligne un autre auteur, lors de ces événements, dans un premier moment du moins, ni l’État ni le marché ne se montrent capables de satisfaire les besoins vitaux de la population, et notamment de la partie de la population la plus démunie et donc aussi la plus frappée par la catastrophe. Or,
au lieu de provoquer un comportement égoïste, antisocial et même une situation de guerre, les faits suggèrent que, même dans des circonstances extrêmes, la plupart des gens tendent à retrouver une maîtrise de soi et à se préoccuper des conditions des autres assez rapidement. (…) Les désastres suspendent momentanément l’ordre social établi, générant des situations fluides dans lesquelles les gens souvent (sinon toujours) réagissent avec une empathie, une attention, et une préoccupation héroïque les uns pour les autres, en rompant le solipsisme qui est sans cesse encouragé par la culture capitaliste. Les désastres pourraient ainsi accorder un sursis temporaire de la vie quotidienne qui est devenue toujours plus atomisée, violente et décourageante. (…) Cela pourrait susciter un procès à long terme dans lequel une société plus juste et écologiquement soutenable, basée sur des besoins humains authentiques, commence à apparaître et devient le but de l’organisation collective[10].
Les images de pillage et meurtre qui viennent à l’esprit lorsqu’on pense aux catastrophes se révèlent alors non pas comme l’illustration de ce que serait une nature humaine aux prises avec des situations extrêmes, mais comme la projection sur le désastre – dument entretenue par ce qu’on choisit de raconter ces événements – de la quotidienneté violente et atomisée dans laquelle nous vivons, qui se trouve ainsi naturalisée. Cela révèle alors le caractère construit de l’anthropologie qui régit l’économie dominante, cette « nature » étant en fait bien plus « seconde » qu’on ne le croit.
Il ne s’agit bien entendu pas d’affirmer que les désastres produiront comme par magie un dépassement du capitalisme par la mise à jour d’une nature plus originelle que la « seconde nature » produite par l’inscription des individus dans un ordre social régi par le marché et l’État. Ce qu’il s’agit plutôt d’affirmer est que dans les désastres se révèle quelque chose du « communisme de tous les jours » qui, selon David Graeber, constitue la base de toute sociabilité, même celle qui soutient des rapports sociaux injustes et oppressifs.
Je définis le communisme comme toute forme de relation humaine qui repose sur le principe : « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins ». J’aurais pu choisir un terme plus neutre, comme « solidarité », « entraide » ou « convivialité », par exemple. Mais, sous l’inspiration de Mauss, je suggère de nous débarrasser une fois pour toute de cette idée vieillotte selon laquelle le « communisme » serait essentiellement une affaire de propriété, évoquant ces temps lointains où toutes choses étaient partagées en commun et ce scénario messianique d’un retour à la communauté de propriété – ce qu’on pourrait appeler le « communisme mythique ». Au contraire, je propose de considérer le communisme comme un principe immanent à la vie quotidienne. Même s’il ne s’agit que d’une simple relation entre deux personnes, chaque fois que notre action procède de la maxime « de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins », nous sommes en présence du « communisme de tous les jours » (everyday communism). Chacun, ou presque, se comporte ainsi lorsqu’il coopère avec autrui sur un projet commun. Si quelqu’un répare une fuite d’eau et demande à son acolyte : « Passe-moi la clé anglaise ! », il est peu vraisemblable que ce dernier lui répondra : « Et qu’est-ce que je gagne si je le fais ? ». Même s’ils travaillent pour ExxonMobil, Burger King ou la Royal Bank of Scotland… […] C’est pour les mêmes raisons qu’à la suite de catastrophes ou de bouleversements soudains – une grave inondation, une panne d’électricité générale, une révolution ou une sévère crise économique – les gens tendent à se comporter tous de la même façon et à renouer avec une sorte de « communisme prêt à l’emploi » (rough and ready communism). Les hiérarchies, les marchés et consorts apparaissent alors comme des articles de luxe que personne ne peut s’offrir. Quiconque a vécu de tels moments peut témoigner de la facilité avec laquelle les étrangers sont alors traités comme des frères et sœurs, et en quoi la société humaine elle-même semble naître à nouveau. Il ne s’agit pas ici seulement de coopération. Le communisme est le fondement de toute sociabilité humaine. Il rend la société possible[11].
Graber est attentif à assigner à sa proposition une fonction principalement critique : l’argument du communisme quotidien sert avant tout à critiquer la naturalisation de l’anthropologie économique dominante et à montrer que, selon les éléments que l’on choisit de considérer comme pertinents pour construire une anthropologie, on relève comme significatives certaines conventions économiques plutôt que d’autres. Cette perspective nous semble toutefois rencontrer ses limites stratégiques si elle aboutit à la révélation d’un principe moral anhistorique qui constituerait la base de toute société historique, ce qui revient à simplement remplacer une anthropologie par une autre, quand bien même celle-ci serait plus fondée empiriquement[12]
. Pour dépasser ces limites, nous soutiendrons que le concept de communisme de tous les jours n’a de portée stratégique que si on le comprend comme le ressort – qui s’exprime tout particulièrement dans les situations de désastre – de la résistance constante contre la catastrophe constante qu’est, pour certaines populations, la vie sous le capitalisme. De sorte que, tout comme les riches se préparent déjà pour la catastrophe écologique, les pauvres sont aussi, dans leurs luttes quotidiennes, qu’ils les sachent ou pas, et avec les moyens dont ils disposent, en train de se préparer[13].
3. Stratégie
Les réflexions qui nous semblent le mieux développer cette perspective stratégique ont été formulées par un « collectif transatlantique qui écrit dans, contre et par-delà l’empire écocidaire », collectif dénommé « Out of the Woods »[14].
Le présupposé de sa perspective est que les désastres qui vont prochainement se multiplier produiront si peu un dépassement du capitalisme que ce dernier se nourrit du désastre. Pour exprimer cette idée, ils proposent d’introduire la distinction entre « désastre-événement » et « désastre-condition » : « les conditions donnent lieu à des événements qui, en retour, renforcent davantage les conditions. Le but de l’État-nation pendant et dans la suite immédiate de désastres extraordinaires exacerbe généralement le désastre constant du capitalisme »[15]. D’abord, il n’y a pas de catastrophe naturelle : mêmes les catastrophes dues à des phénomènes naturels, non seulement sont, surtout dans leur fréquence et violence actuelles, dues aux activités humaines suscitées par la course capitaliste à la valorisation de la valeur, mais aussi frappent de manière différentielle les populations en fonction des inégalités produites en grande partie par le capitalisme. Par ailleurs, les formes d’entraide spontanées qui émergent du désastre maintiennent un fonctionnement minimal de la vie sociale sans coûts pour l’État et le marché, fonctionnement sur lequel ceux-ci peuvent ensuite se brancher pour le détourner à leur profit. Aussi, en général, de tels rapports ne se maintiennent en place que pour une période courte, tant que d’autres formes d’organisation sociale ne reprennent pas le dessus. Enfin, comme Naomi Klein l’a démontré dans La stratégie du choc, les désastres créent un terrain parfait pour l’extraction de surprofits, à travers la reconstruction des bâtiments et des infrastructures détruites qui rend possible une augmentation des prix et qui aboutit à la gentrification et à l’expulsion des populations vulnérables vers des endroits où elles sont encore plus vulnérables aux désastres à venir[16]. De sorte que, bien loin d’être des événements ponctuels, les catastrophes sont la cristallisation du désastre quotidien du régime capitaliste.
Or, c’est cette consubstantialité entre conditions et événements désastreux qui explique, bien plus qu’une supposée nature humaine, les formes de solidarité qui se manifestent lors des catastrophes : « il faut comprendre les communautés du désastre, non seulement comme des réactions spontanées à des désastres extraordinaires, mais plutôt comme l’arrivée sur le devant de la scène de luttes quotidiennes pour la survie et de pratiques souterraines d’entraide. Leurs expériences dans l’organisation contre les désastres ordinaires du capitalisme ont laissé les habitants bien équipés pour affronter un désastre extraordinaire »[17]. C’est précisément dans ces pratiques que trouve sa source le communisme de tous les jours dont parle Graeber, comme une sorte de tactique dans une lutte de basse intensité contre les effets les plus néfastes du capitalisme.
Out of the Woods attire alors notre attention vers la possibilité de transformer cette tactique en une stratégie, conduisant les « communautés du désastre » vers un « communisme du désastre », à travers une « communisation du désastre ». Il s’agit en d’autres termes de dépasser le « feel-good communism » mis en avant par les études sus-mentionnées, qui réchauffe certes le cœur mais ne réarme pas les luttes.
Comme exemple de ce dépassement, Out of the Woods estime que les communautés du désastre démontrent qu’il existe une autre forme de richesse par rapport à celle mesurée en termes de prix ou même de quantités de produits : « Dans un sens conventionnel et strictement économique il y a rareté dans ces situations, mais c’est une rareté contrecarrée par une abondance de liens sociaux. (…) Alors que souvent on considère que l’abondance matérielle est une prémisse du communisme, le communisme du désastre est fondé sur l’abondance collective des communautés du désastre. C’est une appropriation des moyens de reproduction sociale »[18]. Car c’est au final la reproduction même du prolétariat qui entre de plus en plus en conflit avec les rapports de propriété capitalistes.
Dans un autre article, Out of the Woods précise que la portée stratégique de ces communautés réside avant tout dans les capacités dont elles font preuve de détourner, reconfigurer et réarticuler les structures et les flux (la logistique) sur lesquelles s’assoit actuellement la puissance du capital : bateaux, trains et voitures, ports, voies ferrées et autoroutes, ordinateurs et algorithmes, entrepôts et magasins, entreprises et machines, ainsi que les êtres humains qui en font usage. Ces formes de transformation et de réaffectation peuvent être pensées comme des formes de « bricolage » : « Les communautés du désastre nous donnent de bonnes raisons de croire que le bricolage local et émergent peut satisfaire efficacement les besoins humains même dans les conditions les plus extrêmes. Mais le fait d’insister sur la nature des choses comme potentiellement reconfigurables – et de souligner que l’auto-organisation est suffisante pour les reconfigurer – concerne aussi la problématique plus large de la communisation du désastre », car ça indique que la question n’est pas de savoir s’il faut récupérer ou abandonner la logistique actuelle et ses infrastructures, mais « comment la mettre en pièces et réutiliser ses composantes pour d’autres buts : une satisfaction écologique des besoins humains au lieu de la valorisation sans fin du capital »[19].
Conclusion
Il faut sans doute veiller à ne pas faire des pratiques qui se révèlent dans les communautés du désastre l’énième source d’espérances sans ancrages dans le réel. Il faut surtout éviter, comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, d’idéaliser ces situations de détresse extrême – qui constituent surtout un terrain d’investissement de premier ordre pour un capitalisme toujours attentif, pour reprendre une expression de Mirowski, à ne jamais gaspiller une situation de crise sérieuse[20]. Comme nous l’avons indiqué, la fonction des travaux qui se penchent sur ces communautés est de mettre en avant une autre anthropologie, qui permet d’identifier d’autres conventions économiques que celles théorisées par l’économie dominante. Ensuite, dans leurs versions les plus radicales, ils permettent d’aller au-delà de l’approche anthropologique pour mettre en valeur les formes de communisme de tous les jours que les populations opprimées développent pour résister au désastre quotidien du capitalisme ; elles permettant également de dégager une stratégie visant la réappropriation, le démantèlement et la reconfiguration des structures et des flux du capitalisme.
C’est pourquoi, pour revenir à notre point de départ, cette perspective fournit quelques pistes pour transformer d’autres pratiques qui, en soi, restent prises dans les mailles de l’économie et de l’anthropologie dominante. Cette perspective permet par exemple de montrer que des pratiques comme celles qui sont classées sous la catégorie DIY, et qui sont aujourd’hui surtout répandues au sein des classes moyennes occidentales dites conscientisées, pourraient entrer en résonance, voire trouver leur origine, dans des pratiques qui, sous des formes et des conditions différentes, sont éminemment populaires. C’est ce que suggère Klein lorsqu’elle clôture son ouvrage sur le capitalisme du désastre en mettant en avant la figure du bricoleur, centrale pour tous les mouvements qui cherchent à « repartir non pas de zéro, mais plutôt du chaos, des décombres qui nous entourent » : « Radicaux uniquement dans leur pragmatisme, profondément ancrés dans les lieux où ils vivent, ces hommes et ces femmes se considèrent comme d’humbles bricoleurs : ils réparent les matériaux qu’ils ont sous la main, les solidifient et les améliorent, visent l’égalité. Par-dessus tout, ils s’arment de résilience — en prévision du prochain choc »[21]. Tout laisse penser que, face à l’individualisme et même à l’élitisme qui le hante, le DIY aurait beaucoup à gagner d’un apprentissage des formes d’individualité et de rapport entre individus qui caractérisent le bricolage – quotidien ou exceptionnel – des opprimés.
Fabio Bruschi,
Coordinateur pédagogique à l’ARC asbl
- [1] Cf. Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes, Paris, Seuil, 2015 ; pour une critique, cf. J.-B. Malet, « La fin du monde n’aura pas lieu », Le monde diplomatique, août 2019.
- [2] Pour une étude intéressante des racines de ce mouvement dans la culture punk, voir Fabien Hein, Do it yourself ! Autodétermination et culture punk, Le Passager Clandestin, 2012. « La principale faiblesse de la scène punk rock tient sans doute à son incapacité à développer, quatre décennies durant, une véritable analyse théorique du système capitaliste (connaître pour agir). L’esprit DIY s’est ainsi révélé peu capable de contrebalancer la puissance d’attraction du modèle économique dominant (agir pour transformer) » (ibid., p. 154).
- [3] C’est précisément ce renversement qui distingue cette perspective de celle de la « collapsologie ». L’idée selon laquelle la catastrophe est à venir est caractéristique d’une vision très occidentalo-centrique et bourgeoiso-centrique : par exemple, pour les communautés qui ont été victimes de la colonisation, la catastrophe a déjà eu lieu, et elles ne cessent d’en subir les conséquences et d’en tirer des leçons (cf. N. Ajari, « Née du désastre. Critique de l’ethnophilosophie, pensée sociale et africanité », Interpretationes, 1/1, 2015).
- [4] Point de vue souvent ignoré à la fois par le technocratisme qui caractérise la perspective de la collapsologie et par des pratiques comme le « DIY » qui restent l’apanage des classes moyennes dites conscientisées.
- [5] Les critiques de ce couplage d’économie et anthropologie sont désormais nombreuses. Bourdieu affirme par exemple que « l’homo economicus tel que le conçoit (de manière tacite ou explicite) l’orthodoxie économique est une sorte de monstre anthropologique : ce praticien à tête de théoricien incarne la forme par excellence de la scholastic fallacy, erreur intellectualiste ou intellectualocentrique, très commune dans les sciences sociales (…), par laquelle le savant place dans la tête des agents qu’il étudie, ménagères ou ménages, entreprises ou entrepreneurs, etc., les considérations et les constructions théoriques qu’il a dû élaborer pour rendre compte de leur pratiques » (P. Bourdieu, « Le champ économique », Actes de la recherche en sciences sociales, 119, 1997, pp. 61-62). Il faut par ailleurs noter que ce présupposé anthropologique est aujourd’hui plus questionné qu’auparavant par les économistes eux-mêmes, comme le révèlent les théories de la rationalité limitée, l’économie comportementale, l’économie expérimentale, les théories du « market design ». Le but de ces théories est toutefois généralement de proposer des dispositifs pour pallier à ce malheureux manque de rationalité des acteurs. De sorte qu’à la limite il n’est plus nécessaire que les acteurs agissent de manière rationnelle ; on les fera agir de manière rationnelle (les actions étant bien entendu toujours jugées comme rationnelle en fonction de l’idéal d’un sujet égoïste maximisant son intérêt). Cf. P. Mirowski, E. Nik-Khah, The Knowledge We Have Lost in Information. The History of Information in Modern Economics, Oxford University Press, 2017.
- [6] Fr. Hayek, Droit, législation et liberté. Une nouvelle formulation des principes libéraux de justice et d’économie politique, Paris, P.U.F., 2013, p. 126.
- [7] Ibid., p. 530.
- [8] R. Nadeau, « L’évolutionnisme économique de Friedrich Hayek », Philosophiques, 25/2, 1998, p. 265. Il faut noter que, contrairement à l’économie orthodoxe, Hayek ne suppose pas une situation d’information parfaite entre les acteurs.
- [9] R. Solnit, A Paradise Built in Hell, New York, Penguin Books, 2009, p. 3, p. 9.
- [10] Ashl. Dawson, Extreme Cities. The Perils and Promises of Urban Life in the Age of Climate Change, London-New York, Verso, 2017.
- [11] D . Graeber, « Les fondements moraux des relations économiques. Une approche maussienne », Revue du MAUSS, 2010/2, 54-56.
- [12] Pour une critique plus développée, cf. Chr. Lotz, « The Return of Abstract Universalism. A Critique of David Graeber’s Concept of Society and Communism », Radical Philosophy Review, 18/2, 2015.
- [13] Cf. H. Kempf, « Sauver les riches de la catastrophe écologique. Le devenir autoritaire du capitalisme contemporain », Analyse de l’ARC, n° 8, 2019, URL : https://arc-culture.be/blog/publications/sauver-les-riches-de-la-catastrophe-ecologique-le-devenir-autoritaire-du-capitalisme-contemporain/.
- [14] L’expression « out of the woods » (littéralement « hors des bois ») signifie en anglais « au bout de ses peines », « tiré d’affaire », « sorti de l’auberge », « sorti de l’ornière ».
- [15] Out of the Woods, « The Uses of Disaster », Commune, 2008 : https://communemag.com/the-uses-of-disaster/
- [16] Cf. N. Klein, La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre, Toronto, Léméac/Actes Sud, 2008.
- [17] Out of the Woods, « The Uses of Disaster », op. cit.
- [18] Ibid.
- [19] Out of the Woods, « Disaster Communism », libcom.org, https://libcom.org/blog/disaster-communism-part-1-disaster-communities-08052014
- [20] P. Mirowski, Never Let a Serious Crisis Go to Waste : How Neoliberalism Survived the Financial Meltdown, London, Verso, 2013.
- [21] N. Klein, La stratégie du choc, op. cit., p. 407.