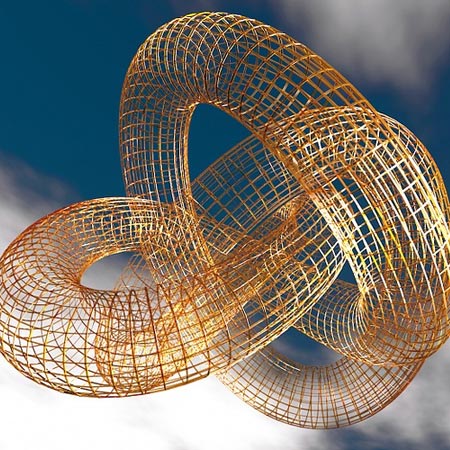En 1954, la Belgique comptait 171.600 personnes inscrites au chômage, sur une population de 8.820.161 habitants.[1]
En 2014, sur une population de 11.230.000 habitants, notre pays comptait 425.390 chômeurs.[2]
Une époque n’est a priori pas l’autre. En effet, en 1954, on est dans l’après-guerre, tout est à reconstruire et il y a du travail. Entre 1954 et 2014, on a traversé plusieurs crises d’ampleur mondiale, la technologie a évolué et avec elle l’industrie, laissant sur le bord du chemin des ouvriers sous-qualifiés et la société, restée dans le même paradigme (un emploi à temps plein = 38 heures de travail par semaine), semble totalement dépassée par son temps, dans l’impossibilité de fournir de l’emploi pour tous et demeurant pourtant obstinément braquée sur cet objectif.
Aujourd’hui, notre pays compte 388.451 chômeurs complets indemnisés[3] pour une population de 11.267.910 habitants[4].
Il est donc correct de dire que le nombre de chômeurs complets indemnisés est en baisse ces dernières années. Ce qui l’est moins, c’est de se contenter de comparer deux nombres toutes choses égales par ailleurs alors que rien n’établit qu’elles le soient effectivement. Entre 2014 et 2016, ce que les militants de terrain (citoyens engagés, syndicats…) et même les dirigeants d’Actiris et du Forem[5]> ont appelé « mesures anti-chômeurs » a fait son œuvre et nombreuses sont les personnes, en particulier des jeunes, à avoir tout simplement perdu leur droit aux allocations. Quant à l’emploi lui-même, nous verrons que l’acception de la notion a, elle aussi, évolué.
Et si l’on considère que le gouvernement annonce avoir créé pas moins de 105.000 emplois sur cette même période[6], le moins que l’on puisse dire est que les chiffres laissent songeur : pourquoi cette stagnation ? Si l’on en croit les politiques, la faute en incombe aux demandeurs d’emploi qui manquent de détermination pour trouver un travail. Pourquoi n’avance-t-on pas une autre cause? Pourquoi une société qui peine à créer de l’emploi s’est-elle mise à « punir » ceux qui n’en trouvent pas ?
Pour répondre à cette question, il faut s’en poser d’autres : de quels emplois parle-t-on aujourd’hui? Qui sont les « punis » du chômage ? Quel est le glissement qui s’est opéré entre l’État-providence et l’État social actif ? Pourquoi le citoyen sans-emploi est-il passé du statut de personne à protéger à celui de coupable ? La responsabilité a-t-elle changé de main ou est-ce autre chose qui se joue ?
Avant les années 80 – Le chômage résiduel
Durant la trentaine d’années de l’après-guerre (40-45), baptisées par l’économiste Jean Fourastié « les Trente Glorieuses »[7], s’est installé dans divers pays développés, dont le nôtre, ce qu’on appelle l’État-providence, ou État social ou encore État social passif.
Mais c’est bien avant qu’en est né le principe qui relève d’une logique de redistribution, opérée dans un premier temps (dès la fin du 19ème siècle) par des organisations ouvrières soucieuses d’organiser la protection sociale des travailleurs via des mutualisations. Il faudra attendre l’après-Seconde Guerre mondiale pour que l’État prenne en charge cette solidarité à travers les dispositifs de la sécurité sociale. Le principe est de couvrir les risques inhérents à l’existence : maladies, accidents de travail, chômage, retraite…
Serge Paugam[7] rappelle que durant les Trente Glorieuses, le chômage est résiduel : il y a de l’emploi pour tous et sont au chômage, principalement les personnes qui se trouvent entre deux emplois, d’une fin de contrat au début d’un autre. La croissance économique est forte, les inégalités sont en diminution. La pauvreté touche essentiellement les couples de retraités : 27% d’entre eux sont sous le seuil de pauvreté. À l’époque, quand on parle d’emploi, on envisage un contrat de travail exercé à temps plein et généralement à durée indéterminée. Dans les faits et la plupart des cas, une carrière dure une vie et se déroule chez le même employeur.
A partir des années 80 – Le chômage structurel de longue durée
Le chômage explose à partir du milieu des années 1970 après le premier choc pétrolier de 1973. Les économistes attribuent cette augmentation à la fois au changement de conjoncture économique (« chômage conjoncturel ») et à une inadéquation du marché du travail (« chômage structurel » de longue durée) qui ne s’est pas assez rapidement adapté aux changements économiques liés à la globalisation, aux flux démographiques et aux évolutions industrielles. A partir de ce moment-là, la réduction du chômage devient une priorité politique et l’idée qu’il faut rendre le marché du travail plus flexible se généralise : on invoque non seulement les rigidités légales mais aussi le manque de formation des chercheurs d’emploi et leur « passivité ».[8]
Dans les années 70, la pauvreté touche principalement les couples de retraités. Cette pauvreté est identifiable – il s’agit de couples ayant travaillé avant la Seconde Guerre mondiale et donc avant la mise en place de la sécurité sociale et du système généralisé de retraite – et ce même système allait permettre de la combattre. Ce à quoi on assiste dans les années 80 est très différent : une nouvelle pauvreté apparaît, liée au chômage de longue durée, et elle touche principalement les moins qualifiés. Cette population plus jeune, issue de familles jusque-là exemptes de ces problématiques, est touchée au cœur même de sa vie en société : pas d’emploi, ou un emploi pas stable, des problèmes de logement, d’isolement social, de santé. Sa pauvreté est en cela qualifiée de « cumulative » par Paugam[9]. Elle correspond à ce qu’il a appelé un processus de « disqualification sociale » et est beaucoup plus angoissante pour de nombreuses personnes, car moins identifiable et donc moins facilement combattue.
Les punis du chômage
En 2004, le gouvernement fédéral belge introduisait une nouvelle notion, celle de l’ « activation du comportement de recherche d’emploi ». Les mots ne sont pas innocents et si dans les chiffres, on l’a vu, la notion n’a pas changé grand-chose, le langage, lui, semble avoir été performatif[10] : on peut, sans craindre de verser dans la caricature, observer que dans le discours, de victime (de causes structurelles), « le chômeur » est devenu responsable de sa situation.
De ce point de vue, le chômeur devient un assisté, il subit passivement son sort et il profite allègrement des largesses d’un État que d’aucuns appellent encore « Providence » alors qu’on en est loin : désormais, ce que la société proposait autrefois comme palliatif de ce qu’elle considérait comme ses propres lacunes, dérives et incuries doit être mérité. La responsabilité n’est plus collective, elle est individuelle. La charge de la preuve n’incombe plus à l’ONEM, mais au chômeur lui-même.
Les positions d’un certain nombre d’auteurs corroborent cette appréhension du phénomène. Nicolas Duvoux[11], notamment, relève qu’à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les systèmes d’indemnisation du chômage sont bâtis sur l’idée que ce dernier résulte essentiellement d’un risque macro-économique qui dépasse largement la responsabilité des individus, alors qu’aujourd’hui ce sont les aspects proprement micro-économiques du chômage, liés par exemple à un système d’incitations inadapté ou incohérent qui retiennent l’attention.
Pire encore, ajoute Robert Castel[12], « le traitement dénonciateur et stigmatisant de la question sociale prend la partie pour le tout et inverse les effets et les causes pour constituer des boucs émissaires qui, s’ils ne sont pas tous innocents, ne sont pas pour autant responsables de tout. » Yves Martens[13] confirme : « d’un droit à des allocations, on passe à un droit à l’intégration sociale, qui doit se réaliser en priorité par le travail. D’une responsabilité collective, on passe à une responsabilité individuelle. On culpabilise le sans-emploi. Cette logique est perverse dès le départ et administrativement lourde. Elle s’avère inefficace en termes de recherche effective, contre-productive et génératrice de violence et de souffrance. Et on le savait dès le départ. Pourtant, même si on a des preuves du contraire, on continue à affirmer que l’activation est le fer de lance des politiques de l’emploi ».
Et si le problème était ailleurs ?
Relevons que, paradoxalement, les mêmes pouvoirs publics qui rejettent la faute sur les chômeurs ne peuvent ignorer les limites de cette simplification en pratique. Tous les chiffres montrent que le nombre de sans-emploi (disponibles sur le marché du travail) dépasse largement celui des emplois disponibles[14]. Le discours politique sur le sujet se contredit lui-même en permanence, soulignant ici la responsabilité du sans-emploi dans cette situation et annonçant là, sans cesse depuis des années son intention de « créer de l’emploi » pour « résorber le chômage ». Alors, pourquoi créer de l’emploi si les seuls responsables de leur chômage sont les chômeurs eux-mêmes ?
A chaque « flux » migratoire, le discours politique évoque (à tort, mais c’est un autre sujet) un marché du travail trop fragile et trop lacunaire pour contenir davantage de personnes. De plus en plus de personnes sont occupées à temps partiel, situation qu’ils n’ont pas forcément voulue, qui ne leur suffit pas toujours, dans laquelle ils ne sont pas de leur plein gré, mais qu’ils ont été forcés d’accepter (sous peine de sanctions). Quant aux employeurs, la loi Peeters a prévu de leur simplifier grandement la tâche administrativement[15]. Est-ce que ce saucissonage des emplois n’est pas le symptôme visible d’un dysfonctionnement plus profond du marché du travail et d’un besoin de repenser la notion de travail dans une optique à plus long terme ?
Force est de constater que désormais, dans un marché du travail détricoté, ce que le discours ambiant appelle « emploi » (ou… « jobs jobs jobs »[16]) s’apparente en grande partie à des contrats à durée déterminée, à temps partiel[17], avec des rémunérations bien souvent insuffisantes pour vivre et dans des métiers qu’on n’a pas forcément choisis. On soulignera à cet égard les récentes déclarations de Pierre-Yves Jeholet, Ministre wallon de l’Économie, de l’Emploi et de la Formation, concernant, notamment, les emplois en pénurie et l’obligation de les accepter. Ce qui nous offre l’occasion de noter un autre paradoxe : dans un système d’ « aide à l’emploi » tel que les contrats Actiris, par exemple, il est impossible d’obtenir un emploi en-dessous de son niveau d’études, qu’on convienne ou non pour le poste, parce que l’autorité subsidiante fixe elle-même des limites à ne pas dépasser.
Ce que l’on appelle « plein-emploi » en affirmant vouloir l’atteindre n’a donc plus grand-chose à voir avec la réalité des Trente Glorieuses : aujourd’hui, force est de constater que si des postes sont créés, ils sont loin de promettre une longue carrière auprès d’un même employeur. Les emplois créés par l’État sont majoritairement précaires et les travailleurs doivent être flexibles et adaptés à cette réalité sous peine d’être sanctionnés[18]. Peut-on réellement penser que la faute principale incombe aux demandeurs d’emploi ou doit-on se demander pourquoi c’est ce message qu’on nous envoie le plus vivement ?
CONCLUSION – La face cachée de l’activation
Peut-on imaginer que notre société incrimine volontairement les victimes des choix socio-économiques qu’elle a posés ? Certaines personnes pensent que l’État social actif aide avant tout à réaliser les exigences du capitalisme en maintenant une certaine cohésion sociale. Comme le souligne Serge Paugam, « l’assistance est un facteur d’équilibre et de cohésion de la société. Elle est un moyen pour elle d’assurer son autoprotection et son autodéfense »[19].
Serge Paugam connu pour avoir élaboré le concept de « disqualification sociale » note que pour fonctionner la société a tendance à identifier des rôles distincts en son sein. Ainsi le rôle du chômeur, quand il est pointé comme responsable des dysfonctionnements du marché de l’emploi, reproduit et entretient un certain schéma social où les privilèges sont l’apanage des uns et où les dysfonctionnements concernent les autres. En d’autres mots, le chômeur serait un bouc-émissaire[20] qui aide à maintenir un certain modèle de société en punissant ceux qui contreviennent à ses visées. Et ce rôle-là n’a pas besoin d’être financé : on est, cyniquement, dans le bénévolat pur…
Si le point de vue de Paugam est avéré, la tactique de persuasion semble opérer. Pour preuve, dans les discours des syndicats et des partis politiques dits « de gauche », on observe désormais un glissement qui nous semble significatif : il ne s’agit plus d’exiger (davantage de droits), mais de « limiter les dégâts » et d’affirmer que « sans nous, ce serait pire ». Souvenons-nous aussi que le durcissement des mesures sanctionnatrices des chômeurs fut initié par un gouvernement dirigé par le parti socialiste et défendu dans les médias à coups de « c’est pire ailleurs »[21].
Notre analyse invite à observer la réalité du point de vue des demandeurs d’emploi. Derrière l’évolution des chiffres du chômage se cache un changement radical de politique et de pensée. L’activation des chômeurs est une réalité aujourd’hui. De fait, ces derniers sont très activement à la recherche, si pas d’un emploi, de preuves qu’ils en cherchent un. Mais quand ils en trouvent un, de gré ou de force, il n’améliore bien souvent pas leur qualité de vie (parfois même au contraire !). De nombreuses voix se sont élevées contre l’hypocrisie et les logiques de double contrainte actives dans cette réalité. Prouver qu’on cherche un emploi dans une société qui n’en propose pas suffisamment a quelque chose d’absurde et même de violent[22]. Les discours qui stigmatisent les chercheurs d’emploi, nous amènent à penser qu’ils portent la responsabilité des problèmes économiques qui nous impactent tous et, de cette manière, à nous faire oublier qu’ils sont également eux-mêmes des victimes de ces problèmes.
Certaines voix s’élèvent pour nous extraire de cette logique, afin de nous éveiller à d’autres origines de nos problèmes et exiger que l’État social s’active également à reconnaître celles-ci et qu’au lieu de poursuivre les chômeurs, il requestionne les fondamentaux de l’économie. Il ne s’agit bien entendu pas de prendre chaque individu par la main, de le porter à bout de bras ou de le dégager de toute responsabilité. Il s’agit de faire preuve d’honnêteté intellectuelle et de reconnaître qu’en matière d’emploi, et sans remettre en cause le paradigme actuel (un emploi = 38h de travail par semaine), ce choix de société est un échec pour qui prétend le faire dans l’intérêt du plus grand nombre. Il s’agit de ne pas inverser les rôles.
Anne LÔWENTHAL
Chargée de Communication à l’ARC
- [1] http://www.onem.be/sites/default/files/assets/publications/Etudes/2016/20160118_Etude_FR.pdf
- [2] http://www.onem.be/fr/chiffres-federaux-des-chomeurs-indemnises-decembre-2014
- [3] On verra plus bas que cette nuance n’est pas négligeable.
- [4] http://www.onem.be/fr/les-chiffres-federaux-des-chomeurs-indemnises-fevrier-2017-0
- [5] https://www.rtbf.be/info/belgique/dossier/gouvernement-michel/detail_chomage-des-milliers-de-jeunes-prives-d-allocations-des-le-1er-septembre?id=9062768
- [6] http://www.levif.be/actualite/belgique/le-mr-promet-de-nouvelles-baisses-d-impots-en-2018-et-2019/article-normal-654489.html . On verra plus bas ce qu’il en est de ces emplois.
- [7] « La régulation des pauvres » Serge Paugam et Nicolas Duvoux, Puf, collection quadrige, p.34
- [8] http://ses.webclass.fr/notion/chomage-structurel
- [9] Serge Paugam et Nicolas Duvoux, La régulation des pauvres, PUF (Coll. « Quadrige »), p.35
- [10] Notons que deux ans auparavant, le minimex – minimum de moyens d’existence – était remplacé par le RIS – droit à l’intégration sociale. (1) Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002
- [11] Duvoux Nicolas avec Serge Paugam, La régulation des pauvres, Op.Cit.
- [12] Ibidem, P.3
- [13] Collectif Solidarité contre l’Exclusion – Entretien réalisé par l’auteure au 30 novembre 2016
- [14] https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_en-2014-pour-460-000-chomeurs-il-y-avait-83-000-emplois-vacants?id=8955515
- [15] https://www.groups.be/1_81700.htm
- [16] Charles Michel, dans son discours annuel de politique générale au 10 octobre 2017
- [17] À cet égard, on notera que la récente loi Peeters sur le travail permet désormais aux sociétés d’intérim d’engager les intérimaires à temps partiel tout en leur maintenant l’obligation de ne leur fournir que des missions de courte durée. http://trends.levif.be/economie/lawyerz/loi-peeters-sur-le-travail-10-mesures-qui-vous-concernent/article-analyse-622415.html
- [18] https://www.lecho.be/dossier/budgetfederal/Charles-Michel-cree-t-il-vraiment-de-bons-jobs/9941664
- [19] « La régulation des pauvres » Serge Paugam et Nicolas Duvoux, Puf, collection quadrige, p.20
- [20] https://www.carhop.be/images/Stigmatisation_chomeurs_chomeuses_C.MACHIELS_2013.pdf
- [21] http://www.dhnet.be/actu/belgique/di-rupo-c-est-pire-ailleurs-51b768fae4b0de6db97bc259
- [22] http://www.actuchomage.org/2012051020732/L-actualite-du-site/chomage-et-depression-une-souffrance-ignoree.html