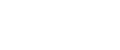Sans évacuer la nécessité de penser les conditions matérielles d’une lutte sociale et ses retombées concrètes, cette analyse insiste sur leur irréductibilité aux motifs, aux trajectoires, aux succès et aux échecs auxquels une quelconque anticipation stratégique voudrait les prédestiner. Car c’est peut-être bien de cette part non-programmatique des luttes, rendue à la fois proéminente et nécessaire par et dans le contexte néolibéral, que surgissent les puissances effectives et singulières des mouvements sociaux qui font notre actualité.
Introduction
Depuis près de 10 ans, dans des proportions mondiales, et malgré les conditions sanitaires actuelles, les mouvements insurrectionnels ne cessent de se multiplier à travers des stratégies, des formes et des ampleurs souvent inédites. Pourtant, ils affrontent, dans le même temps, l’extraordinaire brutalité des répressions qui leur sont opposées et les logiques de domination néolibérales qui, depuis quarante ans, n’ont eu de cesse de vider les leviers classiques de mobilisation, tels que le syndicalisme, de leur efficience.
Autant dire que ces mouvements se heurtent à des difficultés majeures, notamment parce qu’il n’est plus question de se rendre à une démarche émancipatoire qui consisterait à obtenir de simples aménagements de système : la résolution des problèmes qui se posent n’est plus pensée au sein des logiques qui les engendrent, mais précisément selon un désir assumé de faire céder définitivement ces dernières.
La question se pose alors de savoir si notre temps est en train de creuser le tombeau des luttes qui le traversent, ou si nous pouvons tirer de leurs dynamiques propres des outils stratégiques et théoriques permettant de penser leur persistance. Notre réponse, qui n’a pas d’autre vocation que d’ouvrir certaines pistes réflexives, reposera sur la thèse suivante : nos chances de voir tenir les luttes sociales repose sur notre capacité à saisir ce que leurs devenirs mêmes rendent possible. À ce titre, nous poserons qu’il est nécessaire de se départir d’une logique qui, les enjoignant à anticiper leurs conditions de possibilité, leurs trajectoires programmatiques et les garanties de leur succès, risquent en réalité d’en endiguer l’émergence et le déploiement effectif.
Capitalisme néolibéral et syndicalisme : un état des lieux des rapports de force sociaux
Le point d’entrée le plus évident est probablement celui que chacun peut, du moins lorsqu’il y est confronté, expérimenter très concrètement : comment se rendre capable d’agir là où tout est fait pour nous décourager ? Où que l’on se tourne, le capitalisme néolibéral et les appareils d’Etat qui lui sont solidaires ont largement quadrillé l’espace social. Cela s’explique notamment par le fait que ce quadrillage est rendu possible par une forme d’exploitation qui vise de plus en plus la vie elle-même : notre temps, nos aspirations, nos capacités, notre santé, nos relations etc., sont assimilées dans les logiques productives du capitalisme. Ainsi, de telles logiques passent aussi bien par nous-mêmes, puisque l’étendue de notre autonomie et de nos satisfactions est garantie par notre participation : « Les grandes puissances industrielles et financières produisent ainsi non seulement des marchandises, mais aussi des subjectivités […] – ce qui revient à dire qu’elles produisent des producteurs »[1]. De ce point de vue, nous pourrions encore préciser notre question préliminaire : comment se rendre capable de quoi que ce soit quand de telles coordonnées systémiques semblent inféoder nos puissances d’agir et de penser à leur horizon de possibilité, c’est-à-dire quand les possibilités extérieures deviennent nos possibilités intérieures ? Que peut-il advenir de celles et ceux qui tenteraient de s’y soustraire, sinon s’exposer, ultimement, au passage d’une oppression participative à une oppression répressive ?
Si tel est le cas, et dans un contexte qui nous laisse manifestement si peu d’options, pourrait-on considérer, par exemple, le recours à une instance intermédiaire telle que le syndicat comme l’alternative la plus viable, voire notre seule chance, pour penser et mener des luttes sociales ? Parce qu’une telle instance continue à agréger, au moins symboliquement, le champ salarial autour d’elle, nous ne pouvons effectivement faire l’impasse sur la place qu’elle occupe au sein des antagonismes sociaux. Mais que cette place soit précisément celle d’un intermédiaire doit attirer notre attention, dans la mesure où on peut douter qu’elle lui laisse la marge de manœuvre nécessaire à tenir le front des luttes. C’est, entre autres, ce que démontre Karel Yon :
La promotion du « dialogue social » (…) s’est traduite par la multiplication des instances de concertation et l’invitation faite aux syndicalistes à se transformer en « professionnels de la négociation ». (…) Outre le fait de construire une opposition mythique entre dialogue et conflit, la diffusion de la rhétorique du dialogue social a fait de ce projet de « civilisation des mœurs » professionnelles le principal cadre cognitif et normatif des relations sociales. La réforme de la représentativité syndicale est ainsi pensée du point de vue de la négociation plutôt que du droit des salariés à s’organiser[2].
En d’autres termes, parce que le propre du néolibéralisme est de neutraliser la conflictualité sociale par l’auto-disciplinarisation, le syndicalisme a été progressivement entrainé dans une mutation de son rôle historique vers une fonction réduite, au moins au niveau macrosocial, à un rôle de concertation. De ce point de vue, l’un des tours de force de l’organisation néolibérale des rapports de force sociaux tient au fait qu’il y a désormais si peu de choses à y obtenir : « Le Capital qui s’est créé une telle position […] ne voit plus l’intérêt de transacter – pour cette simple et bonne raison que le pouvoir qu’il a conquis l’autorise à ne plus le faire »[3].
Ainsi, face à ce constat, comment ne pas conclure à un bilan en demi-teinte, puisque même la contestation se ritualise essentiellement autour des grandes journées de mobilisation, c’est-à-dire autour de choix tactiques limités à l’ordre symbolique, sans que le rapport de force ne se poursuive à un degré plus offensif ? Comment pourrait-il, d’ailleurs, en être autrement, dès lors que toute action plus radicale menée, notamment, par les bases syndicales (blocages, occupations…) ou toute perspective idéologique considérée comme externe au champ des relations professionnelles (lutte contre le racisme et le sexisme systémiques, remise en question des rapports de propriété, etc.) sont perçues soit comme incontrôlables, soit comme marginales ? Comment, dès lors, la rationalité dominante au sein des actions et discours syndicaux pourrait-elle s’adapter aux nouveaux enjeux insurrectionnels qui sont en train d’émerger ?
Le syndicalisme risque ainsi de manquer ce qui pourrait bien constituer une opportunité non négligeable : celle de pouvoir réaffirmer sa part proprement révolutionnaire. Si cette acception du syndicalisme renvoie nécessairement à son rôle dans le développement du capitalisme industriel à la fin du XIXème siècle, elle nous semble toutefois appropriée aux enjeux et pratiques qu’il lui serait possible d’investir aujourd’hui : il a certainement su démontrer sa puissance lorsqu’il se positionnait ouvertement en rupture avec le capitalisme, à travers l’auto-organisation des travailleurs, l’autonomie ouvrière, le recours à l’action directe et aux grèves générales à vocation expropriatrice[4]. Alors, peut-être, pourrait-il le faire d’autant plus en se mesurant aux nouveaux antagonismes et options de luttes qui parcourent notre époque et dont il s’agira, dans la suite de cet article, d’évoquer certains aspects. En cela, il nous semble que la « crise » du compromis dans laquelle le syndicalisme se trouve pris s’avère, paradoxalement, être une chance potentielle.
En effet, dans un contexte où la multiplication des luttes semble prendre largement le relai des tentatives de négociation, il n’est pas interdit de penser que la légitimation de la domination par le consensus a atteint ses propres limites. Mais qu’elle soit suppléée par le recours à la coercition dans des proportions de plus en plus effroyables témoigne, paradoxalement, des failles dans l’ordre politique que nous connaissons : « C’est lorsque la répression semble la plus dissuasive qu’elle est objectivement la plus incitative : en tant qu’elle signale la détérioration de la viabilité politique du régime. Donc sa vulnérabilité […] qui, en tant que telle, est le signe d’une possibilité »[5]. Voilà ce dont il s’agit de se saisir : une possibilité, mais aussi la question impérieuse qu’elle emporte nécessairement avec elle. Celle de savoir ce qui l’investira et les formes que cet investissement pourrait prendre, car la poursuite d’une « fascisation »[6] de la société, qui montre déjà des signes particulièrement tangibles, est loin d’être improbable.
Une telle question nous paraît d’autant plus centrale qu’elle se pose dans un contexte où les mouvements insurrectionnels eux-mêmes expriment de plus en plus, en particulier depuis cette dernière décennie, l’impossibilité du monde actuel, ainsi que celle de passer par les espaces de tractation institutionnels pour atteindre les victoires sociales auxquelles ils aspirent. Ils le font, d’ailleurs, avec une résolution d’autant plus exceptionnelle que le minimum de risque auquel chacun s’expose en entrant en lutte n’est plus un secret : « Jamais, nulle-part, la bourgeoisie n’a rendu les clés de son propre et gracieux mouvement. Pourquoi le ferait-elle d’ailleurs ? Pourquoi laisserait-elle faire la destruction de la société capitaliste, puisque la société capitaliste est pour elle »[7]. On pourrait alors se demander comment des répressions visiblement toujours plus brutales et des perspectives de succès si minces n’ont pas réussi à entamer définitivement l’émergence, voire la persistance des mouvements sociaux qui nous sont contemporains[8].
Faire droit à ce qui est en train de devenir possible : une lecture non-programmatique des mouvements sociaux
C’est donc à ce qui, malgré tout, émerge et persiste que nous souhaiterions accorder notre attention, notamment parce que nous y décelons un rappel essentiel de ce qui fait une dynamique proprement révolutionnaire, donc de ce dont il nous faut prendre la mesure : le fait qu’entrer en lutte signifie se donner la capacité de dire l’impossibilité du monde actuel, mais aussi les ruptures que l’on est prêt à y introduire ; qu’on entre dans une mutation révolutionnaire parce qu’on ne peut plus faire autrement, car il s’agit de cet instant où notre rapport aux milieux dans lesquels nous pensons, percevons, agissons, éprouvons s’est rompu, parce qu’il est devenu insoutenable ; qu’aucune révolution n’attend, pour s’engager, les conditions favorables ou des permissions circonscrites dans un circuit d’options politiques présupposées ou prescrites.
C’est sur cet aspect absolument décisif de la pensée et de la pratique insurrectionnelles que nous voudrions alors insister : plus le capitalisme néolibéral quadrille l’espace social, conditionne le syndicalisme et se permet de ne plus rien négocier, plus les mouvements sociaux expriment ce trait constitutif de toute dynamique insurrectionnelle : l’impossibilité d’anticiper programmatiquement leur propre devenir. En effet, celles et ceux qui entrent en lutte savent bien que rien n’y est jamais garanti : ce que tout mouvement imprime dans un état de choses excède toujours les noms et les figures, les réussites et les échecs, l’avenir, enfin, auquel on voudrait le prédestiner. Ceci est d’autant plus vrai dans un espace où, comme nous l’avons vu, les possibilités extérieures deviennent des possibilités intérieures, où aucun programme qui ne corresponde à l’horizon des logiques productives du capitalisme n’est possible – à moins qu’il ne souhaite faire face à la répression.
À titre d’exemple, nous pourrions évoquer, très brièvement, l’expérience révolutionnaire tunisienne qui a débuté le 17 décembre 2010. En effet, qui aurait pu, même parmi ses acteurs, s’assurer qu’une telle mobilisation, aussi puissante soit-elle, puisse parvenir à la fuite précipitée du président Ben Ali, alors en fonction, en Arabie Saoudite ? Comment penser un instant que ce cri général – « Ben Ali, dégage ! » –, ait pu émerger comme une sorte d’anticipation de la promesse d’une pacification électorale subséquente, donc comme le premier jalon d’un simple retour à l’ordre ? Preuve en est que les mobilisations n’ont pas décéléré par la suite et se sont, au contraire, étendues, organisées, renforcées des mois durant. Bien sûr, elles auront fait face à des divergences intestines liées à la diversité de leurs acteurs, à des vagues de répression terribles et à la difficulté de faire céder les institutions et les mécanismes du système politique porté précédemment par Ben Ali. Mais ce que nous tenons ici pour essentiel est que ce qui pousse un peuple à entrer en lutte et ce qui confère à cette dernière sa part de succès ne saurait être réduit à une perspective strictement programmatique.
Pour autant, le succès d’une révolution n’est évidemment jamais étranger aux conditions matérielles qui permettraient d’offrir à ses potentiels une concrétisation (stratégique ou, ultimement, institutionnelle). Mais il ne peut jamais être réduit à ces conditions, car il est tout autant inhérent aux luttes sociales en tant qu’elles sont en train de se faire, et ce même si nous n’en connaissions pas encore l’issue.
C’est précisément ce dont témoigne ce fragment crucial de la pensée de Gilles Deleuze : « La question de l’avenir de la révolution est une mauvaise question parce que, tant qu’on la pose, il y aura autant de gens qui ne deviennent pas révolutionnaires »[9]. Loin de promouvoir un spontanéisme naïf, cette approche des dynamiques insurrectionnelles nous permet d’envisager une réponse possible à notre question de départ : comment se rendre capable d’agir ? Comment se donner les moyens d’investir cette « possibilité » ouverte par la généralisation de la coercition et qui s’exprime, désormais, dans l’actualité des antagonismes sociaux ? Il n’y a pas lieu de chercher dans cette « possibilité » l’origine d’une prise de conscience collective qui permettrait à un groupe social de se constituer tendanciellement en sujet de l’émancipation. Pas plus, d’ailleurs, qu’il n’y a lieu d’en déduire définitivement les motifs et les conséquences d’une révolution. Les « gens » ne deviendront pas « révolutionnaires » tant que la pensée de gauche se posera en pôle programmatique d’authentification et de disqualification des luttes ; tant qu’elle concevra cette « possibilité » ouverte comme une donnée préexistante qu’il s’agirait de réaliser selon des lignes stratégiques prédéterminées. Car si ce sont bien les conditions historiques qui définissent l’actualité des rapports sociaux, se rendre capable d’agir signifie toujours rompre avec ces conditions et ces rapports pour « trouver les nouveaux rapports qui nous expriment »[10].
Or, comment ces nouveaux rapports pourraient-ils s’élaborer ailleurs que dans ce qui est en train d’advenir à travers un mouvement insurrectionnel, c’est-à-dire lorsque nous devenons une force politique singulière, un corps politique au sein duquel de nouvelles puissances d’agir et de penser peuvent se composer, « un peuple qui manque »[11] ? Nous n’exprimions pas autre chose lorsque nous évoquions ce moment où nous expérimentons l’insoutenabilité du monde actuel, ce moment de profonde rupture avec ce qui nous est pourtant habituel, y compris en nous-mêmes, et qui nous pousse à une sorte de refus radical en acte. Tel est, à nos yeux, ce qui fait perdre nécessairement leur puissance aux perspectives qui tendent à rabattre le concept de révolution sur un plan d’objectivité historique censé en dérouler d’avance les conditions d’existence et les trajectoires d’effectuation[12] : on ne peut anticiper le décodage de ce refus radical ; la productivité spécifique de ce décodage tient précisément au fait qu’il est un élément immanent au processus insurrectionnel, le seul qui soit en mesure de l’opérer.
C’est, par exemple, en ce sens que l’on peut considérer que le mouvement des Gilets Jaunes a su faire sortir la contestation sociale hors de ses gonds, avec une puissance qui a immédiatement suscité la défiance et l’injonction « programmatique » de la part des sphères politiques, médiatiques et même syndicales, alors même qu’il trouvait par ailleurs des alliances fortes et inattendues (comme celle du Collectif Adama Traoré). On l’observe particulièrement lorsque l’on pense à la date emblématique du 5 décembre 2019, lors de la grève organisée par les directions confédérales syndicales françaises contre la réforme des retraites. On doit évidemment à ces dernières d’avoir construit une telle date, au moins parce qu’appeler à être suivi en nombre nécessite des entités dotées d’un pouvoir symbolique et politique suffisant. Mais, d’une certaine manière, cette date qui, dans le cours ordinaire de la marche contestataire, leur appartiendrait ne leur a plus appartenu en totalité. Des individus se sont emparés de l’événement et l’ont fait déborder du registre de la préconisation ou de la revendication, parce qu’il ne s’agit pas seulement de lutter contre la réforme des retraites, mais d’inclure cette lutte dans un refus politique bien plus vaste : lutter contre cette réforme et son monde (celui du président Macron, donc du système politique dont il se fait le garant).
Conclusion
Opter pour une telle approche revient, bien sûr, à devoir également assumer l’incertitude à laquelle s’expose toute lutte, en tant qu’elle engage toujours un ensemble de potentialités difficilement saisissables et parfois même fragiles ou ambiguës. Mais parce qu’il n’a jamais existé quoi que ce soit qui puisse être de l’ordre d’une pureté des révolutions et de leurs agents, il n’y a pas lieu de les soumettre à la sanction d’un examen préalable, selon leur correspondance à différents degrés de vertu et de fidélité dont les acteurs et trajectoires de luttes sociales devraient témoigner avant de pouvoir s’engager. C’est en cela que penser la manière dont les groupes sociaux deviennent révolutionnaires constitue un souci profondément pratique envers ce qui est effectivement en train de devenir possible, y compris les ambigüités, les tâtonnements, les trahisons et les risques qui y sont toujours immédiatement contenus.
Penser la révolution, de même que la mener, requiert bien une vigilance à l’épreuve de sa complexité, en particulier dans un contexte où tout semble particulièrement périlleux. Mais c’est aussi, et surtout, son irréductibilité aux logiques programmatiques qui doit susciter notre attention : on ne devient pas révolutionnaire par le prisme d’une rationalité objective délibérant à l’avance des conditions, trajectoires d’effectuation et conséquences, craintes ou espérées, de la révolution. Il s’agit là d’un des points les plus importants de notre article : remplacer la recherche et l’arbitrage anticipé des conditions, des vertus, des garanties des révolutions par l’évaluation de ce qui s’exprime et émerge à travers leurs devenirs réels.
- [1] Hardt Michael, Negri Antonio, Empire, Paris, Exils, 2000, pp.58-59.
- [2] Yon Karel, « Evolutions de l’action syndicale – Un bilan entre victoires et échecs », Revue Contretemps, n°9, 2011, p.41. À ce sujet, nous renvoyons également nos lecteurs à l’ouvrage suivant : BARNIER M. (éd.)., Revendiquer et s’organiser! Représentativité syndicale et démocratie sociale, Paris, Syllepse, 2008.
- [3] Lordon Frédéric, Figures du communisme, Paris, La fabrique, 2021, p.174.
- [4] Pour une lecture plus approfondie de l’histoire du syndicalisme révolutionnaire : Maitron Jean, Le syndicalisme révolutionnaire : Paul Delesalle, Les Éditions ouvrières, 1952 ; Gervasoni Marco, « L’invention du syndicalisme révolutionnaire en France (1903-1907) » in Mil neuf cent – Revue d’histoire intellectuelle, n°24, 2006, pp.57-71 et Monatte Pierre, Syndicalisme révolutionnaire et communisme, Paris, F. Maspero, 1968.
- [5] Lordon Frédéric, op.cit., p.214.
- [6] Ibid., p.215.
- [7] Ibid., p.181.
- [8] À ce sujet, nous renvoyons nos lecteurs au dossier « Le soulèvement est mondial » de la revue en ligne Contretemps, URL : https://www.contretemps.eu/dossier-soulevements-revolutions/.
- [9] Deleuze Gilles, Parnet Claire, Dialogues, Paris, Flammarion, 1977, éd. augmentée, 1996, p.176.
- [10] Deleuze Gilles, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p.144.
- [11] Deleuze Gilles, Critique et clinique, Paris, Minuit, 1993, p. 14.
- [12] Les formes concrètes de cette « impuissance » sont variées :chercher dans l’Histoire les grandes promesses d’une révolution en gestation suivant implacablement son tracé ; justifier l’ajournement des luttes au motif que leur temps et conditions idéales ne seraient pas encore réunis ; développer une forme de mélancolie quant aux révolutions passées dont l’idéal serait désormais indépassable ; instruire un « bon sens » revenu de toutes les « leçons de l’Histoire », suspectant systématiquement le spectre des totalitarismes dans la gageure des révolutions imminentes. C’est, entre autres, ce que nous pourrions reprocher à Antonio Negri, lorsqu’il affirme que le nouveau stade du capitalisme et les nouveaux rapports de pouvoir qui en dérivent rendent possible, voire inéluctable une révolution anticapitaliste. À ce sujet, nous conseillons la lecture de l’ouvrage de Dardot Pierre, Laval Christian, Mouhoud El-Mouhoud, Sauver Marx ?, Paris, La Découverte, 2007.