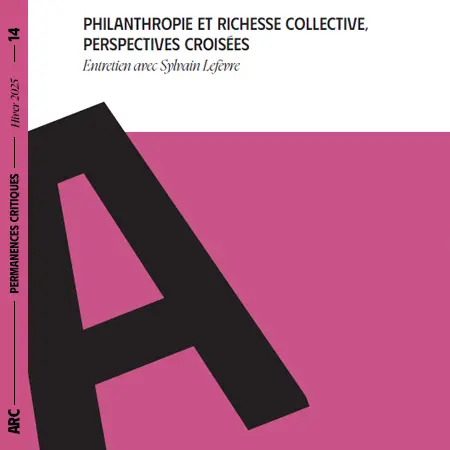Organisation des philanthropies de l’Atlantique Nord
Benoît Halet : Historiquement, le rôle de la philanthropie apparaît comme radicalement différent des deux côtés de l’Atlantique : là où les fondations semblent avoir réussi à profondément irriguer le non marchand en Amérique du Nord, en Europe l’articulation s’opérerait davantage autour d’un État financeur « fort ». Si cette lecture est juste, on dirait qu’on assiste à une atténuation progressive de ces différences fondamentales. Faut-il y voir une sorte de victoire du modèle américain ?
Sylvain Lefèvre : C’est vrai qu’on a tendance à faire un peu cette caricature mais la situation est plus nuancée, y compris dans le tableau initial. Du côté de l’Europe, il y a une grande différence selon les pays, avec des formes d’État social historiquement plus ou moins ouverts à la philanthropie. Les pays scandinaves privilégient l’impôt comme outil de redistribution et limitent fortement les contributions des donateurs privées à la philanthropie. Mais il y a des pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, où les fondations ont un rôle très important, depuis longtemps. Et si on pense la philanthropie au-delà du rôle des grandes fondations privées, les dons religieux sont très structurants dans la société civile au sein de plusieurs pays européens, de même que le rôle de la philanthropie de diaspora, au gré des migrations, des guerres et conflits. Bref, on ne peut pas affirmer que le rôle de la philanthropie était historiquement faible dans toute l’Europe, à cause d’un État au rôle plus central. Mais par-delà la diversité des formes de la philanthropie et des situations nationales, ce qui est vrai, c’est que le nombre et l’influence des grandes fondations est en croissance en Europe, avec un rôle d’autant plus important que le financement public des associations est fragilisé.
Du côté de l’Amérique du Nord, la situation est aussi à nuancer. Au Canada, selon les provinces, les configurations sont différentes et vous avez souligné à raison les parallèles entre le Québec et la Belgique. Même aux États-Unis, la dichotomie entre État et philanthropie est trompeuse. C’est plutôt un État qui a encouragé, structuré, délimité le rôle de la philanthropie de manière très forte, avec des évolutions marquées selon les périodes. Olivier Zunz[1] montre très bien, notamment au moment des deux guerres mondiales, à quel point l’État a promu ce qu’il nomme « la philanthropie de masse », avec des grandes campagnes de sollicitation, pour en faire une composante de la culture civique. Dans la seconde partie du XXe siècle, il y a aussi des liens étroits entre l’État et des fondations philanthropiques, surtout dans la politique extérieure, à l’image du déploiement du plan Marshall en Europe et plus largement du « soft power » états-unien. Mais cet alignement peut se rompre, selon les configurations historiques. Ainsi, actuellement, aux États-Unis, l’administration Trump menace directement de restreindre le pouvoir des fondations, au premier rang desquelles celles qui sont vues comme un contre-pouvoir dangereux et « woke » (Fondation Ford, Open Society de Soros). En somme, l’État et la philanthropie ne sont pas deux sphères indépendantes l’une de l’autre, elles sont dans une relation d’influence mutuelle, parfois de complémentarité, parfois d’opposition.
La philanthropie contre l’État
B. H. : Les fondations philanthropiques forment avec l’État et le secteur associatif un triangle organisationnel traversé de dynamiques complexes et mouvantes. Pourtant, la lecture la plus étendue (ou peut-être la plus rapide) de la philanthropie semble s’appuyer sur une opposition « simple » entre le public et le privé, entre l’Etat et le marché. Peu importe laquelle des deux sphères il s’agit de valoriser au détriment de l’autre, la tension se réduit à une opposition quasi manichéenne. De quoi est-ce le symptôme, selon vous ? Qu’est-ce qu’une telle partition manque d’essentiel dans la lecture du phénomène philanthropique ?
S. L. : C’est une vision qui est problématique car elle nous interdit de comprendre plusieurs processus à l’œuvre aujourd’hui. Par exemple, le fait qu’on exige des associations, pour qu’elles obtiennent du financement, de prouver leur « impact », de produire des revenus autonomes, d’être sans cesse « innovantes »… cet imaginaire de l’entrepreneuriat social est porté dans de nombreux pays par des fondations privées mais aussi par les pouvoirs publics. Les logiques néolibérales peuvent très bien être promues par des États, comme on l’a vu dans de nombreux domaines. Et à l’inverse, il y a une plus grande diversité de visions du monde au sein du monde des fondations que ce qu’on imagine souvent. On a tendance à penser que les fondations privées, qui viennent historiquement de l’accumulation de capital dans le monde marchand, vont nécessairement favoriser les processus de marchandisation du monde. En fait, c’est beaucoup plus complexe que cela. Parmi les fondations, il y a des visions politiques et des valeurs très diverses. Certaines privilégient l’utilisation d’une logique entrepreneuriale et marchande pour régler des problèmes sociaux et environnementaux (ce qu’on nomme parfois le philanthrocapitalisme), tandis que d’autres appuient des mouvements sociaux plus proches d’une logique de solidarité et de communs. Beaucoup de fondations sont surtout dans une logique de saupoudrage de dons, avec des objectifs plutôt réputationnels (financer les causes légitimes, celles liées aux enfants par exemple, et en tirer une reconnaissance de la bonté du donateur) et de statu quo social (soulager la pauvreté, appuyer les bonnes idées mais ne pas renverser la table). Bref il y a des positionnements différents. Et il faut souligner qu’une même fondation peut naitre de la volonté d’un impitoyable capitaine d’industrie, fervent apôtre du libéralisme, et devenir bien autre chose des décennies plus tard, en s’institutionnalisant. On peut penser à la Fondation Ford que j’évoquais précédemment, qui a soutenu Black Lives Mater et s’est orientée vers la défense de la justice sociale, depuis 10 ans. Avec le recul historique, on peut aussi citer, en Europe, le rôle de la Fondation Rockefeller dans la construction de systèmes de santé publique dans la première moitié du XXe siècle. Ces évolutions peuvent être liées à des changements dans la direction de la fondation, que ce soit une relève générationnelle dans la famille donatrice dans une fondation familiale ou la prise de contrôle de professionnels liés aux causes et non au donateur. Sachant que selon les pays, la marge de manœuvre juridique pour interpréter et parfois moderniser la volonté du donateur est très variable. Les revirements peuvent aussi être causés par les bascules de contexte politique : on voit actuellement des fondations aux États-Unis, effrayées par les offensives de l’administration Trump, gommer du jour au lendemain leur engagement pour les enjeux d’équité, de diversité et d’inclusion.
B. H. : J’aimerais revenir sur une séquence intéressante, qui s’est produite au Québec en 2015. Si je comprends bien ce qui s’est passé à l’époque, suite à un plan d’austérité initié par le Parti Libéral, les fondations et les organismes communautaires se sont mobilisées collectivement dans une interpellation inédite du gouvernement. Avec le recul, comment pourrait-on identifier les enjeux pour les trois grands acteurs en présence ? Est-ce que cela a redéfini le positionnement de la philanthropie dans le secteur social ?
S. L. : Oui, effectivement, dans les années 2010, le gouvernement libéral impose des mesures d’austérité budgétaire. Les réseaux d’organismes communautaires se mobilisent pour dénoncer les coupures, notamment en éducation. Ça, c’est attendu. Ce qui l’est moins, c’est que des fondations ont pris la parole conjointement dans les médias pour dénoncer les répercussions de ces mesures, en termes d’aggravation des inégalités. Elles ont ensuite créé le « Collectif des fondations contre les inégalités », qui a duré une dizaine d’années.
Ce type de mobilisation collective de fondations est rare pour plusieurs raisons. D’abord parce que jusqu’ici les fondations travaillaient plutôt chacune dans leur coin. Ensuite parce que traditionnellement les fondations parlent de pauvreté, rarement d’inégalités : parler d’inégalités, ça oblige à parler aussi des riches et de l’accumulation de leurs fortunes… qui débouchent aussi sur la création de fondations ! Enfin, c’est rare car généralement les fondations sont discrètes et s’exposent peu. Apparaitre publiquement dans les médias, ce n’est pas leur truc. Politiser leur propos en interpellant l’État, encore moins.
Alors pourquoi ont-elles fait cela ? La principale raison est que les coupures budgétaires envoyaient aux organismes communautaires le message « Les caisses de l’État sont vides, allez voir les fondations ». Sauf que les fondations savent bien qu’elles n’ont ni les moyens, ni la légitimité de remplacer l’État. Elles se sentaient un peu piégées, voire instrumentalisées. Quand vous créez une fondation, c’est pour répondre positivement à des sollicitations. Là, elles se retrouvaient à gérer la pénurie de financements, à éconduire sans arrêt des organismes qui, pour certains, étaient au bord de la rupture. Et même quand elles pouvaient financer, elles sentaient bien qu’il y avait quelque chose d’indécent, par exemple à financer des ateliers péri-scolaires sur les saines habitudes de vie, alors que les écoles sont largement sous-financées au point de ne pas pouvoir assurer les services de base, surtout pour les enfants ayant plus de difficultés.
Bref, les fondations ont tendance à se concevoir comme la cerise sur le gâteau, pour ainsi dire. Elles n’ont ni les moyens ni la légitimité pour développer des services de base ou des politiques universelles. Elles apportent un complément à l’État social, elles expérimentent des innovation sociales, couvrent des besoins spécifiques. Mais si l’État ne joue pas son rôle, alors leur intervention parait bien mince, voire dérisoire. Et donc, au Québec, face à ces coupures budgétaires dans des services essentiels, les fondations ont décidé d’interpeller le gouvernement sur ses responsabilités. Ça a été un moment très important car ça a clarifié pour les fondations engagées la division du travail entre l’État et elles. Et ce collectif a aussi fait deux choses intéressantes : d’une part, soutenir publiquement les demandes du milieu communautaire pour un meilleur financement public, d’autre part réfléchir sur l’« empreinte inégalités » des fondations, c’est-à-dire comment elles reproduisaient aussi, par le choix des financements ou par la manière dont elles fonctionnent, un certain nombre d’inégalités.
B. H. : La sphère philanthropique peut-elle être comprise aujourd’hui – un peu à l’image de la position intermédiaire de la classe moyenne, dont les alliances de classe sont déterminantes – comme le lieu où l’équilibre des rapports de forces se joue et se détermine, typiquement entre nouvelle gestion publique et approche grassroots ?
S. L. : Oui, je trouve que c’est une bonne image. Et ça s’incarne d’ailleurs dans la structure même des fondations. Je parle ici des grandes fondations, avec des équipes salariées (car il ne faut pas perdre de vue que l’essentiel des fondations, quantitativement, sont des petites structures sans salarié) et un actif de plusieurs dizaines voire centaines de millions. Dans ces grandes structures, le conseil d’administration comporte souvent des proches du donateur (notamment la famille quand c’est une fondation familiale) et des personnes choisies pour leur connaissances des enjeux traités mais surtout leur capital social, leur rayonnement et leur connexion à des milieux de décision. Des gens qui ont un bon carnet d’adresses, qui permet d’ouvrir des portes. Par exemple, dans le CA de la Fondation Mastercard, une des plus importantes au monde, on trouve des anciens dirigeants de pays, de grandes entreprises, d’universités, d’administrations centrales… Mais dans les « strates inférieures » d’une grande fondation, en première ligne, au contact des organismes financés et des milieux liés à la thématique de la fondation, vous avez des gens qui viennent souvent eux-mêmes du terrain. Et au niveau intermédiaire, vous avez des responsables qui doivent arbitrer, traduire, aligner des visions très différentes entre ces strates inférieures et supérieures. Il n’est pas rare que les professionnels « du bas », qui connaissent parfois très bien le terrain et les enjeux, aient du mal à faire passer des projets parce que ça bloque en haut, notamment quand on a au CA des gens déconnectés socialement, par exemple les héritiers d’une grande famille qui siègent encore parce que l’arrière-grand père a créé la fondation. Ou des gens qui ont réussi dans le domaine des affaires et pensent qu’ils vont réussir de la même manière dans la résolution de problèmes sociaux et environnementaux.
B. H. : Le grand leitmotiv des ultra-riches est de « slasher un peu la bureaucratie[2] ». La bureaucratie étant, dans ce type de discours, unilatéralement associée aux services publics et à l’administration d’État, il semble que l’objectif soit tout simplement de produire le socle idéologique de la délégitimation de l’Etat social. N’est-ce pas paradoxal ?
S. L. : Oui, c’est un grand classique, qui semble assez indémodable. Notamment parce que personne ne veut défendre la bureaucratie ! Ceci dit, historiquement, la relation entre les fondations et l’État social est plus complexe qu’il n’y parait. En Amérique du Nord, on pourrait dire que les grandes fondations du début du XXe siècle ont parfois contribué à la préhistoire de l’État social, par exemple en finançant les grandes enquêtes sur la pauvreté, sur la prison, sur la santé, mais aussi en professionnalisant le « travail social », devenu une discipline universitaire. Passée l’impulsion des fondateurs, ces grandes fondations se sont elles-mêmes structurées, organisées, professionnalisées, avec de véritables « ingénieurs du social » pensant la transformation de la société. En Europe, l’historien Christian Topalov[3] parle de « nébuleuse réformatrice » à propos du rôle de ces réseaux dans lesquels on retrouvait à la fin du XIXe et au début du XXe siècle à la fois des industriels, des médecins, des acteurs administratifs et politiques. Ils vont promouvoir la création de sociétés savantes sur les enjeux du travail, de la santé, de l’urbanisme, la mise en place d’expérimentation, de statistiques, etc. Bref, ils vont poser les bases de ce qui deviendra l’État providence, qui va néanmoins largement les remplacer ! Ce qui est particulier aujourd’hui, c’est qu’on a une sorte de retour en arrière, avec des élites qui peuvent tenir à la fois un discours d’engagement, de philanthropie, d’« impact social », tout en étant dans une forme d’exit, de sécessionnisme vis-à-vis de la société, notamment sur le plan des obligations fiscales ou de délégitimation du rôle de l’État social.
Mais dans le champ philanthropique, il faut bien voir qu’il y a des lignes de clivages entre fondations mais aussi des contextes nationaux différents. Je mentionnais qu’au Québec, mêmes les grandes fondations privées ont tendance collectivement à reconnaitre le rôle central de l’État social. De l’autre côté de la frontière, aux États-Unis, on est effectivement dans une configuration différente. Y compris avec certaines élites économiques libertariennes, dotées de fondations, qui soutiennent aujourd’hui l’administration Trump, pour d’un côté baisser les impôts et réduire l’action de la « main gauche de l’État », redistributive, et de l’autre agir par la main droite de l’État, répressive, contre ceux qu’ils désignent comme leurs ennemis. Il y a aussi des fondations aux États-Unis qui s’opposent à ces tendances, même si elles semblent aujourd’hui assez désemparées.
Lutte des classes ou suicide de classe ?
B. H. : Dans « Les héritiers rebelles[4] », vous évoquez le « paradoxe structurel de cette philanthropie de grandes fortunes : être la solution d’un processus dont on est à la fois le symptôme, le produit et le moteur ». À quel point l’avenir dépend-t-il de ce suicide de classe ?
S. L. : J’espère que l’avenir ne dépend pas seulement d’elles et d’eux car je parle ici d’un tout petit nombre de personnes. En effet, ce ne sont pas n’importe quels héritier·ère·s dont je parle dans cet article. Ce sont généralement des personnes qui sont à la fois « dominantes économiquement », par leur héritage économique, mais « dominées socialement ou politiquement », par exemple parce qu’ils et elles ont une couleur de peau, une orientation sexuelle, une identité de genre, bref un marqueur social qui les confrontent aussi à des discriminations. Ce sont aussi des personnes qui ont vécu des expériences personnelles qui leur ont fait découvrir la violence du monde social, le poids des inégalités, alors qu’ils et elles n’y étaient pas du tout prédestiné·e·s socialement. Et dont le réveil est brutal. Ce type de profil est assez fascinant, il y a un côté « belle histoire » ou expérimentation sociale étonnante (notamment pour les chercheurs !), à l’image de l’histoire de Marlene Engelhorn. Cette héritière de BASF, en Autriche, a été très médiatisée, à la fois par la manière dont elle a organisé le don de son héritage, sur le mode d’une sorte de convention citoyenne et par son engagement pour la justice fiscale, appelant à taxer davantage les riches, dont elle fait partie. Il est vrai aussi que ces personnes financent généralement des expérimentations et des mouvements beaucoup plus radicaux que les fondations traditionnelles. Mais encore une fois, je souligne que ces personnes sont peu nombreuses donc je préfère tempérer les attentes. Surtout que s’en remettre à la bonne volonté des plus riches, même bien intentionnés ou vertueux, reste une dynamique très peu démocratique…
B. H. : Que peuvent faire les classes populaires et/ou le secteur associatif pour sortir de cette logique de dépendance vis-à-vis de la bonne disposition des nantis ?
S. L. : La chose qui me semble la plus importante est de penser la philanthropie comme une richesse en commun. Elle l’est pour au moins trois raisons. D’abord parce qu’une richesse ne s’accumule jamais par leur seul génie d’un inventeur ou d’un industriel, il y a toujours la contribution des travailleurs, l’exploitation des territoires, des infrastructures publiques, etc. Ensuite parce que les conséquences de la philanthropie touchent tout le monde, les fondations sont engagées en éducation, en santé, en environnement, en culture, en solidarité internationale, bref c’est l’ensemble de la société qui est concernée. Enfin parce que nous contribuons toutes et tous à la philanthropie, certes par les dons des particuliers mais aussi par les privilèges fiscaux qui sont consentis collectivement (et donc auxquels nous contribuons tous) pour soutenir la philanthropie. Au Québec comme en Belgique, c’est environ la moitié du montant d’un don qui peut être soutenue par le biais de déduction fiscale. En gros, si je donne 100 euros, ça engage 50 euros d’argent public. Donc si je donne 10 millions, ça engage 5 millions d’argent public. Il y a plusieurs conditions mais le mécanisme est que l’arbitraire du don privé, qui relève d’un choix personnel, entraîne une mise à contribution collective. Sauf que la collectivité n’a rien à dire sur l’allocation de ce don. Du point de vue démocratique, c’est très problématique. Surtout quand on considère que l’essentiel des dons sont faits par les plus fortunés et que les incitations fiscales sur la philanthropie, dans de nombreux pays, favorisent les plus riches au détriment des plus modestes (qui peuvent parfois donner une somme proportionnellement plus grande de leur revenu que les plus riches, mais ne déclarent pas leur don et donc ne bénéficient pas de cet appui fiscal). Comme le souligne Rob Reich[5], la philanthropie est alors un moyen de donner plus de pouvoir aux plus riches, et donc de satisfaire à leurs propres intérêts, tout en mettant à contribution toute la collectivité, de manière non démocratique. Il propose des manières de corriger cela au niveau de l’architecture fiscale, de la conditionnalité de l’aide pour les dons. Mais plus globalement, il faut se saisir collectivement de cette richesse, de manière démocratique, pour décider ensemble de la manière dont elle peut servir au mieux à faire face aux défis de société aujourd’hui urgents. Il y a là une ligne de crête dans cette démocratisation de l’usage du capital philanthropique, entre le fait de laisser les plus riches décider de ce qu’ils font de « leur argent » et une simple reprise de cet argent par l’État via la ponction fiscale, alors que la légitimité politique des gouvernements est si fragile aujourd’hui. Bref, faire de la philanthropie un enjeu collectif et démocratique est un travail énorme, mais néanmoins urgent et nécessaire.
- [1] Zunz Olivier, La Philanthropie en Amérique. Argent privé, affaires d’État, Paris, Fayard, 2012.
- [2] Bernard Arnault, verbatim. Voir l’étude de ce numéro.
- [3] Topalov Christian(dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France, 1880–1914, Paris, Éditions de l’EHESS, coll. « Civilisations et sociétés », 1999.
- [4] Lefèvre Sylvain, « Les héritiers rebelles. La philanthropie comme ‘suicide de classe’ », Politix, n° 121, 2018, pp. 55-78.
- [5] Reich Rob. Just Giving: Why Philanthropy Is Failing Democracy and How It Can Do Better, Princeton, Princeton University Press, 2018.