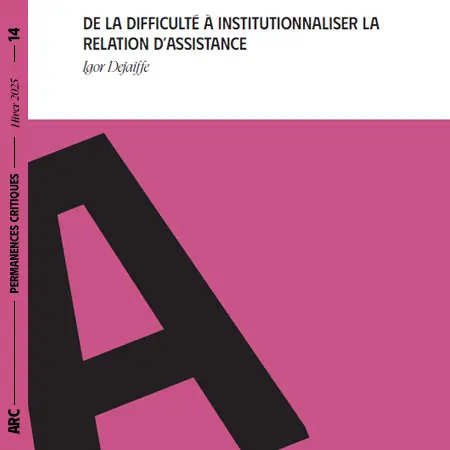« La pauvreté n’est pas un état mais un rapport social. »[1] Le miséreux rappelle aux chrétiens la figure du Christ, le mendiant se définit par l’assistance demandée, les statuts de vagabond, sans-chez-soi ou chômeur renvoient systématiquement à une norme sociale. Une analyse de la pauvreté devient ainsi automatiquement une analyse de la forme sociale de la relation d’assistance. Étendons maintenant cette observation pour proposer une définition opérante du cadre au sein duquel ces rapports se construisent : une société est un réseau d’interdépendance composé d’individus.
La société, sociale par essence donc (tous deux du latin socius signifiant compagnon, allié), se construit sur ces liens. La notion d’assistance, comprise ici comme une forme particulière d’interdépendance, apparaît alors comme une donnée fondamentale et non négociable de toute société fonctionnelle. Elle ne saurait être réduite à un projet personnel, ou à un effet secondaire de la vie en commun. En effet, je profite d’un réseau électrique que je n’ai pas construit, je dépose mes statuts dans une administration que je n’ai pas fondée, j’engage des travailleurs que je n’ai pas formés, j’utilise une monnaie dont je n’ai pas assuré la stabilité, je me déplace sur des routes que je n’ai ni tracées ni asphaltées. Ces biens et services me lient indirectement aux autres et définissent ainsi le rapport social auquel je m’identifie. Ainsi se construit mon individualité au sein de nos sociétés : une autonomie rendue possible par des dépendances multiples, des droits assurés par de nombreux devoirs.
Il faut en effet rappeler qu’une société est simultanément une affaire individuelle et collective. Le gain individuel est assuré par un fonctionnement collectif ou, exprimé autrement par Georg Simmel, « à chaque obligation correspond un droit. Chaque personne ayant une obligation possède également des droits ; il se forme ainsi un réseau de droits et d’obligations »[2], et ce réseau n’est autre que la structure même du corps social.
Le travail rhétorique de remise en question de cette donnée fondamentale du vivre ensemble commence généralement ici : redéfinir une société loin de ce qui la compose, à savoir les liens d’interdépendances qui la soutiennent, c’est-à-dire, ultimement, pousser une lecture entrepreneuriale de l’État. Je défendrai pourtant dans ce texte que ce n’est pas parce que j’énonce qu’une société est avant tout affaire de profit que je réglerai la question de l’assistance aux précaires, de la même manière que ce n’est pas parce que j’énonce que ma voiture roule maintenant à l’eau que je ferai des économies sur mes trajets. En d’autres termes, la centralité sociale de l’assistance n’est pas performativement éliminable par le discours qui l’encadre.
Définir l’assistance et comprendre la place particulière de l’aide financière
Recentrons-nous maintenant sur le type d’assistance qui nous intéresse ici. Même si toutes les interactions se construisent sur des interdépendances au sein d’une société, les formes d’assistance généralement associées à l’État social occupent une place particulière. Si toute relation d’interdépendance renvoie, par définition, à une forme de réciprocité, cela semble ne pas être le cas des relations nouées à partir de dispositifs tels que l’assurance chômage, le CPAS, l’aide au logement, ou les allocations sociales : la réciprocité de ces relations-là s’observe plus difficilement à l’échelle individuelle (je reviendrai sur ce point). De ce fait, la plus faible perception de leur importance pour tous ou, à tout le moins, pour l’intégrité de la structure générale de la société dans laquelle elles existent, a ouvert la voie à un long travail sémantique pour les faire apparaître idéologiquement comme un « coût », une « charge », une externalité dont il faut bien s’acquitter, du bout des doigts, par humanisme ou souci moral.
Pourtant, l’aide sociale n’apparaît pas avec l’État social : les fondations et autres œuvres caritatives le précèdent et continuent d’exister aujourd’hui. Elle ressemble plus à une extension humaine et presque naturelle de l’aide à un proche comprise au sens « spontané », et à ce titre, il se peut même que l’on soit amenés à déplorer l’aspect artificiel de cette institutionnalisation de l’assistance : ce qui était profondément humain se perd dans des processus bureaucratiques froids et austères qui peinent à rendre sensible leur importance[3].
L’intérêt est pourtant évident : cela rend possible de traiter des sociétés plus larges, de détacher la relation d’aide des subjectivités des « aidants » et placer l’intervention là où elle sera le plus efficace, mais souvent aussi le moins visible ; autrement dit, faire de l’assistance ce qu’elle est réellement : un droit, et non pas une faveur.
Simmel écrivait qu’un droit nous émancipe de la honte liée à la demande d’aide[4], qui existait dans les formes plus anciennes d’assistance, ces assistances affectant le rapport de dépendance en instituant la catégorie du « pauvre » comme celui bénéficiant d’une aide et non plus comme celui dans le besoin. Mais le travail plus récent de Serge Paugam analysant la manière dont les demandeurs d’aide sociale vivent leurs situations nous montre que cette institutionnalisation de l’aide n’a pas changé la perception (a minima vécue) de l’assistance.
Paugam identifie deux aspects de ce vécu qu’il nomme stigmatisation et disqualification. La stigmatisation renvoie à la honte et au vécu individuel :
Lorsque la pauvreté est combattue et jugée intolérable par la collectivité dans son ensemble, son statut social ne peut être que dévalorisé. Les pauvres sont, par conséquent, plus ou moins contraints de vivre leur situation dans l’isolement. Ils cherchent à dissimuler l’infériorité de leur statut dans leur entourage et entretiennent des relations distantes avec ceux qui sont proches de leur condition. L’humiliation les empêche de développer tout sentiment d’appartenance à une classe sociale.[5]
La disqualification fait, quant à elle, référence à la situation du « pauvre » dans le réseau d’interdépendance et renvoie donc à l’aspect collectif :
Si les pauvres, par le fait d’être assistés, ne peuvent avoir qu’un statut social dévalorisé qui les disqualifie, ils restent malgré tout pleinement membres de la société dont ils constituent pour ainsi dire la dernière strate. En ce sens la disqualification sociale n’est pas synonyme d’exclusion. Non seulement la situation des populations que le concept de disqualification sociale permet d’analyser sociologiquement relève d’une forme d’exclusion relative, mais révèle surtout, en elle-même, des relations d’interdépendance entre les parties constitutives de l’ensemble de la structure sociale.[6]
Nous pouvons donc observer que la légitimité d’un droit dépasse de loin sa seule promulgation institutionnelle : l’assistance reste perçue comme une forme de dépendance dont la légitimité au sein du réseau est particulièrement fragile. L’aide sociale reste au fond une faveur, et l’État social prendra d’ailleurs le nom d’État-providence, appuyant encore un peu plus ce constat.
Sans passer par la case du fameux « don – contre don » de Marcel Mauss, il nous faut bien remarquer qu’une relation implique au moins deux personnes ou groupes sociaux (aidants et aidés dans ce cas) et que l’on ne peut limiter ici l’analyse au vécu du groupe aidé. Simmel met d’ailleurs le groupe ou la personne aidante au centre de l’œuvre caritative ou philanthropique, le « pauvre » n’étant alors que le récipient – un pur alibi – d’une aide servant à soulager la conscience de l’aidant, à promouvoir le salut de son âme (dans la tradition chrétienne) ou à démontrer l’étendue de sa noblesse au reste de la collectivité. Et il est vrai que payer ses impôts ne produit, en ce sens, pas tout à fait le même effet.
Il faut pourtant se rappeler que, comme il s’agit ici de liens et de dépendances, la dégradation de ce lien ne peut qu’avoir un effet délétère sur l’ensemble de la société : la misère a un coût, même celle d’autrui. L’« Ébauche de la loi pour les pauvres de Prusse de 1842 affirme que l’État doit mettre en place un système d’assistance aux pauvres dans l’intérêt de la prospérité publique»[7], et ce qui y est évoqué n’est pas qu’affaire de grandeur d’âme. On parle ici d’insécurité, de services publics fragilisés, d’institutions surchargées et d’une dégradation générale de la qualité de vie. En d’autres termes, la qualité de mes interdépendances conditionne la stabilité de ma propre existence : à nouveau, le vécu individuel est conditionné par une réalité collective.
Il n’est pas inutile alors de rappeler que l’État social est loin d’être un projet communiste, bien au contraire. Sa fonction première est d’assurer le bon fonctionnement d’une société basée sur le profit, en assurant à tous un service minimum rendant supportables les immenses inégalités qui ne peuvent que survenir d’un tel projet sociétal. Il faut admirer l’hypocrisie de la critique de l’aide aux précaires fondée sur l’idée d’une relation à sens unique quand on constate que c’est précisément cette réciprocité qui justifiait la proposition même de cette loi il y a de ça déjà deux siècles.
Mais alors, où est le problème ? Si l’aide a toujours existé dans une forme ou l’autre, si l’État social permet avant tout le bon fonctionnement d’une société qui se détourne autant que possible de sa composante sociale, et si en plus elle aide à réduire l’insécurité, à améliorer la qualité de mes interdépendances et à augmenter la qualité de vie générale, comment justifier une attaque si constante des aides fournies par l’État social ?
De l’assistance instituée à la charité philanthropique
On retrouve, selon moi, dans la philanthropie d’aujourd’hui les intérêts de la charité d’hier, d’avant l’établissement d’un droit à l’aide sociale, d’une recherche et d’un traitement de ses causes. Elle est directe, personnelle, elle me fait voir la souffrance que je choisis de soulager et me rend visible auprès de ceux que j’aide. Elle valorise la subjectivité de mon jugement et réduit pour un temps cette distance sociale entre l’aidant et l’aidé.
L’État social fonctionne selon une modalité inverse : comme l’écrit Simmel[8],
la distanciation entre l’individu et l’unité sociale, malgré son manque de visibilité, est plus fondamentale et radicale dans son abstraction et sa froideur que les sacrifices de l’individu pour la collectivité dans laquelle les moyens et les fins ont tendance à être liés par une chaîne de sentiments.
« L’État social traite la pauvreté, mais la charité aide les pauvres. »[9]. Bien que la charité présente d’évidents problèmes — comme l’importance pour le groupe aidé de convenir aux attentes du groupe aidant ou de refuser que l’aide puisse devenir un droit — il nous faut constater que les individus semblent factuellement préférer répondre d’une aide de ce type, sachant rendre sensible le lien unissant les aidants aux aidés, que d’une autre aide, certes plus efficace, mais symboliquement plus distante et, par suite, apparaissant subjectivement comme moins légitime.
Alors, si l’interdépendance est la caractéristique fondamentale d’une société, encore faut-il que cette interdépendance puisse être constatée. Nous pouvons donc mieux comprendre l’omniprésence de la notion de distance dans l’analyse des relations d’assistance, que ce soit sa trop grande présence et son instrumentalisation dans l’État social ou sa réduction – si pas toujours d’un strict point de vue organisationnel, à tout le moins symbolique – dans la charité ou la philanthropie. Il me semble intéressant de constater que, paradoxalement, si l’aide se développe dans la proximité, la misère apparaît moins tolérable à distance.
Cette mise à distance ne s’observe pas que théoriquement. Dans son travail sur les sans-chez-soi à Paris, Les Naufragés, Patrick Declerck[10] observait qu’une certaine gradation de la précarité s’opérait dans l’aide aux plus défavorisés : le sans-abri était en contact avec un travailleur social, lui-même en contact avec un psychologue, lui-même en contact avec un directeur d’ASBL, lui-même en contact avec un responsable politique, etc. En ce sens, nous pouvons observer in concreto la mise à distance de la misère dans le fonctionnement même de l’aide sociale et dans les rapports humains induits.
Cette dynamique s’observe également autrement, à travers différents phénomènes d’urbanisation tels que la gentrification ou la ghettoïsation, le regroupement spatial de rapports sociaux similaires/comparables à la précarité. Quartiers résidentiels aisés, écoles privées et sections de première classe dans les transports doivent, à ce titre, être compris comme autant de dispositifs permettant de garder au loin les effets les plus délétères du mauvais traitement des précaires et d’installer lentement l’idée que ce qu’on désigne comme « la société » n’est pas réellement l’entièreté de la société, mais plutôt celle des gens qui vivent avec moi, de ceux qui me sont physiquement et symboliquement proches. C’est là que se dessinent les contours de cette illusion d’une société qui serait méritante au sein d’une société floue et assistée : une société qui fonctionnera de fait toujours sur des interdépendances, mais au sein de laquelle nous prendrons soin de ne pas les appeler « assistance ».
Cette illusion performative amène naturellement les individus à remettre en question l’importance des services publics, bénéficiant surtout aux autres, à œuvrer pour réduire progressivement leurs subventions et les amener à leur privatisation, ce qui ne fera, au fond, qu’approfondir cet éloignement par l’installation de transports privés, d’hôpitaux privés, voire même de milices privées. En un sens, l’illusion sociale sur laquelle s’appuie l’idéal-type de l’État-entreprise n’est, de ce point de vue, rien d’autre que celle d’une mise à distance radicale des personnes en souffrances, soit : la prétention à défaire l’interdépendance structurelle qui lie – pourtant – chaque individu à l’autre dans une société organisée.
Conclusion
Si l’analyse de la société comme réseau d’individus en interdépendance permet de saisir la relation d’assistance (institutionnalisée ou non) comme un élément constitutif de nos sociétés opérant selon la même réciprocité que toutes autres formes d’interdépendance,
les différences de traitement évidentes entre la philanthropie et l’État social nous rappellent que la réalité ne se suffit pas à elle-même et que la compréhension de celle-ci (basée sur sa perception ou l’interdiction de son occultation) est centrale à l’établissement d’un projet social qui serait à la fois efficace et soutenable.
L’étude des différences entre état social, charité et philanthropie m’amenait à établir la “distance” comme variable déterminante du ressenti de la réciprocité de l’interdépendance. Il apparaît alors que l’illusion nécessaire à l’établissement d’une société néolibérale, l’idée selon laquelle nous pourrions choisir les dépendances dont nous sommes tributaires et éliminer de notre société souhaitée les membres du réseau n’existant pas dans ces relations particulières, dépend de l’établissement de cette distance.
Un chemin sur lequel, il faut bien constater, que nous sommes déjà bien engagés. Si le discours néolibéral fonctionne c’est qu’il reformule nos relations selon des modalités qui lui conviennent et qui confirmeront (automatiquement) le propos qui les a justifiées. Le geste est adroit, d’autant plus qu’il se prémunit de ses propres conséquences ; d’ici à ce que la destruction occasionnée se fasse sentir, l’isolement du groupe délaissé ou le rejet du lien nous unissant devrait être suffisamment établi pour que cette perte soit à peine regrettée.
Des leviers existent pour reconstruire une société solide bâtie sur la sensibilité de ses liens et la force de ses dépendances. Que ce projet doive servir à privatiser l’assistance au nom d’un tissage d’interdépendances plus directes, rien n’est moins sûr.
- [1] Zamora Daniel, « Histoire de l’aide sociale en Belgique », dans Revue Politique, n°74, 2021 [En ligne]. URL : https://www.revuepolitique.be/histoire-de-laide-sociale-en-belgique/
- [2] Simmel Georg, Les pauvres, Paris, PUF, 1907 (2018), p. 39.
- [3] Voir l’étude du présent numéro.
- [4] Simmel Georg, Les pauvres, op. cit., p. 23.
- [5] Cf. CNDP 2001 – Lycée / La table ronde pédagogique « L’exclusion existe-t-elle ? » Les réponses de Serge Paugam, sur http://www.sceren.fr/tr_exclusion/rep_paug.html.
- [6] Voir Duvoux Nicolas, Paugam Serge, La régulation des pauvres, Paris, PUF, 2013, pp.15-31. L’auteur note néanmoins que les aspects les plus violents de ce vécu peuvent varier selon la fréquence de la demande d’aide, la durée d’assistance, l’assurance de l’accès aux droits ou encore la présence d’un cercle social proche et soutenant.
- [7] Simmel Georg, Les pauvres, op. cit., p. 49.
- [8] Simmel Georg, Les pauvres, op. cit.
- [9] Ibid.
- [10] Declerck Patrick, Les Naufragés. Avec les clochards de Paris, Paris, Plon, 2001, p. 63.