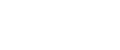BAVURES, VIOLENCES POLICIÈRES OU ORDRE POLICIER ?
Réflexion sur le partage contemporain de la violence
Introduction
Une certaine convergence existe dans la littérature portant sur la question des violences policières : il existe une grande opacité sur les motifs capables de les rendre intelligibles, malgré l’évidence de leur occurrence et la diversité de leurs dénonciations. Non seulement les violences policières sont devenues l’une des expressions courantes du caractère arbitraire du monopole de la violence qu’a l’État, mais elles incarnent aujourd’hui la quasi entièreté du potentiel létal de l’exercice du pouvoir d’État, dès lors que se multiplient les événements où des citoyens décèdent des suites de blessures causées par les forces de police, et ce à l’occasion de l’exercice régulier de leurs fonctions et non dans le strict contexte de « bavures » individuelles. Le contexte contemporain à l’écriture de ce texte, soit celui de l’immense mobilisation ayant fait suite à l’assassinat raciste de Georges Floyd aux États-Unis, vient inscrire dans cette problématique la structuration raciste que revêt cette même violence, cette dernière faisant elle-même largement consensus dans la même littérature, et ce depuis un certain temps déjà. Quoiqu’il s’agisse donc d’une dimension absolument fondamentale de ce que nous allons discuter, nous voudrions ici proposer une analyse située « en deçà » de cet enjeu.
Nous aimerions en effet tenter une double problématisation de la question de la gestion de la violence civile dans les sociétés démocratiques : dans un premier temps, nous voudrions opérer une déconstruction de ce qu’on entend habituellement par « violence policière » par le biais d’une interrogation critique de la notion de « bavure ». Dans un second temps, nous essayerons d’élargir notre réflexion afin de mettre en évidence, à l’intérieur de la problématique des violences policières, les motifs sociétaux généraux qui permettent d’en comprendre la fonction véritable : celle de contribuer à l’institution de la société telle que nous la connaissons, c’est-à-dire une société néolibérale où un « ordre policier » garantit le maintien d’un système « libéral-paternaliste ». Ce texte s’adresse, de fait, plus spécifiquement à ceux qui s’interrogent sur le caractère systémique de la violence policière (et sur la pertinence du mot bavure), ainsi qu’aux militants divers qui mènent aujourd’hui la lutte contre l’ordre policier, tant nous pensons que cette même lutte bénéficiera d’une analyse de la fonction économico-politique de cet ordre et du déploiement social qu’elle suppose.
Qu’appelle-t-on « bavure » ?
Le terme de « bavure policière » est d’usage plutôt récent. Il n’apparaît que dans la neuvième édition du Dictionnaire de l’académie française, soit au plus tôt en 1992 [1], signe d’une reconnaissance tardive de son usage. Cependant, on trouve en France des occurrences du terme bien avant cette reconnaissance dans l’officialité de la langue française car il est utilisé dès les années 70 pour qualifier des formes de « dérapages » policiers qui ont lieu dans l’exercice de leur fonction de maintien de l’ordre [2] : on parle donc de « bavure » pour désigner une intervention policière qui aurait « dégénéré », sans précision particulière sur le seuil qui permet de déterminer rigoureusement à partir de quand la situation est réputée régulière ou dégénérée. En effet, l’utilisation du terme est essentiellement liée à la dénonciation externe (médias et journalistes, militants, politiciens, peuple, etc.) de faits de violence commis par des policiers, mais n’a pas le statut d’une catégorie officielle de l’intervention policière. En particulier, ce sont les années 80 et l’emblématique affaire du meurtre de Malik Oussekine en 1986 qui entérineront profondément le recours au registre de la bavure pour dénoncer les meurtres commis par les forces de l’ordre, spécifiquement le caractère raciste de ces nombreuses atteintes policières à la vie des populations précarisées, jeunes et racisées [3].
La question des bavures policières est depuis réactivée à de multiples reprises et en particulier dans les périodes de mouvements sociaux importants, surtout si ces derniers prennent corps dans des quartiers populaires (pensons par exemple, en France, aux émeutes de 2005 et bien entendu aux mobilisations des Gilets jaunes qui essaiment les rues de France depuis novembre 2018). Plus récemment, le confinement des populations conséquent de la pandémie de COVID 19 a également massivement ramené à l’avant de la scène la problématique de la violence arbitraire exercée par la police, plusieurs interpellations ayant conduit des individus à la mort dans des circonstances mal élucidées [4]. C’est pour désigner ce que l’on peut reconnaître dans un premier temps comme de simples « faits divers » qu’est utilisé le vocabulaire de la « bavure » : ce terme les présente comme des occurrences non systémiques et, par suite, non légitimes de violence d’État. Reconnues (péniblement) par les autorités politiques comme des faits regrettables qui méritent parfois une enquête locale, les bavures sont désignées comme « bavures » au nom d’une logique de minimisation et ne font, de ce fait, jamais ou que rarement l’objet d’une reconnaissance comme problème structurel [5].
Or, ainsi que le soulignait déjà l’avocat Dominique Tricaud en 1989,
Je pense cependant qu’il ne faut pas que nous nous laissions enfermer dans le mot bavure ; c’est un mot de journaliste, facile, et derrière le fait divers on découvre qu’il y a un rapport disharmonieux entre la police dont le rôle est de protéger la population et la population elle-même qui a parfois le sentiment d’avoir plus à redouter qu’à espérer des forces de l’ordre. On ne peut pas ne pas avoir le sentiment que la police est chargée de protéger une partie de la population et d’en réprimer une autre. [6]
Comme nous l’avions déjà analysé dans un texte précédent portant sur les stratégies contemporaines de chasse à l’homme [7], il nous semble que la question des bavures policières s’éclaire quand elle est envisagée dans la perspective de la séparation des individus que suppose, en Occident du moins, l’instauration d’un ordre social : la mise au ban et la répression d’une partie de la population sert à imposer l’ordre social dominant s’exerçant sur la population dans son ensemble.
Le « public cible » de la bavure
Fabien Jobard opère une déconstruction très informée de la notion de bavure dans sa monographie Bavures policières ? La force publique et ses usages [8]. Il y indique combien la compréhension de ce phénomène repose sur l’analyse du contexte dans lequel il se manifeste, en particulier grâce à la considération des « caractéristiques sociales des individus concernés » [9]. Cela signifie qu’on ne peut comprendre la bavure policière comme étant une violence strictement aléatoire (comme si la police dérapait au hasard des circonstances particulières de ses interventions) mais qu’au contraire, elle s’exerce sur une « clientèle » particulière que l’auteur caractérise par le concept d’« anomie », emprunté au sociologue Émile Durkheim. Dérivée du grec (littéralement a-, sans, –nomos, règle, structure, loi), l’anomie désigne – sociologiquement – l’état d’une société ou d’une population en prise à un flou caractérisé, sinon à une désintégration formelle des normes et des règles qui encadrent les conduites humaines et, plus généralement, l’ordre social. Dans les mots de Fabien Jobard lui-même, l’anomie désigne
[l]e mode de vie, contraint ou choisi, qui voit l’individu organiser sa vie au jour le jour. La précarité de son logement ou de sa situation familiale le met « à la rue », où il passe en effet une bonne partie de son temps, et où il pallie avec les pairs de rencontre l’absence d’activités sociales que le travail pourvoit d’ordinaire. […] L’anomie embrasse donc l’isolement des personnes (leur « désaffiliation », leur « inutilité au monde ») mais aussi leur « indiscipline », leurs états « déréglés », « où la société ne parvient pas, pour différentes causes, à exercer sur les individus le pouvoir normatif qui la caractérise essentiellement ». L’anomie décrit ainsi la conjugaison de la désaffiliation, de l’errance urbaine et de l’inscription dans des cycles d’échanges incertains, dangereux et à très court terme. [10]
Ainsi, le public cible « régulier » de la violence policière serait celui qui, précaire ou désaffilié, est déjà fortement quadrillé par les institutions sociales de l’État (il en est souvent le bénéficiaire, via allocations, dispositifs d’insertion, associations socio-culturelles, etc.) mais qui, du fait de la très faible capacité de ces mêmes institutions à permettre autre chose que la simple subsistance et à permettre de « [dégager] ses « bénéficiaires » d’un état permanent de nécessité » [11], se voit toujours menacé d’avoir à faire de l’espace public en général, et de la rue en particulier, son véritable espace de vie, son « foyer » quotidien.
Fondée sur l’analyse des caractéristiques communes rassemblant les témoignages recueillis dans son étude, la thèse de Jobard est donc de montrer que le public cible de la violence policière n’est autre que l’ensemble des exclus de l’ordre social dominant, soit ceux qui, par leur marginalité, sont factuellement conduits à incarner un « trouble à l’ordre public ». En effet,
[l]’homme moderne, celui des Lumières, est un homme qui circule sans encombre dans l’espace public, défini par le fait qu’il n’est plus le lieu des activités privées. La police moderne […] est ainsi une police de la ville, qui a pour fin d’assurer l’ordre public, la circulation, le fait de se déplacer sans entrave d’un point à un autre. On voit bien pour quelles raisons nos personnes qui ont la rue pour foyer s’opposent par leur simple état à la police. Gênant la circulation, elles empêchent l’ordre et l’État. […] Agents de sécurité publique, les policiers tiennent à ce qu’elles n’entravent pas le flux régulier de la vie commune ; agents de police judiciaires, ils les recherchent comme auteurs possibles d’infractions à la loi pénale. [12]
On voit donc que la police « est chargée », ou a pour fonction de protéger une partie de la population (les « inclus ») et d’en réprimer une autre (les « exclus »). Ce qui est explicité en creux de cette thèse est essentiel à notre propos : que les sujets réguliers de la violence policière ne sont pas produits/choisis en tant que tels par la police elle-même (comme si elle choisissait de façon autonome ses cibles). C’est le système socio-économico-politique, encadré par l’État, qui soumet une partie déterminée de sa population à des conditions sociales qui l’exposent intrinsèquement à la police, dont la fonction explicite est d’en ordonner le vécu quotidien. En peu de mots, l’État propose et la police dispose. Il devient alors relativement facile d’identifier précisément de quelle population nous parlons : exclu.e.s sociaux.ales, jeunes en errance, étranger.e.s et irrégulier.e.s, grand.e.s précaires et sans-abris, prostitué.e.s, jusqu’aux manifestant.e.s qui s’approprient l’espace public pour dénoncer, précisément, l’ordre public et qui vont, à ce titre et en toute logique, le troubler.
Quant à nous, notre hypothèse est que ce que désigne le terme de « bavure » n’est autre que l’ensemble des situations où la violence régulière de la police démontre trop explicitement cette logique d’apartheid social. Ou, pour le dire autrement encore, que la bavure n’est que le symptôme irrégulier – l’événement visible – de la violence sociale régulière qu’incarne la fonction de la police elle-même, violence qui, par le fait de se concentrer exclusivement sur les « bavures », est rendue invisible et indiscutable : ce que dénoncent souvent les médias en recourant au vocabulaire de la « bavure », c’est moins qu’un individu ait perdu un œil, la vie, etc., mais davantage que certaines interventions policières montrent (trop) explicitement que l’ordre social démocratique est lui aussi fondé sur des pratiques répressives, parfois/souvent très brutales.
Cette hypothèse – soit l’idée que la « bavure » est, littéralement, ce qui « bave » (ce qui se voit) de la violence régulière de la régulation policière instaurée par l’État – s’accorde avec une position défendue par Geoffroy de Lagasnerie sur la question de la violence policière elle-même, et qui consiste à dire que la catégorie même de « violence policière » risque de nous conduire à limiter notre perception de ce qui est violent dans l’action policière à ce qui est illégal, au lieu de comprendre que la violence exercée par la police comme institution est la fonction nécessaire d’un ordre sociétal global.
La catégorie de violences policières est, pour moi, extrêmement problématique car elle conduit à ne plus considérer comme violences que ce qui est illégal – c’est-à-dire qu’on ne va plus considérer comme violences policières une arrestation sur la route, une perquisition où un flic surgit à 6h du matin, casse une porte, met des menottes à quelqu’un – mais uniquement ce qui est particulièrement brutal. Mais c’est oublier que la police comme institution est par essence violente. La police a le monopole des outils violents : elle a le droit de taper, de mutiler, de tirer, d’attraper, d’ouvrir de force… Soit on dit qu’il n’y a pas de violences policières parce qu’on dit police = violences, soit on dit qu’il n’y a que des violences policières. […] Je préfère substituer à la catégorie de violences policières, celle d’ordre policier [nous soulignons, ndlr], c’est-à-dire que la police est par essence violente et c’est en général qu’il faut remettre ça en question. [13]
La bavure policière serait, en ce sens, le corollaire naturel d’un ordre policier dont nos démocraties sont tributaires parce qu’elles organisent l’ordre sociétal sur la répression des populations qui s’y trouvent marginalisées et visées par la domination. La police se voit donc dotée de moyens d’exercer une violence qui, aux yeux de la structure sociale et politique, est par essence légitime parce qu’elle rend, à la lettre, possible le déploiement de l’ordre qu’elle est censée garantir.
Du partage néolibéral de la gestion de la violence
Afin de comprendre la spécificité de l’ordre policier contemporain il nous faut toutefois accomplir un pas de plus. On sait que la police n’incarne pas seulement l’ordre sociétal au travers de sa violence intrinsèque mais qu’elle a aussi, dans le même temps, un rôle de pacification et de régulation, voire de présence familière de l’ordre civique au sein des différentes communautés qui le composent, suivant la vieille distinction entre la figure du « cop » états-unien, incarnant le policier compris comme « force de l’ordre », et le « bobby » britannique, incarnant plutôt le policier compris comme « gardien de la paix ». Comme l’explicite à ce propos Didier Fassin, auteur d’une vaste étude anthropologique portant sur les « polices de quartier »,
Le premier, chargé de faire le sale travail de la société, se tenait dans une relation d’hostilité réciproque avec son public. Le second, représenté comme étroitement lié à la communauté, semblait mû par un sens de son devoir civique. De l’un, on soulignait la violence ordinaire et le racisme constitutif. De l’autre, on louait la familière présence et l’engagement professionnel. Bien sûr, il ne faut pas surestimer cette opposition et de nombreux traits communs rapprochaient les deux types de police, notamment le décalage entre la mission officielle d’application de la loi et la diversité effective des tâches accomplies. [14]
La montée en puissance du thème de la bavure doit, selon nous, être rapportée à la disparition progressive de ce modèle où l’institution policière incarnait ces deux pôles à la fois, comme ce fut longtemps le cas en France et en Belgique, au profit d’un renforcement de plus en plus marqué de la logique de la police comprise comme force de l’ordre pure et dure, chargée de juguler l’augmentation de la délinquance et en général de la remise en question de l’ordre sociétal. Il est en ce sens assez bien établi que les 20 dernières années ont été le théâtre d’un durcissement de l’usage des forces de l’ordre dans la répression des différentes formes de criminalité civile (mouvement qui s’est, surtout, manifesté à partir du tournant sécuritaire des pays occidentaux induit par le 11 septembre 2001 et les attentats sur le WTC). Toujours selon Fassin,
au cours des récentes décennies, l’évolution générale des polices s’est faite, au plan international, vers la version dure de la force de l’ordre. Ou, plus exactement, cette version dure s’est imposée de manière presque systématique comme forme de gouvernement des populations les plus précaires et marginales, et notamment des milieux populaires et des minorités ethniques. Le déploiement d’une idéologie sécuritaire en a été un élément décisif, s’appuyant sur des discours attisant la peur pour justifier des politiques plus répressives, l’accroissement des effectifs policiers, le renforcement des dispositifs punitifs, indépendamment d’une aggravation objective de la délinquance et de la criminalité, et souvent même dans le contexte de leur diminution. [15]
Cette évolution est de notre point de vue très importante pour mieux comprendre notre présent et pour analyser sous un autre jour le rôle des institutions sociales et associatives de nos sociétés, dont nous devons admettre qu’elles ont souvent, au fond, le même « public cible » que celui des interventions policières où surviennent majoritairement les fameuses « bavures » que nous avons questionnées. Et, en réalité, il y a à notre avis un lien important entre ces deux domaines d’intervention étatique, la police et l’action sociale, qui n’est pas souvent mis en valeur. Ce lien incarne pourtant une tendance forte des structures de l’État moderne, structures dont nous sommes toujours tributaires et qui font la force politique (tant dans le sens positif que négatif du terme) des États démocratiques contemporains : celle de combiner l’action préventive et l’action répressive comme modes de gouvernement des populations.
En 1982, en France, la Commission des maires sur les questions de sécurité fournit au premier ministre de l’époque (Pierre Mauroy, socialiste et mitterandiste) un rapport qui fera date, sur le sujet « Face à la délinquance, prévention, répression, solidarité » [16]. Sorte de synthèse d’environ 200 pages sur l’état présent de la question de la délinquance et des moyens pour y remédier, la commission y fournit tant des diagnostics que des recommandations et des perspectives sur l’usage de la police, des prisons, des dispositifs de prévention, etc. Le constat dominant, cohérent avec la thèse de Fassin, est que l’usage massif du système répressif n’est pas à proprement parler efficace puisque son usage tend à ne pas modifier les chiffres de la délinquance et qu’il pose des questions importantes quant au coût économique et social de son déploiement. Ainsi, le rapport stipule que « le renforcement de l’appareil répressif (police, justice, prison) coûte de plus en plus cher pour un rendement de moins en moins élevé » [17], ou encore que « l’influence du système répressif sur la délinquance n’est pas évident » [18]. En revanche, le rapport fournit des données historiques importantes sur les conceptions politiques qui encadrent les liens entre répression d’une part et travail social de prévention d’autre part. Notamment, il est explicité que
[l]e rôle essentiel de l’appareil répressif est de combattre l’illégalité, de maintenir le consensus national autour d’un certain nombre de valeurs sur lesquelles est basée la vie commune, de conforter la solidarité nationale. Dans son discours d’installation de la Commission des maires, le Premier Ministre déclarait d’ailleurs : « Pour sa part, le Gouvernement n’entend pas choisir « à priori » entre la voie éducative et la voie répressive. Les deux démarches vont de pair. […] » [19]
Il nous semble très important de relever dans cette déclaration du premier ministre que cite ici le rapport la présence de cette idée d’une complémentarité fondamentale entre voie éducative et voie répressive. Celle-ci aura en effet un poids déterminant sur la mise en place des stratégies d’intégration sociale des citoyens, conçues comme autant de méthodes pour assurer l’unité nationale autour du projet républicain. Les outils de prévention qui sont décrits dans le rapport sont ceux qui servent de balises fondamentales à l’action associative telle que nous la connaissons encore aujourd’hui en France et en Belgique, et visent à intervenir sur ce qui est décrit comme des facteurs essentiels de la délinquance, à savoir :
Conditions d’habitat et notamment surpeuplement et ségrégation dans certains immeubles, suroccupation de logement, difficultés d’insertion professionnelle et sociale, évolution des modes de vie familiaux, disparition de la vie sociale organisée durant la journée, absence de contrôle social dans les relations de quartier, pauvreté et marginalité de certaines catégories de population, aggravées par certains phénomènes comme la drogue, l’alcoolisme, multiplication des tentations liées à l’augmentation des biens disponibles, crise économique… [20]
Difficile de ne pas voir dans cette liste l’objet des principales préoccupations de l’action associative elle-même. Si bien que, ainsi que l’a exposé Pierre Bourdieu lorsqu’il mobilisa la distinction entre main gauche et main droite de l’État pour penser les conflits sociaux propres au néolibéralisme, la question du partage de la violence au sein de nos sociétés doit selon nous être interrogée à la lumière de cette complémentarité entre action sociale et intervention policière.
Il nous semble manifeste que l’État mène aujourd’hui, avec des variations nationales particulières, une politique organique de policing (maintien de l’ordre) des populations qu’il est amené à gouverner, et il use à cette fin des outils complémentaires que sont la police, dans sa fonction socio-répressive, et les divers intervenants sociaux, dans leur fonction socio-éducative et préventive. L’une ou les autres sont conçues comme des instruments de la gestion politique du pays et comme les garants du fonctionnement normal ou régulier des structures de la société, en particulier de celles qui, en dernier recours, garantissent à la sphère économique son fonctionnement « optimal ». Confiant le monopole de la violence légitime aux institutions policières (et militaires), l’État oppose à la violence quotidienne que génère l’économie différentes stratégies d’accompagnement, de soutien et d’intégration par le moyen des différentes « institutions sociales » qui composent la société civile. Si ces deux pôles étaient véritablement dans une situation de complémentarité, nous serions en capacité de les comprendre comme incarnant un équilibre dans la gestion de la violence qu’induit toute forme de collectivité politique : la « violence policière » ne serait alors que le mode normal – « proportionné » – d’intervention de l’État quand le système d’intégration sociale échoue à permettre à ses sujets une assimilation douce des principes normatifs qui sont supposés garantir la paix civile et le déploiement optimal de l’économie. Nous serions alors dans une situation où la main gauche (les intervenants sociaux, en général) et la main droite (ministères, économistes, police, etc.) de l’État s’accordent sur une conception commune du bien public. Or, comme Bourdieu l’analysait déjà en 1992, la conception néolibérale de l’économie politique active des contradictions du monde social qui placent sa main gauche dans une situation où cette complémentarité est profondément brisée.
Je pense que la main gauche de l’État a le sentiment que la main droite ne sait plus ou, pire, ne veut plus vraiment savoir ce que fait la main gauche. En tout cas, elle ne veut pas en payer le prix. Une des raisons majeures du désespoir de tous ces gens [intervenants sociaux, employés du service public, fonctionnaires, professeurs, etc.] tient au fait que l’État s’est retiré, ou est en train de se retirer, d’un certain nombre de secteurs de la vie sociale qui lui incombaient et dont il avait la charge : le logement public, la télévision et la radio publiques, l’école publique, les hôpitaux publics, etc. [21]
Ce définancement de l’intervention publique dans les secteurs dits de « la main gauche », caractéristique de l’économie politique du néolibéralisme, conduit à générer une défiance profonde de ces agents de l’intégration sociale à l’égard de l’État lui-même, plaçant les intervenants sociaux dans une situation d’opposition fondamentale à l’ordre social qu’ils sont supposés, par ailleurs, eux-mêmes garantir. Si le gouvernement auquel s’adressaient les propos de Bourdieu était socialiste, la logique qu’il décrit nous semble s’appliquer aussi bien à l’ensemble des gouvernements qui ont depuis lors assuré la gestion de la chose publique, des plus socialistes aux plus libéraux :
ce qui peut surprendre, c’est qu’ils [les socialistes] aient pu contribuer à ce point à l’abaissement de la chose publique : d’abord dans les faits, par toutes sortes de mesures ou de politiques (je ne nommerai que les médias) visant à la liquidation des acquis du welfare state et surtout, peut-être, dans le discours public avec l’éloge de l’entreprise privée (comme si l’esprit d’entreprise n’avait d’autre terrain que l’entreprise), l’encouragement à l’intérêt privé. Tout cela a quelque chose de surprenant, surtout pour ceux que l’on envoie en première ligne remplir les fonctions dites «sociales » et suppléer les insuffisances les plus intolérables de la logique du marché sans leur donner les moyens d’accomplir vraiment leur mission. Comment n’auraient-ils pas le sentiment d’être constamment floués ou désavoués ? [22]
Ce « malaise » est au cœur des tensions sociales qui animent, chaque année davantage que la précédente, le quotidien politique des sociétés néolibérales. Or, en parallèle à cet épuisement de plus en plus caractérisé des forces supposées garantir pacifiquement l’ordre social, le recours à la police comme dernier rempart d’opposition à la colère sociale s’est lui-même de plus en plus systématisé. Et le rapport instrumental de l’État à sa propre police n’a cessé, de la même façon, d’y renforcer une autonomie dangereuse au sein de laquelle la question des violences policières et de leur lot de « bavures » vient prendre, à notre avis, tout son sens.
En effet, dans la forme du partage de la violence à laquelle nous sommes confrontés, la colère des agents de police eux-mêmes gagne un sens et une puissance tout à fait révélatrice. En effet, il est évident qu’en tant que fonctionnaires d’État, les policiers sont eux-mêmes en prise avec une violence et un mépris quotidien qui peuvent les épuiser, attiser leurs peurs propres, activer des pulsions corporatistes fortes et réellement mettre à l’épreuve le sens de leur fonction [23]. Fortement polarisées par leur représentation syndicale, les forces de police ont été amenées à de multiples reprises à manifester elles-mêmes contre l’encadrement et le traitement dont leur fonction fait l’objet, jusqu’à très récemment encore à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre, lors de la manifestation du 19 juin 2020 [24]. Fabien Jobard démontre à ce titre que la gestion de la colère policière représente aujourd’hui un enjeu de taille pour la gestion de la violence en démocratie et aucun gouvernement ne prend ce genre de manifestation à la légère, au contraire de beaucoup d’autres issues, quant à elles, d’initiatives sociales.
Récurrentes, presque mécaniques, les colères policières sont de celles qui font immanquablement peur au politique. Parce qu’elles s’articulent à une rhétorique systématique de retrait, de vacance de la force publique, les gouvernements leur prêtent d’emblée une écoute inquiète. Ils savent aussi qu’ils jouent avec les organisations syndicales, les canaux d’expression de ces colères, une partition commune : avec elles, ils craignent plus que tout la sédition d’une partie des policiers frondeurs, qui échapperaient tant à leur hiérarchie qu’à l’encadrement syndical. [25]
Cet état de chose conduit à une situation que nous pensons éminemment palpable : presque systématiquement adoubés (au moins partiellement) dans leurs revendications, les policiers sont séparés d’avec les déterminants sociaux fondamentaux du néolibéralisme (notamment parce qu’ils sont très souvent utilisés pour réprimer sévèrement les manifestations qui s’y opposent) bien qu’ils en soient souvent eux-mêmes partiellement victimes. Cela les conduit à agir plus encore comme s’ils étaient les exécutants de la logique d’apartheid répressif sur laquelle se fonde l’ordre néolibéral dominant. Le sociologue Loïc Wacquant en avait formulé, sur base d’une analyse de la société américaine contemporaine, le modèle sociétal correspondant, l’appelant système « libéral-paternaliste » : un système qui exalte la liberté pour la main droite de l’État et du marché et exige un autoritarisme répressif sur tous ceux qui, en aval, affrontent les conséquences souvent terribles de ce même ordre néolibéral :
Ainsi se dessine la figure d’une formation politique d’un type nouveau, sorte d’ « État centaure » doté d’une tête libérale montée sur un corps autoritariste, qui applique la doctrine du « laisser-faire et laissez-passer » en amont des inégalités sociales, au niveau de leurs causes, mais qui se révèle brutalement paternaliste et punitif en aval dès lors qu’il s’agit d’en assumer les conséquences. [26]
De ce point de vue, et envisagé depuis cette généalogie sociologique, le phénomène de la bavure ou des violences policières, aussi aléatoirement absurde qu’il puisse paraître, n’a rien d’un accident de l’institution policière. Il incarne plutôt la conséquence logique d’un système où la répression policière est devenue l’opérateur central d’une économie fondée sur l’apartheid social de ses sujets, discriminant brutalement ceux qui sont en position d’exploiter et ceux qui doivent demeurer dans l’échelle sociale de la subsistance, c’est-à-dire dans les conditions d’accepter leur exploitation.
Conclusion
Notre analyse nous a conduits à envisager quelques thèses importantes pour situer de façon critique la question des violences policières. D’une part, le vocabulaire de la « bavure » et ce qu’il charrie produit une minimisation de l’instrumentalisation économique et politique dont la police est elle-même l’objet et dont sa violence est l’expression. Ensuite, nous avons pu déterminer que les « cibles » récurrentes de ces mêmes violences pouvaient être socialement déterminées, et qu’elles étaient sensiblement les mêmes que celles visées par le travail socio-culturel mené par les diverses institutions qui composent l’action sociale de l’État et l’action associative : il s’agit donc des personnes qui souffrent directement des inégalités qui résultent de l’ordre et des normes instituées par le capitalisme néolibéral. Enfin, nous avons pu tirer de là que les occurrences des violences policières ne pouvaient en aucun cas être attribuées exclusivement à l’arbitraire des individus en capacité d’exercer cette violence d’État, mais qu’elles ne pouvaient être comprises que comme l’expression pleine et entière d’un ordre sociétal fondé sur un apartheid social particulièrement brutal et répressif qui assure au néolibéralisme sa capacité d’exploitation des populations.
Nous n’avons pas ici la prétention d’offrir autre chose qu’un déplacement critique sur l’appréhension possible de ces phénomènes sociaux particulièrement graves. Nous voudrions néanmoins tirer de ces jalons analytiques quelques pistes de réflexion qui permettraient peut-être d’ouvrir de nouvelles voies de lutte. D’abord, nous pensons qu’en conséquence de ce que nous avons exposé, il est vain de vouloir obtenir une amélioration de l’institution policière en la prenant elle-même pour objet de réforme, sans interroger la logique politique qui préside à son organisation. Au contraire, et à l’instar de la position défendue par Geoffroy de Lagasnerie, nous pensons que c’est la logique de ségrégation sociale dont on a rendu la police garante qui doit être plus fondamentalement interrogée. Cette logique n’est autre que celle qui préside à l’oppression néolibérale des populations marginalisées, précarisées, racisées, rendues corvéables à merci et sanctionnables dès lors qu’elles s’opposent aux normes dominantes du marché et de ses structures d’appui.
Mais, enfin, cela ne doit pas conduire à abandonner cette problématique et à la suspendre aux lèvres d’un avenir révolutionnaire incertain. Nous pensons que la situation particulière dans laquelle se voit aujourd’hui inscrite la police et ses agents (pénibilité, instrumentalisation, etc.), doublée du fait qu’ils affrontent – depuis son prisme particulier et à partir de la violence qui la caractérise fondamentalement – les mêmes réalités sociales que celles qu’affrontent au quotidien les institutions sociales et culturelles de la société civile, devrait encourager les militant.e.s à affronter le problème depuis une perspective de recherche d’alliances progressistes. L’enjeu d’une éducation permanente militante et critique des agents de police est, à notre avis, certainement l’un des combats les plus essentiels de notre présent : il y a un immense travail militant à mener pour briser la solidarité instrumentale existant entre l’ordre néolibéral (et ses différentes formes de gouvernements) et l’institution policière. Comme le soulignait, à notre avis à raison, Fabien Jobard, l’ordre policier mis en place dans les sociétés néolibérales craint plus que tout la sédition de ses « forces de l’ordre » et déploie des efforts considérables pour les conserver dans le giron de leur instrumentalisation systémique (dont les syndicats de police sont d’ailleurs, souvent, eux-mêmes garants). L’organisation d’un front d’opposition à l’institution policière et ses insupportables violences ne pourra, selon nous, espérer une victoire qu’en obtenant la solidarité effective des forces de police contre l’ordre néolibéral dominant qui, par l’usage qu’il réserve à la fonction de police elle-même, en fait cet organisme de violence sélective, très souvent raciste, et garante de la misère sociale que produit la déréliction – elle-même désirée par les multiples structures du marché mondialisé – des mécanismes de protection sociale obtenus par les anciennes luttes ouvrières.
- [1] Voir l’édition en ligne [URL] : https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9B0686. Le Dictionnaire historique de la langue française Le Robert renvoie quant à lui les premiers usages du mot bavure aux années 1950.
- [2] En témoigne, par exemple, le Journal officiel de la République Française reprenant le compte-rendu des débats parlementaires à l’Assemblée Nationale de la première séance du mardi 13 novembre 1979. Le député communiste Maxime Kalinsky y interpelle le ministre de l’intérieur Christian Bonnet sur la problématique des effectifs de police, de leur financement et de leur formation, et sur les violences policières et autres bavures qui, selon lui, en résultent. Voir les archives de l’Assemblée Nationale en ligne [URL] : http://archives.assemblee-nationale.fr/6/cri/1979-1980-ordinaire1/061.pdf (en particulier les pages 9913-9914).
- [3] Nous renvoyons à l’affaire du meurtre de l’étudiant Malik Oussekine commis par deux policiers « voltigeurs » dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986 à Paris. L’affaire engagea des mouvements de révolte et d’émeute qui menèrent à la démission du ministre Alain Devaquet, alors au centre des mobilisations contre son projet de réforme universitaire. En particulier, la mort de Malik Oussekine entraina la suppression des unités motorisées « voltigeurs », qui se verront réactivées plus tard sous l’appellation « Unités cougars ».
- [4] On dénombre plusieurs morts en France, ainsi qu’en témoigne cette recension opérée par le site « Rebellyon » : https://rebellyon.info/Au-nom-de-la-lutte-contre-le-covid-19-la-22174. Il est à noter que l’objectivité du site est relativement faible, mais chaque cas cité est sourcé par des renvois aux articles de la presse généraliste qui en décrit les faits. En Belgique a lieu, notamment, la tragique mort du jeune Adil le 10 avril 2020 à Anderlecht. Cette intervention policière provoquera émeutes et remous sociaux dans la commune d’Anderlecht alors pleinement confinée. Nous renvoyons à l’excellent état des lieux publié par l’Agence Alter : VALLET, C., « Police et jeunes : bilan d’un confinement sous tension », dans Alter échos, n°484 [mis en ligne le 14/05/2020]. URL : https://www.alterechos.be/police-et-jeunes-bilan-dun-confinement-sous-tension/?fbclid=IwAR0e0DUS7nzOnyjNltMVez8Wf27lbG8BrBUZ_0O_JNRbvLkDThMAdb4BNF4
- [5] Voir, à ce propos, l’édifiant article publié par Médiapart : DUFRESNE, D., PASCARIELLO, P., « IGPN : plongée dans la fabrique de l’impunité », dans Médiapart, 12 juin 2020 [En ligne]. URL : https://www.mediapart.fr/journal/france/120620/igpn-plongee-dans-la-fabrique-de-l-impunite?page_article=2
- [6] MINCES J., TRICAUD D. « Les bavures policières sont-elles inéluctables ? », dans Hommes et Migrations, n°1127, décembre 1989, p.26.
- [7] Voir MARION, N., « La chasse à l’homme : autour d’un exercice du pouvoir contemporain », Publication ARC, année 2019, [En ligne]. URL : https://arc-culture.be/blog/publications/la-chasse-a-lhomme-autour-dun-exercice-du-pouvoir-contemporain/
- [8] JOBARD, F., Bavures policières ? La force publique et ses usages, Paris, La découverte, 2002.
- [9] Ibid., p.31.
- [10] Ibid.., p.32. La citation incluse dans cet extrait renvoie à KARSENTI, B., L’homme total. Anthropologie, sociologie et philosophie chez Marcel Mauss, PUF, Paris, 1997.
- [11] Ibid., p.33.
- [12] Ibid.
- [13] Propos de G. de Lagasnerie, recueillis par Pablo Pillaud-Vivien pour le média Regards, à l’occasion de La Midinale du 02 avril 2019, et publié en ligne sur http://www.regards.fr/la-midinale/article/geoffroy-de-lagasnerie-la-police-ne-sert-pas-d-abord-a-appliquer-la-loi-mais-a
- [14] FASSIN, D., La force de l’ordre. Une anthropologie de la police des quartiers, Paris, Seuil, 2011, p.342.
- [15] Ibid.
- [16] Le rapport est accessible en ligne dans sa version numérisée, rendu disponible par la plateforme officielle de l’État français vie-publique.fr. « Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité », Rapport de la commission des maires sur la sécurité, 17 décembre 1982. URL : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/834037801.pdf
- [17] Ibid., p29.
- [18] Ibid., p30.
- [19] Ibid.
- [20] Ibid., p31.
- [21] BOURDIEU, P., « La main gauche et la main droite de l’État », dans Contre-feux, Paris, Editions Raisons d’Agir, 1998, p.10.
- [22] Ibid., pp.10-11.
- [23] Voir à ce propos JOBARD, F., « Extension et diffusion du maintien de l’ordre en France », dans Vacarme, 2016|4, n°77, pp.24-29.
- [24] Voir https://www.lameuse.be/584165/article/2020-06-18/les-policiers-manifesteront-leur-mecontentement-ce-vendredi-charleroi
- [25] JOBARD, F., « Colères policières », dans Esprit, 2016|3, mars-avril, p.73.
- [26] WACQUANT, L., « L’ascension de l’État pénal en Amérique », dans Actes de la recherche en sciences sociales, 1998, n°124, p.7.