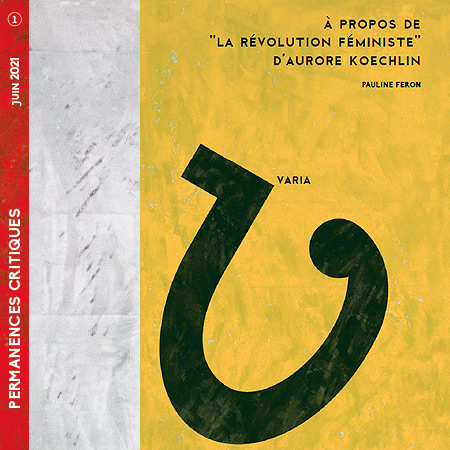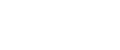08 Mars 2020, Guadalajara, les rues sont bloquées, la mobilisation aux couleurs mauve et verte bat son plein dans la ville mexicaine. « Ni una mas » [pas une de plus] est le slogan que scandent les milliers de femmes réunies lors de la manifestation. Trois mots qu’elles reprennent aussi en chœur et en larmes, à chaque mobilisation qui suit le meurtre de l’une des leurs, le féminicide étant une réalité quotidienne au Mexique. Toutes ces femmes, parfois sorties pour la première fois, clament leur refus de la peur, revendiquent leurs droits au grand jour.
En observant ce jour-là l’ampleur de ce phénomène coloré et dense, je ressentis un élan d’espoir pour la reconnaissance des droits des femmes à travers le monde. Mais cela m’interrogea aussi sur les mouvements féministes : comment faire pour poursuivre cette lutte au-delà de cette date qui nous rappelle à toutes les dominations vécues par notre condition de femmes ? Comment poursuivre la lutte avec des stratégies féministes en prise avec l’actualité ? Comment ne pas tomber dans les travers identitaires et quels outils, plus efficaces ou pertinents, peuvent être utilisés pour soutenir cette lutte ?
Ce souvenir de mon vécu mexicain[1], en mars 2020, touche précisément à l’une des thèses centrales de l’ouvrage d’Aurore Koechlin La révolution féministe[2]. L’autrice soutient l’émergence d’une 4ème vague féministe dont elle situe l’un des points de départ en 2011, suite à l’assassinat de la poète mexicaine Susana Chavez, figure du féminisme et de la lutte contre les féminicides[3]. Venant essentiellement d’Amérique Latine, cette nouvelle vague a pris une ampleur mondiale, se propageant rapidement dans plusieurs pays où elle insuffle de nouveaux mouvements[4]. Certains remportent des victoires. Dernier exemple en date : les mobilisations massives qui ont obtenu la légalisation de l’avortement en Argentine en décembre 2020.
Pour Koechlin, ce renouveau des contestations est une opportunité nouvelle pour réfléchir aux stratégies politiques du féminisme et s’interroger sur les questions qui sont plus particulièrement soulevées par cette 4ème vague. Pour ce faire, l’autrice propose, d’une part, de tirer les bilans des premières vagues du féminisme et défend, d’autre part, la centralité de la question de la reproduction sociale dans la compréhension de la domination capitaliste, avec un focus sur la grève comme outil de lutte.
En synthétisant les idées de cet ouvrage clair et incisif, qui invite à la convergence des luttes féministes et anticapitalistes en remettant le travail gratuit des femmes au centre de l’analyse de notre société patriarcale, je montrerai en quoi il permet de penser l’articulation des derniers mouvements de grève en Belgique, celui du 8 mars et celui sur l’accord interprofessionnel.
Une question de stratégie
Désireuse de mettre la question de la stratégie[5] au centre de son ouvrage, Koechlin nous donne des pistes de compréhension et une vision politique : « comment, pour quoi faire et avec qui lutter ? ». Pour cette 4ème vague féministe que nous voyons naitre sous nos yeux, elle défend une stratégie spécifique : celle d’un féminisme marxiste révolutionnaire. Selon elle, l’oppression sexiste est perpétuée dans des structures propres aux rapports de production capitaliste et ce sont ces structures qui doivent être modifiées radicalement. Ce faisant elle cherche, d’une part, à dépasser les écueils des deux stratégies mises en œuvre jusqu’à aujourd’hui par les mouvements féministes : la stratégie réformiste et la stratégie intersectionnelle. Et, d’autre part, à dépasser une certaine interprétation orthodoxe du marxisme selon laquelle la lutte féministe est une lutte secondaire, une simple conséquence de la stratégie de la bourgeoisie visant à diviser la classe ouvrière pour mieux l’exploiter.
L’autrice montre que les mouvements féministes français de la 1ère et 2ème vague[6] ont principalement adopté une stratégie réformiste. L’État démocratique bourgeois était alors perçu comme le lieu privilégié à investir dans le but de mettre fin à l’oppression des femmes. Beaucoup d’associations se sont donc rapprochées de cet État et se sont institutionnalisées, plus ou moins profondément et rapidement selon les cas. Elle distingue trois types de courants : le féminisme institutionnel, qui existe « sous perfusion de l’État » mais pas directement dans ses organes, le féminisme d’État, organisé au sein même des organes de gouvernement et le fémonationalisme qui utilise le féminisme à des fins racistes[7]. Si l’intégration de certaines organisations féministes aux structures de l’État a été positive pour faire avancer la cause des femmes, elle a montré également ses limites. L’exemple le plus frappant étant la récupération fémonationaliste de certains pans du mouvement à des fins islamophobes et réactionnaires. Comme le souligne Koechlin, la stratégie qui vise, de près ou de loin, à se rapprocher de l’État pour changer les choses pose question. Elle est indissociable de l’idée selon laquelle l’État serait un organe neutre dont il suffirait de s’emparer pour faire changer les choses. Or, « l’État, loin d’être un organe neutre au-dessus des rapports de domination, (…) est l’instrument central de la domination »[8].
Au sujet de la 3ème vague féministe, qui correspond selon elle au mouvement intersectionnel, Koechlin nous offre une ethnographie critique, forte de plusieurs années de militantisme en son sein[9]. La troisième vague « intersectionnelle »[10] a comme intérêt primordial la prise en compte du croisement des différents types de dominations (race, classe, genre, orientation sexuelle) qui ont souvent été sous-estimées dans le mouvement jusqu’alors. Elle a également permis la mise en place d’outils tels que l’organisation de la non-mixité dans des groupes militants, et a systématisé une critique autant à l’égard de l’instrumentalisation du féminisme qu’à l’égard de l’exclusion du mouvement des diverses « minorités ».
Ce mouvement n’est cependant pas exempt de faiblesses que Koechlin s’attache à identifier. Elle montre que la réception française des théories intersectionnelles issues du féminisme américain a opéré un double glissement de sens. D’abord, alors que les bases matérielles et économiques de l’oppression étaient au cœur du féminisme américain – et notamment du black feminism –, la notion d’identité est devenue centrale dans le milieu intersectionnel français. Les rapports de domination ont été individualisés à travers cette notion essentialisante. Ensuite, de manière corrélée, cela a eu pour effet de déplacer l’échelle de la stratégie politique du structurel à l’individuel. Selon Koechlin, ce double glissement ne remet pas en question la société de manière plus globale, mais crée toujours plus de division entre les différents groupes opprimés. Si les dominations sont pensées comme le produit des identités, il est alors possible de les hiérarchiser en les désarticulant du système social. De plus, l’intersectionnalité telle qu’elle s’est développée dans certains milieux en France s’attache parfois davantage à changer les individus et leur langage qu’à mener une lutte globale. Un mouvement se voulant inclusif mais qui, dans les faits et par ses contradictions, se voit souvent être excluant, reproduisant ainsi des hiérarchies entre les luttes qu’il s’attachait à dénoncer ailleurs. Ce courant individualise fortement les questions collectives d’oppressions structurelles des femmes. Pour reprendre les mots de l’autrice :
À l’opposé de la vision intersectionnelle, qui divise la société en une multitude de systèmes de dominations parallèles et définissant des positions essentialisées dominant/dominés, on doit défendre l’idée d’un système intégré et combiné des différents rapports de domination ancrés dans l’histoire et les sociétés considérées (classe, race, genre) produits et reproduits par des structures économiques, sociales et politiques (État, justice, police)[11].
Face à l’impasse de la stratégie d’institutionnalisation du féminisme – absorbée dans l’État néolibéral et dans un fémonationalisme décomplexé – et à celle du mouvement intersectionnel – qui tend paradoxalement vers la division et à l’individualisation des luttes –, sa proposition est la suivante : développer une vision qui permette de penser ensemble patriarcat et capitalisme. C’est sur cette grille de lecture qu’il est désormais important de revenir afin de comprendre l’intérêt de son analyse.
La 4ème vague féministe, la question du travail (reproductif) et la grève.
Selon l’autrice, cette 4ème vague est une synthèse qui compile le meilleur de l’héritage des deux précédentes et vise à les dépasser. Ainsi, pour elle, « la libération des femmes et des minorités de genre ne peut se faire qu’avec la libération de tou.te.s les exploité.e.s »[12]. De l’intersectionnalité, elle reprend les relations entre lutte de classes, antiracisme et minorité de genre[13] pour les intégrer à la stratégie féministe dans l’objectif de construire un mouvement plus inclusif. De la deuxième vague, elle retient la nécessité de se mobiliser largement pour créer un rapport de force par un mouvement de masse (comme ce fut le cas dans les revendications de la lutte pour la contraception et le droit à l’avortement).
Cette 4ème vague, dont Koechlin voit les prémices dans la dernière décennie propose, de plus, un renouement avec le mouvement ouvrier. En effet, le 8 mars n’est plus uniquement la journée mondiale pour faire reconnaître les droits des femmes, mais est devenu également une journée de grève féministe, réinventant ainsi de manière inédite sa portée mobilisatrice. Le mouvement cherche alors à s’allier aux syndicats et remet la question du travail gratuit ou sous-payé des femmes au centre de la lutte féministe. Pour penser l’oppression, le travail est central et l’outil de lutte qu’est la grève le devient également. Ainsi, en Espagne en 2018, 5 millions de femmes ont débrayé, soutenues par la CGT espagnole suite à un appel à la grève internationale lancé par les femmes latino-américaines en lutte de l’autre côté de l’Atlantique[14].
Pour comprendre la question de la centralité du travail et les enjeux que soulève la grève féministe, revenons sur les outils théoriques mobilisés par l’autrice. Koechlin reprend à son compte l’analyse matérialiste du capitalisme réalisée par Marx en son temps : le capitalisme est un mode de production basé sur l’exploitation d’une majorité de la population, les travailleurs et les travailleuses, par une minorité, les capitalistes. Dans notre système, les hommes et les femmes sont exploité·e·s car leur force de travail est achetée (via un salaire) puis utilisée par le capitalisme dans le but de faire du profit. Or, pour pouvoir être achetée et utilisée, la force de travail doit être reproduite tous les jours. Dans notre société, ce travail de reproduction est majoritairement réalisé par les femmes. Pour Koechlin, « [o]n doit défendre l’idée d’un système intégré et combiné des différents rapports de domination ancrés dans l’histoire et les sociétés considérées (…). Ce système intégré a pour base matérielle un mode de production et un mode de reproduction qui sont corrélés »[15]. Ainsi, le lien entre exploitation des femmes et exploitation capitaliste doit passer par la prise en compte de la reproduction sociale[16].
Si Marx s’est attaché à théoriser en profondeur l’oppression et l’exploitation de la classe des travailleurs dans la production, il a très peu analysé les mécanismes de reproduction et le caractère genrée de la division du travail, ce qui l’a conduit à ne pas tenir compte de l’exploitation particulière des femmes dans le mode de production capitaliste. Pourtant, le travail reproductif est tout aussi central pour la course au profit des capitalistes que le travail productif, puisque ce dernier en dépend directement. Le travail reproductif peut être compris comme l’ensemble du travail qui produit et reproduit la force de travail (ou, pour le dire autrement, qui produit « des travailleur.euse.s »). C’est donc la production et la reproduction de la main d’œuvre : enfanter, éduquer, faire le ménage, etc. Des tâches aujourd’hui majoritairement effectuées par des femmes, de manière sous-payée ou gratuitement. Ces tâches sont tellement intégrées à une division du travail basée sur le genre qu’elles en viennent à être naturalisées comme réservées aux femmes.
On retrouve principalement ce type de travail reproductif au sein de 3 espaces : (1) la famille, où la femme assume la reproduction au travers de la procréation mais également au travers du care du noyau familial. (2) Le service public, qui prend en charge la production et la reproduction de la force de travail au travers, par exemple, des soins de santé et de l’éducation (dans des métiers salariés majoritairement occupés par des femmes). (3) Dans des organismes privés, des entreprises, où le travail reproductif effectué par les femmes est utilisé pour faire des profits. Le meilleur exemple est le service à la personne, secteur très féminisé et racisé, où l’on observe une superposition des oppressions de genre, de race et de classe. L’exploitation spécifique des femmes provient du fait que
le capitalisme tend à réduire au minimum ce travail reproductif et à faire en sorte qu’il soit le moins cher possible, en ne le rémunérant pas directement, mais indirectement, via les salaires du travail salarié. C’est pourquoi, aussi, une partie du travail reproductif est prise en charge par l’Etat, externalisée de la sphère familiale pour être mutualisée, et donc coûter moins cher[17].
Il est important de noter que, selon les théoriciennes sur lesquelles se base Koechlin, la gratuité du travail de reproduction, notamment au sein du noyau familial, est à la base même de la possibilité du maintien de l’ordre capitaliste.
Pour l’autrice, « c’est donc l’assignation des femmes à la reproduction sociale qui fonde matériellement l’oppression et l’exploitation des femmes »[18]. Il s’ensuit que, si le système dans lequel nous évoluons peut être compris à partir des privilèges patriarcaux qui favorisent à de nombreux égards les hommes sur les femmes (les hommes ont des avantages du fait de leur position sociale, ce qui leur permet par exemple de ne pas effectuer une grande partie du travail reproductif), il n’en demeure pas moins que l’objectif de la lutte doit bien être le système capitaliste, car c’est ce système qui est intrinsèquement patriarcal et produit et reproduit ces privilèges.
De l’importance de la grève comme outil de lutte anticapitaliste et féministe
Retour en Belgique, mars 2021. Qu’il s’agisse des revendications féministes de la grève de ce 08 mars ou de celles qui ont porté sur les négociations de l’accord interprofessionnel (AIP)[19] le 29 mars, l’ouvrage de Koechlin permet de comprendre leurs enjeux sous-jacents.
En Belgique depuis quelques années, le 08 mars est aussi devenu une journée de grève féministe. Sous l’impulsion de différents acteurs et actrices (collecti.e.f 08 mars, marche mondiale des femmes, une partie des organisations syndicales), un nombre sans cesse plus important de femmes a rejoint le mouvement de grève. Parmi les revendications centrales de ces collectifs, on retrouve celles dénonçant le manque d’infrastructures publiques qui impactent directement les femmes (crèches, accueil pour la petite enfance, homes, etc.) et celles dénonçant le maintien de fortes inégalités de genre concernant le travail domestique. Les organisations défendent d’étendre la portée de la grève au travail reproductif, contribuant ainsi à visibiliser des oppressions encore trop souvent naturalisées.
De plus, cette année a été particulière. La journée de grève du 08 a été suivie d’une journée de grève nationale interprofessionnelle deux semaines plus tard. En effet, dans ces deux évènements, on retrouve directement les enjeux liés au travail des femmes et notamment à sa considération et sa rémunération. Par exemple, une des revendications principales des syndicats sur l’accord interprofessionnel touche à l’augmentation du salaire minimum à 14 euro de l’heure. Or, les secteurs peu valorisés et mal rémunérés sont principalement occupés par des femmes. L’augmentation des salaires et notamment des bas salaires est donc particulièrement une lutte pour les travailleuses. Par ailleurs, c’est aussi la question de la répartition du travail qui se pose. La question du temps partiel est en ce sens exemplaire. Si les temps partiels sont souvent imposés par les employeurs, ils sont souvent subis de façon plus subtile. C’est parce que c’est sur les femmes que reposent les tâches domestiques qu’elles « font le choix » de ne pas exercer un temps plein hors du foyer. On en revient donc logiquement à poser la question de l’intégration du mouvement féministe au mouvement ouvrier, une intégration qui ne peut aucunement prendre la forme d’une soumission, si l’on considère que le travail productif et le travail reproductif sont des enjeux inextricablement liés. Pensées à travers une stratégie commune, marxiste et féministe, ces mobilisations sociales peuvent ainsi être porteuses de nouvelles convergences inclusives. La tactique de la grève, une fois cette analyse posée, s’avère être un outil de lutte plus rassembleur qu’à première vue… et ainsi résolument révolutionnaire.
Notice bibliographique
Sociologue de formation, Pauline Feron travaille depuis dix ans sur les politiques sociales et plus spécifiquement sur les questions relatives à la précarité. Au Mexique puis en Belgique, elle milite pour la défense des droits humains et en particulier ceux des femmes.
- [1] Je travaillais alors pour une ONG qui accompagne des organisations de défenseur.euse.s des droits humains (Peace Brigades International) dont certaines sont notamment engagées dans les luttes contre les violences faites aux femmes et les féminicides.
- [2] Koechlin Aurore, La révolution féministe, Paris, Éditions Amsterdam, 2019. Dans la suite du texte, les citations de Koechlin renvoient à cette édition.
- [3] En 1995, Susana Chávez écrit un poème contenant la phrase « Ni una mujer menos, ni una muerte más » (« pas une femme de moins, pas une morte de plus ») qui est repris lors des manifestations sous le slogan « ni una mas » ou « ni una menos » – qui donne son nom à un large mouvement de manifestations suite au féminicide de Chiara Paez en Argentine en 2015.
- [4] Citons notamment le mouvement Non Una di Meno en Italie, la lutte pour l’égalité des salaires en Islande, la grève des femmes du 8 Mars, le mouvement international MeToo et la mobilisation pour le droit à l’avortement en Irlande.
- [5] Koechlin définit la stratégie comme « la vue d’ensemble de la politique » (Koechlin, op. cit., p.114). En d’autres termes, l’horizon politique global que se donne un mouvement donné. Pour l’autrice, c’est la stratégie qui oriente l’ensemble des tactiques quotidiennes – les moyens et les outils – mises en œuvre pour répondre à des situations politiques concrètes. En distinguant la stratégie de la tactique, l’autrice insiste sur l’importance de considérer que les tactiques s’inscrivent nécessairement dans une stratégie politique à plus long terme.
- [6] Pour Koechlin, la première vague commence fin du XIXème-début du XXème siècle et porte avant tout sur la lutte pour les droits politiques, la deuxième se déploie dans les années 60 et concerne la lutte pour la liberté à disposer de son corps, et la troisième a lieu dans les années 90 et se concentre sur l’apport du croisement des différentes oppressions.
- [7] Koechlin, op. cit., pp. 117-125.
- [8] Ibid., p.121.
- [9] Koechlin a milité dans le milieu intersectionnel parisien dans les années 2010.
- [10] Notons qu’il n’y a pas « un mouvement » intersectionnel uniforme, mais une multitude d’adaptations de la théorie dans les pratiques militantes concrètes.
- [11] Koechlin, op. cit., p.149.
- [12] Koechlin, op. cit., p.149.
- [13] Suivant la vision plus précise d’une consubstantialité des rapports sociaux proposée par Danièle Kergoat. Voir à ce sujet : Kergoat Danièle, Se battre, disent-elles…, Paris, La Dispute, 2012.
- [14] Collectif Ni Una Menos, « Comment s’est tissé l’appel à la Grève Internationale de Femmes ? », Contretemps, mars 2017, URL : https://www.contretemps.eu/greve-internationale-femmes/, consulté le 3 mai 2021.
- [15] Koechlin, op. cit., p.149.
- [16] Koechlin se base sur deux autrices dont elle fait la synthèse pour développer sa théorie de la reproduction sociale : Silvia Federici et Lise Vogel. A ce sujet, voir : Federici Silvia, Le capitalisme patriarcal, Paris, La fabrique, 2019 ; Vogel Lise, Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory (1983), Chicago, Haymarket Books, 2013.
- [17] Koechlin, op. cit., p. 101.
- [18] Ibid., p.99.
- [19] Les négociations de l’AIP (accord interprofessionnel) ont lieu tous les deux ans en Belgique. Il s’agit des négociations paritaires entre représentants des travailleurs et des patrons sur l’augmentation des salaires et sur les conditions de travail dans le secteur privé.