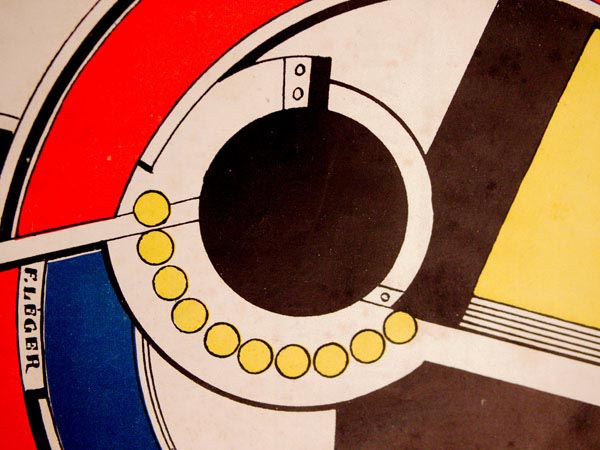INTRODUCTION
La nature de la problématique de l’obsolescence programmée[1] est une question qui, à l’heure où cette pratique commence à faire l’objet de législations spécifiques[2] en Europe, demeure teintée d’opacité. L’OP, pratique initialement définie par la réduction planifiée de la durée de vie des productions distribuées sur le marché, est de fait un phénomène qui fait l’objet d’un échantillonnage complexe de ses définitions : on distingue souvent trois formes d’OP (l’obsolescence technique, l’obsolescence indirecte et l’obsolescence psychologique), toutes abordables en fonction d’une multiplicité d’angles d’approches différents (éthique, social, économique, environnemental, communicationnel, juridique) et en fonction d’intérêts parfois très divergents (décroissance, production verte, nouveaux business models, relocalisation des circuits de production, etc.)[3]. Autant de niveaux où peuvent facilement s’engouffrer les tentatives de compréhension et les stratégies d’opposition à ce paradigme : il n’est en effet pas rare de voir converger sur l’OP des organisations qui, pourtant, ont des diagnostics et des finalités totalement divergentes. Précisément, pour éviter de nous voir enfermés dans des alternatives analytiques trop contraignantes, ou dans des associations d’idées douteuses, il faut se demander s’il n’est pas possible de poser le débat sur une base plus transversale, qui prenne appui sur une compréhension globale du phénomène.
L’objet de cette analyse est, à ce titre, double : d’abord, tenter de resituer la problématique sociétale posée par l’OP dans un cadre d’analyse socio-politique général, qui fasse droit à son inscription dans les structures et logiques du capitalisme dominant ; ensuite, sur base de cette première mise en lumière, tenter de repenser l’enjeu « citoyen » lié à cette problématique, et de cette façon délimiter un territoire légitime de lutte citoyenne/associative face à l’OP. Une telle visée a son utilité tant, étant presque par essence une pratique non déclarée, l’OP nourrit conjointement des difficultés analytiques et des fantasmes, allant parfois jusqu’à alimenter des théories conspirationnistes (postulant l’existence d’un complot des industriels pour léser les gens du peuple) ou, suivant un autre extrême, des positions de déni (l’obsolescence programmée ne serait qu’un mythe inventé par les consommateurs). Cette analyse gagnera en effet sa légitimité si elle parvient à désengager une idée qui, tendanciellement, soutient que tous les positionnements en faveur d’une lutte contre l’OP sont positifs car favorables à une économie plus humaine et plus verte, supposant par-là qu’ils seraient pris au bénéfice des citoyens en augmentant leur pouvoir d’agir sur l’industrie et la distribution. En fait, l’OP elle-même fut, à l’origine, pensée comme un plan qui « rectifierait les inégalités fondamentales de notre système économique actuel », et ce en limitant la durée de vie des objets non dans un but de maximisation des ventes (et donc d’accumulation du capital), mais bien dans l’idée de stimuler une production capable de fournir aux travailleurs/ouvriers « un emploi régulier rémunéré par un salaire minimum leur assurant le niveau de vie américain »[4]. En outre, depuis les combats pour l’augmentation de la durée de la garantie légale jusqu’aux différents processus d’économie circulaire visant à améliorer la gestion des déchets générés par la production, en passant par les projets de labels anti-OP et de mise en garde sur la durabilité, il nous semble que l’orientation majeure des luttes contre l’OP est, en réalité, celle d’une protection du consommateur. À ce titre, c’est en réalité une lutte qui revient de droit aux organismes de protection des consommateurs. L’OP semblerait ainsi devenir l’enjeu d’une lutte entre producteurs et consommateurs. Si, en revanche, l’on considère qu’une lutte citoyenne y a un motif d’engagement, il faut révéler en quoi l’OP participe activement d’une oppression plus générale diminuant la puissance d’agir des individus : en un sens, il faut réintroduire l’OP comme rouage d’un système lui-même oppressif, et déceler en quoi une intervention à ce niveau permettrait d’en gripper le fonctionnement, d’en empêcher les effets, d’en conjurer l’exercice.
L’OP touche avant tout au problème de la durabilité des objets de consommation. Pour comprendre de quelle façon la question de la durée de vie des objets joue un rôle clé dans une domination sociale que régit le système de la consommation, il faut d’abord mettre en lumière le caractère oppressif de ce même système traditionnellement nommé « société de consommation ». Telle sera donc notre première étape qui nous permettra, dans un second temps, de penser l’enjeu de la durabilité. Enfin, nous tenterons de conclure sur la zone d’intervention légitime pour un travail comme celui de l’éducation populaire, à savoir la politisation du problème de la consommation.
CONSOMMATION ET PERSONNALISATION
« La consommation astreint l’individu à se prendre en charge, elle le responsabilise, elle est un système de participation inéluctable […]. Quelle que soit sa standardisation, l’ère de la consommation s’est révélée et continue de se révéler un agent de personnalisation, c’est-à-dire de responsabilisation des individus en les contraignant à choisir et changer les éléments de leur mode de vie. »[5] Cette thèse de Lipovetsky pourrait servir de première matrice à un concept de la consommation comprise comme sphère de pouvoir : plus que d’être l’une des activités élémentaires de tous les sujets du capitalisme, la consommation serait une astreinte commandant aux individus un certain nombre de prescrits sociaux, comportementaux, individuels et collectifs. Il est, au fond, depuis longtemps évident que la consommation fonde l’un des systèmes-clé du capitalisme : l’imposante littérature sur le thème de la société de consommation[6], de même que la récurrence de son usage dans les discours alternatifs, ont permis d’en faire l’un des poncifs les plus usités de la critique du capitalisme. Loin d’être un pur stéréotype, l’injonction omniprésente de la consommation est en effet l’une des caractéristiques centrales de l’hégémonie de ce dernier, car par-delà le fait qu’elle soit l’une des conditions sine qua non au bon fonctionnement du marché (si bien que, au sein de la société de marché, les citoyens sont majoritairement réduits à la catégorie des consommateurs, et ce dans un geste identique à celui qui opère une réduction systématique des enjeux socio-politiques fondamentaux du vécu quotidien des citoyens à celui de l’augmentation du pouvoir d’achat), elle définit aujourd’hui l’un des territoires essentiels où les citoyens (de même que les associations) entendent rétablir un rapport de force avec les dynamiques « aliénantes » du capital. Rendre au consommateur son pouvoir d’intervention et de décision sur la gestion de la production et du système d’accumulation qui en dépend est la ligne suivie par des initiatives aussi diverses que, suivant une liste non exhaustive, les appels au boycott, les class-actions contre les infractions commerciales et/ou industrielles, les campagnes de sensibilisation aux enjeux de la production/consommation équitable et éthique, les initiatives DIY et les collectifs de réparateurs, les ateliers citoyens, etc. Bien entendu, la lutte contre l’OP intègre cette ligne d’action bigarrée, représentative du poids symbolique que la société de consommation représente pour le champ social.
Mais, précisément, comment la consommation est-elle devenue le lieu d’une telle mobilisation, et en fonction de quelles forces idéologiques, sociales et culturelles semble-t-elle avoir, au fil des décennies, polarisé des oppositions politiques majeures : entre des consommateurs opprimés et des producteurs dominants, entre des consommateurs « heureux » et des consommateurs lésés, et entre des producteurs mineurs et des producteurs surpuissants imposant des modèles et des logiques qui, à travers leur hégémonie commerciale, culturelle et symbolique, formatent les structures fondamentales de la société ? Que l’acte de consommer soit peut-être l’impératif social le plus imposé dans les sociétés capitalistes pourrait suffire à le considérer comme la source d’oppression la plus directe de ces mêmes sociétés et, par là même, comme un motif de résistance assez évident : s’émanciper de l’injonction à consommer semble vite être aussi impératif que la consommation elle-même. Mais peut-on aller jusqu’à dire que la logique d’une consommation responsable et « appropriée » (au propre comme au figuré), celle d’un « prosommateur »[7] qui intervient consciemment dans ses pratiques de consommation, puisse changer le système de la consommation dans ses effets, ou permettre aux individus de s’en émanciper ? Suivant Lipovetsky,
il ne faut pas surévaluer la portée des phénomènes actuels de prise en charge directe par les intéressés de leurs propres affaires : la responsabilisation et la participation poursuivent seulement leur œuvre mais selon un dispositif plus personnalisé encore. […] le do-it-yourself, les ventes en kit, les groupes d’auto-assistance, le self-care n’indiquent pas la « fin imminente » de l’expansion du marché, de la spécialisation et des grands systèmes de distribution, ils ne font que personnaliser à l’extrême la logique de la consommation.[8]
La consommation alternative, au lieu de permettre une émancipation de la culture de consommation, en serait en fait l’expression la plus aboutie. La problématique de la « personnalisation » par la consommation renvoie, chez Lipovetsky, au problème plus général du paradigme actuel de gouvernance des populations, c’est-à-dire aux problèmes des dispositifs de pouvoir aujourd’hui mis en place pour « gouverner » les populations des sociétés démocratiques contemporaines : avec de nombreux auteurs, il estime que la consommation occupe une place fondamentale dans l’évolution des logiques disciplinaires classiques aux sociétés capitalistes vers des logiques de contrôle qui mobilisent les désirs, les corps, les libertés et les identités pour maximiser la docilité et la productivité des individus et ce en s’articulant au plus près de leur individualité et de la façon dont ils entendent l’exprimer.
Selon ses propres termes, la personnalisation désigne cette « nouvelle façon pour la société de s’organiser et de s’orienter, nouvelle façon de gérer les comportements, non plus par la tyrannie des détails mais avec le moins de contrainte et le plus de choix privés possible, avec le moins d’austérité et le plus de désir possible, avec le moins de coercition et le plus de compréhension possible »[9]. De ce point de vue, l’univers de la consommation, et ce jusque dans les pratiques qui visent à y intervenir personnellement (en améliorant l’objet, en sélectionnant sa qualité ou son éthique de production, etc.), est l’expression la plus directe de cette hyper-possibilité du « choix » qui sert de base à cette « gouvernance » du contrôle : la consommation de masse charrie l’idée d’une liberté, d’une puissance identitaire de différenciation pour chaque individu (ma consommation me correspond, elle indique « qui » je suis), d’un pouvoir infini de construction de soi et de son environnement. De cette façon, les revendications politiques des consommateurs dont nous faisions état ci-avant sont, plus qu’un mouvement de contestation des logiques du capital, les symptômes les plus directs de ce « procès de personnalisation » décrit par Lipovetsky : elles renvoient toutes, directement ou indirectement, au désir d’une production et d’un marché ajusté aux choix, envies et desideratas personnalisés des consommateurs. En des termes plus directs, elles maintiennent et défendent l’idée qu’un salut demeure possible par la consommation, même s’il faudrait que celle-ci soit mieux pensée, vécue, distribuée. C’est ce qui conduit notre auteur à dire que
La récession présente, la crise énergétique, la conscience écologique ne sonnent pas le glas de l’âge de la consommation : nous sommes voués à consommer, fût-ce autrement, toujours plus d’objets et d’informations, de sports et de voyages, de formation et de relationnel, de musique et de soins médicaux. C’est cela la société post-moderne : non l’au-delà de la consommation, mais son apothéose, son extension jusque dans la sphère privée, jusque dans l’image et le devenir de l’ego appelé à connaître le destin de l’obsolescence accélérée, de la mobilité, de la déstabilisation.
Et d’aller même plus loin, en affirmant que nous serions déjà dans une phase avancée de ce procès capitaliste, c’est-à-dire dans une phase ayant déjà intégré la critique de l’opulence et des risques de la surproduction :
Tout cela a fait place, dit-on, à une culture post-moderne décelable par plusieurs traits : recherche de la qualité de la vie, passion de la personnalité, sensibilité verte, désaffection des grands systèmes de sens, culte de la participation et de l’expression, mode rétro, réhabilitation du local, du régional, de certaines croyances et pratiques traditionnelles.[10]
Il n’est pas utile pour nous d’approfondir outre mesure cette hypothèse. Elle nous permet en revanche de formuler deux jalons analytiques à notre avis utiles à un repositionnement de la problématique de l’obsolescence programmée, et ce en tant qu’elle participe aux fondements mêmes de la logique de consommation.
- D’abord, il nous semble en effet pertinent de relever que le renforcement de l’implication de l’individu dans ses pratiques de consommateur relève plus d’une logique de différenciation interne à celle de la consommation que d’une contestation de son fondement : les prosommateurs sont, dans cette perspective, un ensemble mercatique singulier pour lequel il existe un marché spécifique. Ce marché pourrait être désigné par différents traits caractéristiques : durable, réparable, singularisé, local, garanti, écologique, équitable, multifonctionnel, et – justement – non obsolescent.
- Les objets, leurs modes d’existence spécifiques, de même que les pratiques qu’ils supposent définissent – en particulier à travers le prisme de leur consommation – toute une sociologie de la distinction. En tant que la consommation participe à l’institution de la société démocratique contemporaine et de ses dispositifs de pouvoir, elle ne peut manquer d’intervenir dans ce qui assure à cette même société sa reproduction, c’est-à-dire à son système de classes. Pour Baudrillard, il s’agit de « saisir dans la consommation une dimension permanente de la hiérarchie sociale »[11]. Cette seconde hypothèse est fondamentale pour repérer ce qui, dans la consommation, concerne véritablement les luttes d’émancipation sociale, ce qui définit un territoire légitime pour des pratiques comme celles de l’éducation permanente.
Nous allons maintenant tenter d’expliciter plus précisément pourquoi l’OP joue – ici – un rôle clé dans cette logique.
REPOSITIONNER L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
a. Comme fonction de gaspillage
Sur base des deux jalons que nous venons d’énoncer, nous pouvons donc tenter de remonter vers l’OP à partir d’une nouvelle base d’analyse. En effet, l’OP conjugue elle aussi, dans son principe, deux fonctions essentielles : assurer la réitération « infinie » de la production de façon à en permettre l’abondance, et – par la réduction de la durée de vie des objets produits – conditionner le besoin du consommateur, non pas en augmentant spécifiquement son désir de tel objet, mais en forçant la nécessité de devoir toujours le racheter. Comme telle, l’OP a assuré et assure toujours un dispositif clé de l’économie dite de croissance, qu’on désigne habituellement comme celui de l’abondance. La production de l’abondance, caractéristique du paradigme de la société de consommation, est supposée être garante d’un ordre social économiquement vertueux, où la génération perpétuelle de biens de consommation est articulée à un besoin perpétuel de renouveler l’acte de la consommation lui-même, la satisfaction de ce besoin n’étant accessible qu’à ceux qui disposent des moyens de l’assouvir : consommation et travail salarié (permettant la consommation) sont alors supposés former les deux faces d’une même logique productive. Dans ce contexte, l’OP intervient comme une pratique génératrice d’une catégorie fondamentale de la consommation, à savoir celle de consommation courante, c’est-à-dire ce qui fait de la consommation un acte que l’on répète, même après avoir comblé ce que demande notre subsistance : elle ne concerne donc bien entendu pas les produits qui sont par nature éphémères (comme, par exemple, les biens alimentaires qui, d’ailleurs, se voient imposer une logique inverse à celle de l’OP, parce que l’on cherche à maximiser leur conservation), mais bien ceux qui, sans elle, n’auraient pas à être rachetés souvent (machines et technologies, vêtements, ustensiles, matériaux de construction, etc.). On peut donc dire que l’OP a pour fonction d’assurer la consommation d’une production toujours excédentaire : elle conditionne la possibilité d’une production qui n’est pas strictement limitée au nécessaire ou, autrement dit, d’une production où l’excédent est, précisément, ce qui est « consommé ». Par définition, l’OP a donc, dans l’économie de la consommation, une fonction de gaspillage. Il s’agit là, par voie de conséquence, de l’un des arguments récurrents mobilisé par ceux qui s’y opposent (notamment lorsque la problématique de l’OP rejoint le circuit de l’économie circulaire) : le gaspillage et les déchets générés par l’OP ne sont, selon ces critiques, pas/plus compatibles avec l’enjeu écologique posé aujourd’hui.
Mais, en fonction de nos premières analyses, il semble évident que ce gaspillage ne doit pas être lu comme étant seulement une conséquence négative et accidentelle de la société de consommation : il ne s’agit pas simplement de biens qui auraient été produits pour être consommés mais qui ne l’ont, hélas, pas été. Le gaspillage ne peut pas non plus être compris comme une simple « externalité » de ce système travail-production-consommation. Dans l’hypothèse développée par Jean Baudrillard, il faut plutôt comprendre que le gaspillage y a une fonction fondatrice et incontournable :
Toutes les sociétés ont toujours gaspillé, dilapidé, dépensé et consommé au-delà du strict nécessaire, pour la simple raison que c’est dans la consommation d’un excédent, d’un superflu que l’individu comme la société se sentent non seulement exister mais vivre. [11]
L’OP, dans cette perspective, est au centre d’une tension très importante de l’économie capitaliste, qui concerne une espèce de bipolarité de sa rationalité propre : là où l’économie politique du capital est fondée sur un postulat rationaliste pur[12] (l’idée de « marché » comprend intrinsèquement celle d’être le produit d’un ensemble de choix rationnels), elle semble aussi organiser des dynamiques qui, suivant ce même postulat, devraient être décrites comme irrationnelles (l’OP en est un exemple direct). Une lecture naïve voudrait y voir l’activité d’une contradiction interne à sa composition, mais il nous semble plus pertinent de voir, précisément, combien c’est ce même impératif de rationalité qui conditionne un phénomène tel que celui de l’OP. Ceci ne peut être fait qu’en l’appréhendant « selon une logique sociale beaucoup plus générale où le gaspillage, loin d’être un résidu irrationnel, prend une fonction positive, relayant l’utilité rationnelle dans une fonctionnalité sociale supérieure. »[13] Autrement dit, l’OP a une fonction sociale qui dépasse et englobe sa pure fonction économique. Effectivement, de la même façon que toute économie prend sens dans un cadre qui dépasse la stricte valorisation de faits seulement économiques (si nous pensons aux idéologies, à des déterminations culturelles, aux antagonismes sociaux, aux logiques de domination, etc.), l’OP ne prend pleinement sens qu’en fonction d’éléments externes à la pure rationalité productive (éléments dont les questions naïves, présentes au moins de façon latente chez tous les consommateurs, indiquent bien l’extériorité qu’elles ont par rapport à la rationalité économique : pourquoi produire pour gaspiller ? Pourquoi acheter pour jeter ? Pourquoi volontairement limiter la durée de vie d’un objet ? etc.). C’est donc cette logique sociale de la consommation qu’il faut élucider.
On sait que le postulat économiste du capitalisme néo-libéral peut être formulé comme la tentative systématique de ne rien laisser en dehors de la sphère productive capitalisable. Il faut voir la fonction de gaspillage propre à l’OP comme prenant sens à l’intérieur même de ce paradigme, et voir que « dans cette perspective se profile une définition de la « consommation » comme consumation, c’est-à-dire comme gaspillage productif [nous soulignons] – perspective inverse de celle de l’ « économique », fondé sur la nécessité, l’accumulation et le calcul, où au contraire le superflu précède le nécessaire, où la dépense précède en valeur (sinon dans le temps) l’accumulation et l’appropriation »[14]. Que peut bien produire le gaspillage ? Il produit de la valeur par différenciation (entre ce qui peut être gaspillé et ce qui ne peut pas l’être), il produit les conditions pour qu’une valeur symbolique persiste dans l’appropriation des objets (la possibilité de gaspiller un produit fait écho à la liberté d’en disposer et de le consommer, et donc à la liberté fondamentale du consommateur), il institue la dépense comme étant supérieure à la possession et l’utilisation, comme étant la fonction première de l’économie (la rationalité du marché repose sur la production et la dépense, non sur ce qui est produit ni sur comment cela est utilisé) : en un sens, le gaspillage est ce qui autorise toute « valeur ajoutée » à la production. En effet, si l’on s’en tient, dans l’analyse, à l’idée que la consommation est la stricte résultante d’un ensemble de besoins des consommateurs, tout ce qui ne serait pas destiné à la stricte survie du consommateur pourrait être considéré comme une forme de gaspillage. On peut d’ailleurs aller plus loin et dire que tel est bien le cas : la valeur de la marchandise n’a de sens que dans le gaspillage qui est une preuve – inversée – du fait que l’économie produit de la surabondance (on ne peut jeter que ce qui n’est pas rare). Si bien que le marché de l’abondance comprend, intrinsèquement, l’idée d’une destruction ou d’une « consumation »[15] de ses biens ; consumation qui rappelle le caractère somptuaire des dépenses aristocratiques et leur logique distinctive : les biens inutiles sont ceux qui ont le plus de valeur (non pas à cause d’une supposée valeur intrinsèque, mais bien par la dépense qu’ils représentent) ou, en des mots plus simples, ils sont « l’apanage des riches ». La société de consommation n’a fait qu’élargir cet impératif du gaspillage, l’a rendu démocratique, en a fait l’horizon d’une égalité des masses obtenue par l’abondance somptuaire d’un gaspillage souverain désormais accessible à tous (en théorie). C’est du moins le sens que Baudrillard attribue, comme tel, à l’OP dans sa fonction propre :
Ce gaspillage […] ne fait que doubler, sur le plan culturel, un gaspillage beaucoup plus fondamental et systématique, intégré, lui, directement aux processus économiques, un gaspillage fonctionnel et bureaucratique, produit par la production en même temps que les biens matériels, incorporé à eux et donc obligatoirement consommé comme une des qualités et des dimensions de l’objet de consommation : leur fragilité, leur obsolescence calculée, leur condamnation à l’éphémérité. Ce qui est produit aujourd’hui ne l’est pas en fonction de sa valeur d’usage ou de sa durée possible, mais contraire en fonction de sa mort, dont l’accélération n’a d’égale que celle de l’inflation des prix. Cela seul suffirait à remettre en question les postulats « rationalistes » de toute la science économique sur l’utilité, les besoins, etc.[16]
On peut donc dire que l’OP a pour fonction d’assurer une valeur somptuaire à la consommation de masse : en ce sens, elle est peut-être ce qui signe l’apogée glorieuse de l’économie bourgeoise dont la formule pourrait, cyniquement, être décrite par « prodigalité pour tous ! ».
Mais, au même moment où l’OP assure à la consommation cette valeur somptuaire qu’elle démocratise, elle reproduit – à travers le système des objets – une distinction de classe.
b. Comme outil de distinction/différenciation sociale
Nous devons, si nous voulons éprouver notre hypothèse jusqu’au bout, tenter de synthétiser les deux apports critiques ici mis en lumière : d’abord que l’OP assure au système travail/production/consommation sa fonction de gaspillage ; ensuite que les luttes contre l’OP – essentiellement polarisées par les impacts négatifs que ce gaspillage induit – sont symptomatiques du « procès de personnalisation » intrinsèque à ce même système, et y participent donc en droit comme en fait. Avec Baudrillard, nous avons pu établir que c’est seulement en remontant jusqu’à la logique sociale globale impliquée par ce système que l’OP peut prendre sens. Cette logique peut être énoncée simplement en disant qu’il y a, dans les sociétés capitalistes, contrainte de consommation même si, « bien sûr, cette contrainte systémique est placée sous le signe du choix et de la » liberté » »[17] (ce que Lipovetsky nommait « personnalisation »). Si bien que, à l’instar de nombreuses luttes contemporaines, vouloir réintroduire plus de choix et plus de liberté pour le consommateur – ne serait-ce que pour qu’il devienne un consommateur « responsable » – apparaît, en fait, comme un approfondissement de cette même logique et n’engage en rien une possibilité de s’en émanciper. La vision d’une consommation qui ne serait que la pure continuité d’un ensemble de besoins naturels dont le capitalisme aurait, progressivement, aliéné ou détourné la fonction manque complètement le fait que toutes les sociétés s’articulent non pas sur la satisfaction des besoins supposés primaires de sa population, mais bien sur la génération perpétuelle de son excédent, ce qui explique que l’abondance n’est en rien contradictoire avec la plus grande misère : plus de pouvoir dans la consommation n’a rien à voir avec plus de redistribution.
Il faut donc remonter jusqu’à la logique sociale globale, ce qui implique de considérer combien
Tout cela n’est que l’effet caractéristique, au niveau des individus, d’une certaine structure de productivité monopolistique, d’une économie totalitaire (capitaliste ou socialiste), acculée à faire surgir le loisir, le confort, le standing, etc., bref, l’accomplissement même de l’individu privé comme force productive, contrainte de lui extorquer sa liberté et sa jouissance comme éléments fonctionnels de reproduction du système de production et des rapports de pouvoir qui le sanctionnent.[18]
Dans ce cadre, l’OP fait partie des éléments qui permettent à cette contrainte d’opérer : nous sommes aussi libres de consommer que nous sommes libres de travailler, c’est-à-dire pas du tout. La reproduction des rapports de pouvoirs qui sanctionnent le système de production dont parle Baudrillard ne désigne rien d’autre que les rapports de pouvoirs qui lient les classes opprimées et les classes dominantes : les objets, leur production et leur consommation sont tout autant mobilisés à instituer ces distinctions sociales que ne le sont les lois spécifiques à la division sociale, la distribution des privilèges en fonction de critères ethniques, sociaux, de genre, culturels, etc., l’inégalité de distribution des richesses, les modèles culturels dominants, etc.
De quoi l’OP peut-elle, dans ce cadre, être le signe ? La durabilité des objets consommés pourrait être lue comme la trace « physique », en dur, du statut social de l’individu qui les possède : l’objet durable, depuis le bijou jusqu’au bâtiment, est historiquement l’une des dimensions fondamentales de l’hérédité sociale (leur durée dans l’histoire contribue d’ailleurs, souvent, à en augmenter la valeur). Les objets durables, surtout s’ils sont de haute valeur, semblent témoigner de la position sociale supérieure de leur possédant (cf. le mythe de la Rolex comme trace de la réussite sociale) et participer de l’inertie de celle-ci. De ce point de vue, l’OP (qui opère une réduction volontaire de la durabilité des objets) devrait apparaître comme une forme d’hérésie, eu égard aux normes de la domination bourgeoise et de ses apparences. Or, ce n’est qu’une apparence puisque, paradoxalement, les luttes ayant l’OP pour objet – luttes plutôt récentes – ne sont pas très présentes dans la haute bourgeoisie et tendent, plutôt, à fleurir dans les recherches d’alternatives au système économique dominant, elles-mêmes portées majoritairement par des fractions « marginalisées » de la classe bourgeoise (ou, suivant l’appellation courante, par la « classe moyenne »). Autant dire que l’OP semble, donc, ne poser aucun problème fondamental aux classes dominantes. Cela s’éclaire en considérant en quoi ce paradoxe n’est qu’apparent tant, dans son format contemporain, la réussite sociale et économique est autant, voire davantage liée à la mobilité sociale qu’à l’assise ostentatoire des richesses, même si cette dernière garde toute sa puissance démonstrative : changer souvent, évoluer sans cesse, être flexible et adapté aux aléas de normes changeantes, sont aujourd’hui autant de traces de l’accomplissement social et personnel.
Cette évolution, donc, se traduit aussi dans la consommation courante, dont nous avons vu que l’OP était une condition essentielle :
Cette fonction d’inertie des objets, résultant en un statut durable, parfois héréditaire, est aujourd’hui combattue par celle d’avoir à signifier le changement social. A mesure qu’on s’élève dans l’échelle sociale, les objets se multiplient, se diversifient, se renouvellent.[19]
L’obsolescence accélérée par leur conception (obsolescence technique) ou par la mode (obsolescence psychologique) des objets consommés, agit alors, symboliquement, comme pouvait le faire la durabilité : elle trahit à travers les objets physiques et leur visibilité ce besoin social de signifier le changement. Avoir l’occasion de renouveler souvent le décor usuel de son existence peut, en ce sens, contribuer à donner le sentiment d’une mobilité sociale réelle : tel objet chic donne le sentiment d’un progrès de statut, et la réitération de son achat, une fois le nouveau modèle disponible, entretient cette même idée de progression sur l’échelle sociale, même lorsque cette mobilité n’existe pas du tout sinon comme pure illusion. La mobilité formelle des signes de la consommation (par exemple, la capacité de se payer des objets « de riches » et de jeter ceux qui correspondent à notre statut social réel, lui-même défini par nos différents capitaux social, économique et culturel) n’implique pas du tout une mobilité des structures sociales réelles, mais tend plutôt à en offrir le simulacre. Comme le dit Baudrillard,
Tous les objets sont révocables devant l’instance de la mode : cela suffirait à créer l’égalité de tous devant les objets. Or, ceci est bien évidemment faux : la mode, comme la culture de masse, parle à tous pour mieux remettre chacun à sa place. […] Elle se veut au-delà de la logique sociale, une espèce de seconde nature : en fait, elle est toute entière régie par la stratégie sociale de classe. L’éphémérité « moderne » des objets (et autres signes) est en fait un luxe d’héritiers.[20]
C’est de cette façon que l’OP, en plus d’assurer une consommation courante fondée sur le gaspillage, assure à la consommation sa logique de domination sociale : pour pouvoir progresser sur l’échelle sociale en grimpant l’échelle des objets, ceux-ci doivent pouvoir être gaspillés toujours plus, toujours plus vite, de façon à ce que les pratiques d’économie propres aux classes dominées soient ordonnées au faste et à l’éphémère que les classes dominantes peuvent s’autoriser, le durable étant ce qu’elles possèdent déjà « par nature », c’est-à-dire par héritage. Telle est la fonction discriminante de l’OP : « dans le système culturel de classe […], cette relation [entre éphémère et durable] éclate en deux pôles distinctifs, dont l’un, l’éphémère, s’autonomise en modèle culturel supérieur, renvoyant l’autre, le durable, à son obsolescence, et aux aspirations d’une majorité naïve »[21]. Au stade de l’histoire occidentale où une partie beaucoup plus importante de la population précarisée serait en mesure (et en droit) de se payer des objets/biens durables et transmissibles aux générations qui lui succèdent (l’imaginaire d’un système de production non polarisé par l’OP le postule), le capitalisme dominant promeut une consommation ordonnée à l’éphémérité et l’obsolescence des biens produits, tout en présentant celle-ci comme démocratique, progressiste, vecteur d’égalité. Ce faisant, elle se prémunit de même des critiques adressables à ce système de production : moins d’obsolescence signifie que la consommation deviendrait plus chère, ce qui, par voie de conséquence, serait de la « discrimination » envers les personnes plus faibles économiquement. Ce double standard culturel conditionne alors la problématique dont l’OP est aujourd’hui le nom : que notre économie politique, dans les sociétés dites de démocratie égalitariste, est autant ordonnée à la contrainte de la consommation de masse que le capitalisme est ordonné à l’exploitation de la force de travail par le système du salariat. En peu de mots, que la société de consommation permet une aliénation aussi importante que celle qu’impose le salariat.
POLITISER LA CONSOMMATION
La société de consommation contribue sans cesse à générer ses propres mythes mobilisateurs : associée aux mythologies du progrès technique (qui décrivent l’avènement des technologies comme l’espoir d’un salut, d’une découverte qui sauvera l’humanité), elle ne cesse d’introduire dans le cercle travail-production-consommation l’idée d’un équilibre à venir, l’avènement d’un capitalisme éthique qui soutient tant d’espoirs, revenant à faire de toute idée d’un progrès social celle d’un progrès du consommateur et de sa représentation/compréhension. Toujours suivant Baudrillard, « la consommation est un mythe. C’est-à-dire que c’est une parole de la société contemporaine sur elle-même, c’est la façon dont notre société se parle. »[22] En effet, comment ne pas voir combien, en plus de consommer des marchandises, les individus de la consommation ne cessent de « consommer la consommation » et d’y voir l’espace de leur mobilisation quotidienne, subjectivement autant qu’objectivement : les catégories de liberté, d’égalité, de progrès, d’émancipation, d’autonomie sont toutes, d’une façon ou d’une autre, intégrées au procès de personnalisation d’une consommation qui – par elle-même – ne cesse d’avoir à se consumer pour pouvoir se reproduire – c’est-à-dire pour pouvoir assurer la reproduction du système économique de la consommation elle-même. L’OP est précisément de nature à permettre cette reproduction infinie.
Toute l’efficience d’un mythe repose sur son pouvoir d’ordonner le réel en intégrant à la fois son affirmation et sa négation, son exaltation et sa critique, puisque, si tous les termes du débat appartiennent et s’assimilent à son champ propre, les divisions d’opinions à son sujet ne cessent pourtant pas d’en faire un socle incontournable, une matrice qui enferme toutes les perspectives d’action, y compris celles qui voudraient s’en émanciper.
Comme tout grand mythe qui se respecte, celui de la « Consommation » a son discours et son anti-discours, c’est-à-dire que le discours exalté sur l’abondance se double partout d’un contre-discours « critique », morose et moralisant, sur les méfaits de la société de consommation et l’issue tragique qu’elle ne peut manquer d’avoir pour la civilisation tout entière.[23]
C’est en ce sens que la place de plus en plus immense qu’occupe la consommation dans les luttes citoyennes, faisant du comportement des consommateurs (est-il écologique ou non, éthique ou non, équitable ou non, local ou non, ad nauseam) et de leur pouvoir d’achat l’alpha et l’oméga de la mobilisation politique des citoyens, contribue – pour une large part – à instituer le mythe d’une émancipation par la consommation.
Les luttes contre l’OP prennent malheureusement part à ce procès du travail mythique et opératoire de la consommation, et – enfermées dans les termes de cet amalgame consumériste – tendent à lire dans l’objet de leur mobilisation une instance si décisive qu’elles ne parviennent à leur opposer qu’une moralisation des producteurs, ou, au mieux, de meilleures options de choix pour les consommateurs. S’il ne s’agit bien entendu pas de déclarer ces initiatives inutiles, il convient de relever combien l’exigence qu’elles imposent se condamne à entretenir ce qu’elles tentent pourtant de dénoncer. Le caractère illusoire d’une moralisation effective des producteurs repose, notamment, sur le fait que ces derniers sont – précisément – ceux qui ont le moins d’intérêt à répondre aux critiques des consommateurs, sinon en s’y adaptant par la création de nouveaux marchés, c’est-à-dire par un élargissement de la sphère consommative. A titre d’exemple, l’association française HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), qui déclare à juste titre dans son manifeste que « l’action de l’association ne peut ainsi se contenter de proposer des palliatifs écologiques ou technologiques aux conséquences de l’obsolescence programmée mais vise un changement profond vis-à-vis de la culture consumériste »[24], entama en septembre 2017 une procédure judiciaire pour dénoncer l’OP d’un ensemble d’imprimantes issues de différentes sociétés, dont celles de la société Epson sur qui l’action s’est concentrée. Bien que le procès soit toujours courant, la réaction rapportée par HOP semble confirmer les réserves que nous formulons quant à l’inefficacité des tentatives de moralisation des producteurs : « Chez Epson, on tente de se justifier (bien que ça ne soit pas très crédible) et surtout d’innover avec des imprimantes sans encre… Par ailleurs, ces plaintes donnent envie aux autres entreprises de s’engager dans la durabilité et réparabilité »[25]. La réaction d’Epson confirme bien que, face aux critiques, les sociétés productrices cherchent surtout à répondre par la production de nouveaux secteurs de marché, sans interroger d’une quelconque façon « la culture consumériste ». Là où l’initiative vise fondamentalement à orienter la capacité d’action citoyenne vers la création d’une culture alternative à celle véhiculée par le système de la consommation, la forme adoptée par le combat rétablit le déséquilibre qu’elle entend dénoncer, en plus de renforcer le mythe d’une consommation qui pourrait devenir éthique sans avoir à sortir de sa logique de marché.
Et le véritable travail mythique est là : d’où vient que toutes les dénonciations, tous les discours sur l’ « aliénation », toute la dérision du pop et de l’anti-art sont si facilement « récupérées », c’est qu’elles sont elles-mêmes partie du mythe […].[26]
D’un certain point de vue, ce fait est latent dans toutes ces luttes contre l’OP, tant il leur est vite évident que les seules véritables options de changement reposent soit sur une sortie (radicale) de l’économie capitaliste de consommation, soit sur la liberté de choix des consommateurs, ce qui précisément est impossible dans le cadre de l’économie capitaliste où la consommation est contrainte. Elles en sont d’autant plus conscientes que, ainsi qu’en témoigne implicitement le récit de Thierry Libaert sur la tentative de régulation politique de l’OP au niveau européen entamée en 2013, les seuls arguments qui furent efficaces et favorables à une prise d’action devaient « positionner [la lutte contre l’OP] comme une opportunité en termes réputationnel et commercial pour les entreprises de l’UE », ou encore reposaient sur « l’importance du passage d’une vision « idéologique » à un angle communicationnel, plus encore à la requalification du débat dans un registre – communicationnel, marketing, positif – consistant non à désigner des adversaires mais à suggérer les incidences en termes d’amélioration réputationnelle des entreprises et de meilleure information des consommateurs »[27]. On comprend là, directement, que de telles démarches ont peu de chances de jouer un rôle positif dans une meilleure distribution des privilèges sociaux ou vers une émancipation des dominations sociales dont les consommateurs sont l’objet : elles tendent surtout à façonner de nouvelles stratégies réputationnelles pour des entreprises n’ayant, par ailleurs, aucune intention de sortir du consumérisme.
Que peut bien signifier alors, si nous reprenons l’objectif premier de cette analyse, un territoire de lutte citoyenne légitime sur cette question ? Plus spécifiquement, l’éducation permanente a-t-elle un rôle à jouer par rapport aux dominations qu’implique un phénomène tel que l’OP ? Suivant notre analyse, militer pour une intervention plus active des citoyens dans les schémas de la consommation, si cela peut s’avérer nécessaire, reviendrait souvent à entretenir, voire à approfondir le mythe d’une consommation qui serait apte à suivre une amélioration exponentielle, où toutes les fonctions qu’elle mobilise seraient de mieux en mieux adaptées, de plus en plus organiques. Pire, et cela n’a rien d’un pur fantasme, ces démarches pourraient contribuer au renforcement de la confiance des citoyens dans un système qui – pourtant – est entièrement ordonné à leur domination, et qui – à la lettre – ne pourra que se renforcer par la confiance qu’on lui accorde. La légitimité de ces oppositions devrait, en ce sens, davantage être conquise dans le travail d’une méfiance envers l’éternel procès de renouvellement de la consommation et des progrès que celui-ci est supposé conditionner. La structure de la société de consommation telle que nous en avons ici fait l’esquisse occupe, dans la réalité quotidienne des individus, énormément d’espace et les tensions vécues par ceux-ci dans la réalité de leur consommation sont souvent déjà fortement appréhendées comme une part active de leur domination. Ces tensions vécues qui invitent à une méfiance salutaire envers les lois du système commercial ne devraient pas être « soulagées » par des luttes qui visent à « donner du poids au consommateur », ce qui revient à s’intégrer au mythe émancipatoire de la société de consommation, mais bien par celles qui entendent donner du poids à des logiques qui expérimentent des « sorties » de la consommation, à des moyens de se prémunir de ses illusions et d’en critiquer les effets, à des outils critiques qui permettent d’analyser l’économie politique qui préside à la fonction « consommative ». C’est dans ce chantier qu’une lutte contre l’OP gagne sa justesse, sauf à vouloir être le bras armé culturel du mythe de la consommation participative dont le « client » est toujours dit être « roi » mais dont la souveraineté est aussi factice que celle des travailleurs eu égard aux logiques sociales du travail.
L’autre risque est de voir, sous l’impulsion de cette personnalisation induite par les pratiques « consommatives », l’espace politique formé par les associations se transformer en regroupements de consommateurs. Ceux-ci trouveraient alors, dans le marché, l’opportunité d’intervenir face à l’absence de représentation par le marché de l’un de leurs choix éthiques, devenant par-là les acteurs inconscients d’une extension du marchand sur le non-marchand. En effet, si l’on relève toutes les interventions citoyennes dans l’espace de la consommation, elles se présentent souvent comme ayant été soldées par la création de nouveaux marchés intégrant ce qui n’était, pourtant, pas marchand préalablement :
On voit ici toute la capacité de la société civile ou de l’action publique à élargir cet espace de choix. Les propositions qui en émanent permettent, au terme de processus plus ou moins longs, de multiplier les caractéristiques marchandes pour faire entrer en ligne de compte des éléments au départ non marchands, comme la justice sociale, l’équité économique ou le respect de l’environnement. On trouve, dans l’espace marchand, les traces directes des résultats de ces démarches : les labels bio, les marques du commerce équitable ou les labels environnementaux, les étiquettes-carbone ou les classements écologiques des produits électroménagers témoignent de cet élargissement de la délégation vers de nouvelles caractéristiques.[28]
La société de consommation, prise comme structure fondamentale du capitalisme néolibéral, ne se mesure aux revendications de consommateurs qu’en en intégrant les revendications dans l’ouverture de nouveaux secteurs de marchés. Si les luttes contre l’OP portées par les associations citoyennes y ont un écho, il y a fort à parier que celui-ci sera de nature mercatique et commerciale : ouverture d’un label anti-OP, notification de la pratique de manière à informer le consommateur, développement d’une production d’objets durables et réparables (dont le prix sera, bien entendu, conséquent à cette spécificité), augmentation des durées d’assurance et de garantie, etc.
En revanche, les espaces collectifs que visent à créer les associations d’éducation permanente pourraient trouver leur armature militante dans une politisation de la consommation et ce, primairement, en en déconstruisant les effets et les identités : sur base d’une méthode inductive, il serait en effet possible de partir du vécu de l’injonction à consommer et de chercher collectivement comment le contrer. Il n’appartient pas aux associations d’indiquer de quelle nature devrait être la structure socio-politique convenant aux attentes de leurs publics, mais il leur revient de faciliter la conscientisation des schémas oppressifs qui les concernent et les impactent directement. La nature critique de leur travail devrait aussi les conduire à éviter l’écueil d’une duplicité de leur rôle : par exemple quand, au nom d’une meilleure représentation des classes populaires dans les enjeux de souveraineté du consommateur (par exemple, la souveraineté alimentaire), les associations agissent d’une façon qui pourrait être réinterprétée « comme des formes de contrôle des classes moyennes sur les modes de consommation des classes populaires, ces dernières se voyant [par exemple] imposer de consommer une alimentation faite de produits maraîchers localement produits, qui ne correspondent en rien à leurs habitudes alimentaires »[29]. Si l’OP doit jouer un rôle dans les pratiques d’éducation permanente, c’est bien parce que cette réalité du système productif concentre en son sein de nombreux éléments essentiels au système de la consommation et que leur identification, autant que leur déconstruction, est peut-être la première étape d’une mise à distance du capitalisme et de ce qui lui assure une hégémonie : il nous semble que cette visée peut légitimement s’intégrer dans des activités d’éducation populaire/permanente. En effet, prendre conscience du système qui appelle un phénomène tel que l’OP peut permettre d’enfin considérer que – de la même façon que le travail et son exploitation – la consommation n’est jamais « libre », qu’elle n’appartient pas à la sphère du choix souverain et purement individuel : elle est, au contraire, une astreinte fondamentale du capitalisme. A ce titre, et peut-être bien avant d’être une question liée à l’écologie, elle rejoint la problématique de la recherche d’un système capable de redistribuer les richesses, c’est-à-dire capable de défaire la domination sociale qu’impose notre économie politique. C’est ce que nous voulons désigner par la politisation de la consommation.
CONCLUSION
S’il conviendrait de conclure sur cette suggestion d’orientation politique possible pour l’action associative, nous voudrions néanmoins revenir ici sur les jalons fondamentaux que notre analyse nous semble avoir mis en exergue et qui forment les « insights » critiques essentiels à une problématisation de l’OP comme rouage clé de la société de consommation. Tout d’abord, notons que l’exercice critique que nous avons ici proposé, s’il se veut totalement ancré dans notre présent, a trouvé l’essentiel de sa problématisation dans des ressources qui sont toutes issues des années post-68. Cet événement singulier que fut mai 68 semble avoir engagé dans l’intelligentsia française un mouvement sceptique quant au pouvoir et à l’efficience des tentatives, florissantes à l’époque, pour sortir des schèmes dominants du capitalisme ; schèmes parmi lesquels la société de consommation occupait une place importante. La problématique de l’OP y occupait déjà une place centrale et semblait déjà être perçue comme « vouée à devenir une des fonctions prépondérantes de la société post-industrielle »[30]. La résurgence de cette thématique dans les luttes qui nous sont contemporaines nous semble, plutôt que de signer la non-pertinence de ces théories dont celles de Baudrillard et Lipovetsky ne sont que des exemples, être une invitation à se les réapproprier, maintenant qu’une part importante de leurs intuitions est, à notre avis, largement observable dans la société contemporaine.
Le premier jalon concerne ce que nous avons ici désigné, avec Lipovetsky, comme un procès de personnalisation de la consommation. Il indique combien le champ de la revendication politique, quand elle est celle de consommateurs réclamant une meilleure représentation de leurs désidératas dans le système de la consommation, est en réalité l’expression d’une organisation sociétale qui gère les comportements de ses individus en contraignant ce qui les « personnalise » à prendre la forme d’une expression consommative, c’est-à-dire à trouver pour seules ressources d’expression les pratiques de consommation des individus. Le procès de personnalisation est donc ce qui transforme l’individuation des citoyens, y compris dans leur revendication politique, en formats spécifiques du comportement des consommateurs et, par voie de fait, en secteurs de marché de la consommation (par exemple, dans le cas de l’OP, en créant des secteurs où les caractéristiques comme « le durable », « le réparable », « l’upcycling », « la récupération » définissent des objets et des comportements ciblés par les acteurs du marché). La lutte contre l’OP doit donc être comprise, dans ce cadre, comme potentiellement intégrable (avec toutes les autres « revendications de consommateurs ») dans ce qui assure, justement, à la société de consommation son hégémonie et sa reproduction perpétuelle.
Le second jalon consiste à comprendre, à partir de cette idée de personnalisation, que la société de consommation participe, comme telle, à l’institution sociale et culturelle de nos sociétés contemporaines et que, de ce fait, elle s’intègre tant dans ses dispositifs de pouvoir que dans ses modes de reproduction, c’est-à-dire dans la distinction sociale de classes intrinsèque aux sociétés capitalistes. Et c’est parce qu’elle joue (dans le système économique de la consommation de masse) un rôle prépondérant que l’OP doit être ressaisie comme ayant une fonction dans ces dispositifs instituant la société capitaliste et sa reproduction :
La consommation gaspilleuse est devenue une obligation quotidienne, une institution forcée et souvent inconsciente comme l’impôt indirect, une participation à froid aux contraintes de l’ordre économique.[31]
Nous avons détaillé cette fonction de l’OP comme celle qui assure à la production capitaliste, par gaspillage et consumation des biens produits, sa répétition infinie, tout en conférant – par ce gaspillage – une valeur somptuaire et distinctive aux objets et à leur consommation. Cette valeur de différenciation/distinction sociale de l’OP apparaît quand est analysée en amont la fonction culturelle du fait de « pouvoir jeter ». Ce pouvoir s’accompagne aujourd’hui, en effet, d’une injonction forte à la mobilité sociale (pouvoir souvent renouveler ses objets témoignerait d’une capacité à évoluer dans les classes sociales), là même où cette mobilité repose réellement – en dernier ressort – sur une distinction sociale qu’on sait fondamentalement inégalitaire (les moyens consommatifs disponibles pour chaque individu étant dépendant, pour une très large part, de leur niveau socio-économique et culturel et donc, à terme, de leur classe sociale particulière). En ce sens, même gaspillés et gaspillables, les objets persistent – à travers des usages de consommation différenciés – à témoigner de la variation des statuts sociaux organisant la société. Ceci étant compris, les grands enjeux de l’OP que sont la durabilité, la réparabilité, la valeur d’usage doivent aussi être compris comme ayant un rôle important dans le jeu de distinction sociale propre à la société de consommation.
Ces éléments établis, s’ils ne fournissent pas une feuille de route précise pour intégrer l’OP dans des luttes citoyennes légitimes, ouvrent le champ à deux démarches utiles pour le secteur associatif qui entendrait s’emparer de la question : les luttes qui s’opposent au modèle de consommation dominant ne sont pas tenues d’être des luttes de consommateurs qui s’opposent à des producteurs qu’il faudrait moraliser ou conscientiser. Par-delà l’enjeu écologique, bien entendu essentiel, ce que la société de consommation institue, c’est bien le renforcement d’un système global de différenciation sociale et d’inégalités fondamentales venant fragiliser l’égalité reconnue, en droit, à l’ensemble des individus : ce à quoi doivent s’opposer les luttes qui ont l’OP pour cible, c’est donc bien le fait qu’elle fait fonctionner, dès la conception technique de la production, un système qui repose intrinsèquement sur des inégalités. Les associations socio-culturelles ont alors, selon nous, pour vocation, plutôt que de s’assimiler à des moteurs d’une consommation alternative, d’être porteuses et mobilisatrices des individus qui, fragilisés et opprimés par les innombrables et omniprésentes injonctions à la consommation, sont – par l’OP – sans cesse contraints de néanmoins s’y soumettre.
- [1] Désormais abréviée OP
- [2] Voir à ce propos l’article MICHEL, A., « La directive 1999/44/CE sur la garantie des biens de consommation : un remède efficace contre l’obsolescence programmée », dans Revue Européenne de Droit de la Consommation; 2|2018; Vol. 2016, pp. 207 – 236.
- [3] Pour un détail de ces différents éléments, voir LIBAERT, T., « Consommation et controverse : le cas de l’obsolescence programmée », dans Hermès La revue, 2015|3, n°73, p.151-158.
- [4] LONDON, B., « En finir avec la crise grâce à l’obsolescence planifiée », dans Écologie et politique, 2012|1, n°44, p.179
- [5] LIPOVETSKY, G., L’ère du vide. Essais sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard (coll. « Folio essais »), 1983, p.157.
- [6] Pour une approche historique et synthétique de cette notion, voir CHESSEL, M-E., Histoire de la consommation, Paris,La Découverte, 2012.
- [7] Néologisme généré à partir de l’anglais « prosumer », pensé pour indiquer une démarche pro-active du consommateur par rapport à ses activités de consommation : lorsque celui-ci y intervient comme producteur, par exemple. On parle aussi, en langue française, de « consom’acteur » pour désigner les consommateurs « non-passifs », ayant une démarche active par rapport à leur consommation.
- [8] LIPOVETSKY, G., Op.Cit., p.157.
- [9] Ibid., p.11.
- [10] Ibid., pp.16-17.
- [11] BAUDRILLARD, J., La société de consommation, Paris, Denoël (coll. « Folio essais », n°35), 1970, p.49
- [12] Nous voulons désigner, par cette expression, l’idée – classique dans les théories de l’économie de marché – que c’est la raison qui permet au marché de s’organiser et de s’optimiser : chaque « acteur » de ses transactions est donc supposé agir toujours rationnellement. Ce modèle abstrait de l’agir humain fonctionne bel et bien comme un pur « postulat ».
- [13] Ibid., p.49
- [14] Ibid., pp.49-50.
- [15] Désigne l’action de détruire quelque chose, partiellement ou complètement.
- [16] BAUDRILLARD, J., La société de consommation, Op.Cit., p.54.
- [17] BAUDRILLARD, J. Pour une critique de l’économie politique du signe, Paris, Gallimard, 1972, p.87.
- [18] Ibid., p.91.
- [19] Ibid., p.39.
- [20] Ibid., p.40.
- [21] Ibid., p.42.
- [22] BAUDRILLARD, J., La société de consommation, Op.Cit., p.311.
- [23] Ibid., p.315.
- [24] Le manifeste de HOP est disponible en ligne à l’adresse suivante : https://www.halteobsolescence.org/a-propos/#manifeste (consulté le 19/10/2018)
- [25] Voir l’article « Plaintes HOP : ça en est où ? » sur https://www.halteobsolescence.org/plaintes-hop/ (consulté le 19/10/2018.
- [26] Ibid., p.315.
- [27] LIBAERT, T., « Consommation et controverse : le cas de l’obsolescence programmée », dans Hermès, 2015|3, n°73, pp.156-157.
- [28] DUBUISSON-QUELLIER, S., « De la souveraineté à la gouvernance des consommateurs : l’espace du choix dans la consommation », dans L’Économie politique, 2008/3 (n° 39), p. 28.
- [29] Ibid., p.31.
- [30] BAUDRILLARD, J., La société de consommation, Op.Cit., p.56.
- [31] Ibid., p.55.